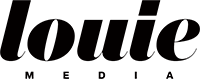Retranscription : Agnès Desarthe
Générique
Agathe le Taillandier : Dans son spectacle Bonhomme, l'humoriste Laurent Sciamma s'amuse des femmes qui dévorent dans le métro l'essai de Mona Chollet Sorcières en se jetant des regards de connivence. Du genre : « on fait partie de la même bande, de la même équipe, de la Team Sorcières » comme il dit. Moi, c'est clairement mon cas. J'ai lu avec délectation ces analyses et variations autour de ces figures inquiétantes, rebelles et insaisissables. Et ça me donnait très envie de rencontrer un personnage de fiction qui en serait une, de sorcière. Alors découvrir le livre du jour m'a vraiment passionné. Paru au début du vingtième siècle, il raconte le parcours d'une femme qui s'émancipe de son ennui londonien pour rejoindre la nature et épouser une nouvelle vie. J'ai trouvé les mots de son héroïne étrangement contemporains quand elle évoque, par exemple ces femmes devenues sorcières comme elle. C'est l'écrivaine Agnès Desarthe qui a choisi ce texte. Traductrice de Virginia Woolf, notamment, elle signe en cette rentrée littéraire C'était mieux après, un roman jeunesse, elle écrit autant pour les enfants que pour les adultes. Son dernier roman s'appelle La chance de leur vie. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club ».
GENERIQUE
Agnès Desharte : Je vais très souvent chercher un livre dans la bibliothèque. J'ai très souvent besoin de consulter mes livres. Ce sont à la fois des outils de travail, des doudous, des recours, quelque chose vers quoi je me tourne pour la consolation, pour pour passer un moment d'ennui. Même si je ne m'ennuie jamais, mais il peut y avoir un moment de la vie qui a un peu plus âpre qu'un autre est à ce moment là pouvoir se tourner vers un livre dont on est sûr qu'il va nous faire tout oublier puisque c'est ça que font les livres parfois, c'est précieux, alors on trouve tout de suite, on va dans la bibliothèque et on se met soit près de la fenêtre, soit de l'autre côté. Et hop, on tend la main et le livre est là.
La lecture, pour moi est la source de l'écriture et même j'ai envie d'aller plus loin, j'ai l'impression que j'écris pour pouvoir lire encore plus ou encore mieux, ou avec plus de profondeur, comme si c'était la lecture finalement, le but ultime. Et à chaque fois que j'écris, quand je commence un nouveau livre, je lui trouve des parrains et marraines littéraires et s'il m'arrive d'être d'être bloquée, de ne plus savoir où aller et de ne plus savoir comment m'y prendre, je lis. La solution est toujours dans les livres, très rarement dans la vie.
Musique
J'écris un roman, j'espère être en train de le terminer, c'est toujours difficile à dire, difficile de savoir où on en est, mais j'ai l'impression que le rythme s'accélère. C'est bon signe. Et en même temps, je travaille à une traduction, je traduis des articles écrits par Virginia Woolf pour le Times Literary Supplement. Un supplément littéraire au journal du Times. Il y a bien des années que ça a été écrit ces textes. Elle même était jeune quand elle les a écrit. Et voilà, moi, je les traduit maintenant. Est ce que je préfère écrire mon roman ou traduire traduire ce que Virginia Woolf a écrit il y a des années ? J'aime faire les deux. J'aime traduire et écrire. J'aime écrire et traduire. J'ai toujours exercé ces deux activités en même temps. Parfois dans la même journée. Par exemple, je traduis le matin et puis j'écris l'après midi. Ou alors l'inverse, ou parfois j'intercale une journée d'écriture et une journée de traduction, et c'est très reposant. L'un repose de l'autre. Quand on traduit c'est comme si on s'absentait de soi même, comme si on prenait des vacances, on part dans le pays d'écriture de quelqu'un d'autre. C'est exotique, ça change. C'est contraignant aussi parce qu'on doit s'adapter et parfois on doit se tordre même pour arriver à atteindre la langue de l'autre.
Et puis parfois, on est content de retourner à ses propres manies, à son propre imaginaire. Cette année, j'ai traduit L'intemporalité perdue et autres nouvelles d'Anaïs Nin. On me demande quelle relation j'entretiens avec cette écrivaine. Avant de traduire L'intemporalité perdue et autres nouvelles, je n’entretenais aucune relation avec Anaïs Nin. Je ne l'avais jamais lue. J'ose l'avouer. J'en avais entendu parler. Ça fait partie de ces écrivains qui s'avancent avec une aura. Par exemple, on dit beaucoup d'Anaïs Nin que c'était quelqu'un de très libéré. Elle est utilisée parfois comme icône du féminisme et moi, ce qui me frappe, en la traduisant et en la lisant, parce que depuis, je l'ai davantage lue. Ce qui me frappe, c'est sa soumission au regard de l'homme. Elle a l'air d'exister que dans ce regard, dans le désir de l'homme. C'est comme si c'était ça qui la faisait vibrer, c'est à dire comme un instrument de musique dans lequel il faut que quelqu'un souffle pour qu'il y ait un son qui se dégage, ça donne un peu cette impression. C'est comme si, à chaque fois qu'elle rencontrait un homme nouveau, il allait créer son désir à lui pour elle, allait créer ce sens, son désir à elle pour lui. Alors je sais pas, je n'émets pas de jugement là dessus. C'est très intéressant. C'est très dynamique. C'est juste que ça ne m'apparaît pas comme une figure du féminisme. En tout cas, pas du féminisme tel que je le conçois, qui est une façon d'être autonome, d'être soi dans une liberté, la plus grande possible et être capable de s'affranchir du regard, du regard de l'homme et du regard des autres femmes aussi, d'ailleurs.
Dans le recueil que j'ai traduit L'intemporalité éperdues et autres nouvelles, quel long titre ! Dans cette façon qu'Anaïs Nin a de parler de la création et de la créativité, elle dit beaucoup de choses, de la difficulté d'être une femme et d'être une créatrice, et ça, ça m'intéresse beaucoup. Virginia Woolf en parle aussi merveilleusement quand elle dit que pour être écrivain, « il faut tuer l'ange du foyer », c'est cette personne qui, s'il y a un courant d'air, vous dira "va t'asseoir là va t’asseoir dans le courant d'air. C'est ce qui fait qu'on se sacrifie quand on dit "Je ne suis pas fatiguée" quand on est très fatigué.
Et Anaïs Nin met ça en scène aussi dans ses nouvelles, cette façon qu'a la femme de ne pas toujours s'autoriser et le danger que ça représente, le danger que ça représente pour les hommes, à qui ça fait peur. Une femme qui crée oulala, ça a l'air très dangereux ce truc-là.
Musique
J'ai choisi de parler d'un roman de Sylvia Townsend Warner, un roman qui s'appelle en français Laura Willowes. C'est rigolo ces histoires de traduction, en anglais il s'appelle Lolly Willowes. C'est un roman étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Laura Willowes, c'est l'histoire d'une femme qui est considérée, comme c'était le cas à l'époque, comme une vieille fille, mais maintenant, on dirait une jeune fille puisque au début du roman, je crois qu'elle a 28 ans. Mais elle n'est pas encore mariée. Elle n'est pas encore mariée, on est dans les années 1910 et son père meurt et elle est recueillie par son frère et sa belle sœur, qui ont deux enfants qui disent « c'est bien pratique, la sœur, la belle sœur, vieille fille qui va pouvoir s'occuper de nos enfants ». Donc elle devient nounou par convenance, mais aussi par convention. Parce qu'une femme, qu’est-ce que c'est une femme sans enfant ? Quelle drôle de créature ! Alors, elle s'occupe des enfants jusqu'au jour où, alors qu'elle avait pris l'habitude d'aller faire de fréquentes visites à la campagne, cette période prend fin et elle se retrouve comme enfermée dans la ville, enfermée dans l'ombre. Elle a une nostalgie incroyable de la campagne des bois et un jour, elle entre dans une boutique, une boutique, une épicerie qui fait en même temps épicerie et fleuriste. Là il y a des bocaux de fruits en conserve, des pommes dans des paniers et des poires. Elle achète des fleurs. Et là, le fleuriste, l'épicier lui offre des branches de hêtre. En anglais, beech, se traduit en français par hêtre et dans « hêtre », même si il y a ce H, on entend toujours être, mais il faut bien voir que dans beech il y a aussi "be" qui veut dire être. Donc, c'est un arbre de l'existence, un arbre qui a quelque chose à voir, en tout cas, dans la langue ou dans l'écho, il y a quelque chose qui a à voir avec être et peut être soi. Laura Willowes achète ces branches et c'est comme si elle était ensorcelée, elle demande d'où elles viennent et l'épicier répond qu'elles viennent de Great Mop, dans les Chilterns et à ce moment là, il se passe comme une révolution chez Laura Willowes. Elle décide de tout plaquer et elle part dans les Chilterns. Elle retourne dans ce coin de nature, dans ce coin isolé de l'Angleterre et là, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va devenir une sorcière.
Quand j'ai lu ce livre, je crois que j'ai éprouvé un soulagement. Parce que pour la première fois, je crois dans un livre qu'on peut dire occidental, écrit par une Anglaise, il y avait une sorcière, il y avait le diable, donc il y avait du surnaturel. Et moi, j'avais toujours eu l'impression que le surnaturel et le naturel étaient main dans la main. Dans mon quotidien, ils se promenaient toujours ensemble. Alors pourquoi ? Peut être parce que ma grand-mère paternelle pratiquait elle même la sorcellerie. Moi, je l'ai toujours connue, faisant des espèces de tours de passe passe bizarres, avec du sel, des graines de caroube, des mouchoirs noués en je ne sais pas combien et il y avait toutes les histoires que mon père me racontait de sa petite enfance où il arrivait sans arrêt, des choses étranges, où on interprétait les rêves ou les rêves étaient prémonitoires, où les rêves pouvaient être dangereux aussi.
Et donc, il y avait cette interpénétration, cette porosité entre le quotidien et un autre monde qui était quotidien aussi, puisque le monde des rêves c'est quotidien. Ce sont des choses qui sont séparées dans la culture occidentale. Le naturel et le surnaturel. Moi, j'ai grandi dans un environnement où c'était comme ça. Enfant, quand je lisais des contes de fées avec des sorcières, des dragons, des transformations, j'avais l'impression que c'était absolument possible. J'ai embrassé un nombre de crapauds, heureusement qu'il y pas beaucoup de crapauds dans mon entourage, mais j'en ai embrassé un certain nombre en attendant avec ténacité qu’ils deviennent des princes. C'était un soulagement pour moi de découvrir un livre qui avait été écrit dans une région du monde dans laquelle moi même je vivais. Et pourtant, qui abritait cette dimension, la dimension du surnaturel qui était si fondatrice pour moi. Et donc, c'est une ode, Laura Willowes, c'est une ode à la liberté, à l'autonomie et à la possibilité d'être soi en étant satisfait, pas content de soi, juste se suffire à soi-même.
Ce que ça raconte de ma propre enquête, déjà, il y a cette volonté et ce désir d’être proche de la nature, d'être proche de la forêt. La forêt qui est la nature sauvage. Je lis, "elle s'agenouilla au milieu du champ et approcha son visage pour mieux sentir leur parfum. L'espace d'un instant, le poids de toutes les années sans joie la fit s'incliner vers la terre. Elle tremblait, comprenant pour la première fois combien elle avait été malheureuse, l’instant d'après, elle se sentit libérée". Donc, là, c'est un moment de transe que vit Laura, de retour enfin dans la forêt, dans la nature, et où elle s'affranchit de tout le poids social. Elle est un animal parmi les autres animaux. Elle est une créature parmi les feuilles, dans l'odeur de la terre, et ça, c'est quelque chose qui qui a pu dans ma vie m’arriver. Alors pas de pas de cette manière, forcément, j'ai absolument jamais ressenti, parce que vivant à une autre époque aussi, le poids du social de façon aussi contraignante et aussi torturante que le personnage de Laura Willowes. Mais l'autorisation à être sauvage, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est très évident pour une petite fille. L'excès, la folie, faire n'importe quoi, faut être sage. Il faut être sage comme une image. Il faut croiser les bras sur la table. Tout ça m'a pas mal pesé quand j'étais enfant et devenue grande, je me suis rendu compte que dans la nature, toutes ces conventions là tombaient.
Musique
Si j'avais des livres à conseiller, j'en ai tellement. Il y a tellement de livres que j'aime. C'est toujours bizarre parce qu'on se dit « tiens, celui là », et puis à peine a-t-on dit un titre, qu'il y a un autre titre qui se dresse et qui dit "et moi, et moi et moi". Cette année, j'ai adoré lire Martin Eden de Jack London. J'ai adoré lire la correspondance de Flaubert avec George Sand, qui est parue sous le merveilleux titre Tu aimes trop la littérature, elle te tuera. Je ne cesse de lire et de relire les nouvelles de Isaac Bashevis Singer. C'est une joie, une source de joie inépuisable. Ses romans aussi, d'ailleurs. Et, en parallèle, parce que c'est des lectures que j'aie toute l'année, je recommence dès que j'ai fini le livre, je le reprends au début, je lis comme ça aussi Maupassant, Les Nouvelles de Maupassant. Je ne m'en lasse jamais.
Générique
Agathe le Taillandier : Vous venez d'écouter Agnès Desarthe à son micro et elle répondait aux questions que je lui ai envoyées. Elle vous recommande le roman Laura Willowes de Sylvia Townsend Warner publié chez Gallimard et disponible en Folio dans une traduction de Florence Lévy. Agnès Desarthe est traductrice et écrivaine, elle vient de signer chez Gallimard Jeunesse, C’était mieux après. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucile Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditorial, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bonoua, directrice des productions. Je vous recommande notre podcast « Injustices ». La dernière saison s'appelle Ou peut-être une nuit. C'est une série en six épisodes créée par Charlotte Pudlowski sur l'inceste et les silences qui l'entourent. Bonne écoute et a très vite.
Générique de fin