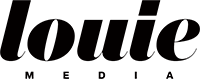Cet épisode de Passages nous a fait penser au scandale récent dans les piscines parisiennes. Affaire dévoilée par Laurène Daycard, formidable journaliste spécialisée dans les violences sexistes et sexuelles, elle-même victime d’un voyeur la filmant dans des vestiaires juste après une baignade; et nous découvrions tous et toutes combien sont fréquents les actes de voyeurisme - délit institué en 2018.
«Je pense au procès des viols de Mazan », écrivit ensuite Laurène Daycard dans Le Monde. «À l’origine, Dominique Pelicot a été interpellé, en septembre 2020, parce qu’il filmait sous la jupe d’une femme dans un supermarché. Il était aussi actif sur le site Web Coco.gg, un repaire de pédocriminels et de violeurs dont la fermeture a été ordonnée par la justice en juin 2024. Que comptait faire mon agresseur de sa vidéo ? Quand, quelques heures plus tôt, il s’est barricadé dans sa cabine, a-t-il eu aussi le temps de la partager dans l’un de ces groupes Telegram qui fédèrent des dizaines de milliers de voyeurs ?»
Est-ce là, dans nos regards, que commence la violence? Dans la manière de s’autoriser à ne regarder l’autre que comme un objet?
Le voyeur de la piscine, comme Dominique Pélicot, filmait. Mais c’est un facteur aggravant; le délit ne nécessite pas de filmer, seulement «d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne». Un an d'emprisonnement; 15 000 € d'amende.
Que regarde-t-on, que filme-t-on sans avoir besoin de demander l’autorisation si ce n’est une chaise, un pot ? Est-elle déjà inscrite dans nos regards, la violence qui consiste à faire de l’autre un pot? Jusque dans la banalité de ces regards insistants dans la rue, dans un rendez-vous professionnel, sur nos fesses, sur nos seins, ces regards qui disent peu importe ce que tu ressens (est-ce qu’un pot ressent?).
Dans Le regard féminin (2020), l’essayiste Iris Brey, spécialiste du genre au cinéma, théorise le female gaze, non simplement comme un regard porté par des femmes, mais comme regard proposant autre chose que l’objectification de l’autre, comme «un régime d’images qui appellent à désirer autrement, à explorer nos corps, à laisser nos expériences nous bouleverser».
Elle analyse un certain nombre d’oeuvres, de cinéastes hommes et femmes, qui proposent d’autres manières de regarder le monde, d’envisager les corps, les liens. Et postule que le «female gaze est un geste conscient. Il produit de ce fait des images conscientisées, politisées.» C’est presque une proposition politique, une invitation à regarder autrement: «Le regard féminin n’est pas le fruit du hasard, dit-elle, c’est une manière de penser». Sans écraser l’autre et sans le réifier.
Charlotte Pudlowski, cofondatrice de Louie Media.