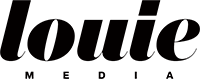Retranscription - Call, meeting, brainsto : ce que les anglicismes disent de nous
Camille Maestracci : Je sais pas vous, mais moi souvent quand je parle je dois me faire violence pour ne pas utiliser de mots anglais. C’est pas que je suis bilingue mais on est tellement envahi·es par la culture anglo-saxonne que ça en devient presque compliqué de pas laisser échapper un “Je te rappelle j’ai un call” ou alors “T’as checké son background ?” ou encore “Il est un peu borderline mais en même temps il va booster la team.” Bon évidemment j’exagère exprès mais je suis sûre que beaucoup d’entre-vous se reconnaîtront, en particulier dans le contexte professionnel. Brainstorm, challenge, meeting, punchline, coworking, quand j’entends ces mots, j’imagine un jeune patron de start-up en train de motiver ses équipes. A la fois ça me fait sourire parce que ça renvoie une image caricaturale du travail aujourd’hui, la fameuse start-up nation, et en même temps, notre langage a réellement évolué en ce sens. La question c’est donc : qu’est-ce que ces usages révèlent de notre façon d'envisager le travail aujourd’hui ? Dans cet épisode, Hélaine Lefrançois interroge notre rapport aux anglicismes dans le contexte du travail. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail (en cours).
Hélaine Lefrançois : Entre 2014 et 2017, j'étais correspondante à Londres. Je couvrais l'actualité britannique pour des médias francophones, donc je passais tout le temps de l'anglais au français. Avec mes amis et mes collègues francophones, je parlais beaucoup franglais. On disait : “c’est easy, c’est dead, c’est un plat healthy”. Mais quand j'écrivais des articles ou des reportages pour la radio, je faisais attention et j'expliquais toujours les mots ou les expressions que je laissais en VO.
Un jour, j'ai reçu un mail d'un certain Daniel. C'était au sujet d'un de mes articles sur la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, juste après le référendum sur le Brexit. Je parlais des éventuelles conséquences, comme le retour des check point. Dans son mail, Daniel me disait, très poliment, qu'il aurait été plus "correct" que j'utilise l'équivalent français : poste de contrôle.
Dans les faits, Daniel a raison : il existe un équivalent français. Mais pour moi, check point, c'était l'expression la plus précise et ça parlait à tout le monde, parce que c'est entré dans le langage courant.
Quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé au sein de plusieurs rédactions et j'ai découvert que Daniel est connu dans le petit monde des médias, parce qu'il rappelle régulièrement à l'ordre les journalistes qui utilisent des anglicismes.
Au bureau, dans le secteur tertiaire, on utilise beaucoup de mots empruntés à la langue anglaise, non traduits, calqués, détournés. On dit "process" et pas "procédure", "meeting" plutôt que "réunion". On utilise "asap", l'acronyme de "as soon as possible" pour demander de faire quelque chose "au plus vite". Et on préfère souvent parler de "burn out" plutôt que de "syndrome d'épuisement professionnel".
Dans certains milieux plus que d'autres, les anglicismes sont omniprésents. C'est le cas du marketing, la communication, le consulting, les ressources humaines, la tech, la pub….
Cette novlangue truffée d'anglicismes a toujours été un ressort comique.
Extrait d’un sketch des Inconnus.
Hélaine Lefrançois : Dans ce sketch des Inconnus, qui date de 2010, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus se moquent du langage des publicitaires.
Ces anglicismes, on les utilise fréquemment, parfois sans s’en rendre compte. Ce qui m’intéresse, c’est qu’on n’est pas forcément à l’aise avec l’image qu’ils renvoient de nous, et qu’on adore les détester.
Depuis 4-5 ans, c'est surtout le langage des start-ups qui est tourné en dérision. Et les startuppeurs le savent très bien.
Mathilde Saulnier : Du coup je m'appelle Mathilde, je suis Startup Manager, chez l’1Kubator Rennes et mon travail, c'est d'accompagner les porteurs de projets au cours de leur incubation à travers un programme d”ateliers et c’est aussi un accompagnement personnalisé avec des rendez-vous individuels. Donc du coup là c'est les bureaux de l'équipe et je suis avec Séverine qui est Product Manager chez 1Kubator et qui accompagne les start-ups sur le produit, la conception des MVP, avec les maquettes, les wireframe. Du coup là c'est l'open space avec les bureaux..
Hélaine Lefrançois : Là, clairement, j’ai visé en plein dans le mille. Mais si elle utilise beaucoup d’anglicismes, Mathilde Saulnier n’est pas toujours très à l’aise avec ça. A commencer par l'intitulé de son poste.
Mathilde Saulnier : Quand on me demande quel travail je fais, je déteste dire que je suis Start-Up Manager parce que c'est un nouveau métier qu'on connait pas et qu'il y a le mot Start-Up et qu'il est galvaudé. Et que, du coup, Start-Up Manager, ça fait beaucoup sourire. Je suis tellement peu à l'aise pour le dire que je prends l'accent anglais parce que je joue de l'autodérision. Ouais, je suis Start-up Manager. Ça me fait moi-même sourire parce que… Ouais, c'est un anglicisme, et je ne suis pas fan, moi, personnellement, d'avoir un nom de métier anglais, en fait.
Hélaine Lefrançois : Si Mathilde n’est pas à l'aise, c’est en partie parce que les anglicismes peuvent être assez mal vus. En France, il y a une farouche opposition au franglais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui.
Le terme "franglais" aurait été inventé en 1959 par le grammairien Maurice Rat, qui est l'un des fondateurs de l'association Défense de la langue française. À l’époque, l’expression a déjà une connotation négative : pour Maurice Rat, le "franglais" désigne "le français émaillé de vocables britanniques, que la mode actuelle impose".
En 1964, Gallimard publie Parlez-vous franglais ? Dans cet essai, son auteur René Etiemble s'indigne contre le mélange des langues. Ce livre est devenu une référence de la littérature anti-anglicismes. C'est ce qu'on appelle en bon franglais, un best-seller.
Aujourd'hui, il existe plusieurs organismes qui luttent contre la prolifération du franglais. Il y a bien sûr la très médiatique Académie Française. Sur son site, dans la rubrique "Dire, ne pas dire", elle propose avec un ton très doctoral des équivalents aux derniers anglicismes à la mode. Il y a aussi l'association Avenir de la Langue française qui décerne chaque année le prix de la "Carpette anglaise". En 2019, c'est La Banque Postale qui a été couronnée malgré elle, parce qu'elle a nommé sa banque en ligne "Ma French Bank". Ses slogans publicitaires étaient truffés de mots anglais. Il y avait par exemple : "When tu check la liste de everybody qui te doit de la money". On vit entourés d'anglicismes. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi on en utilise autant dans le contexte du travail et pourquoi ils peuvent nous mettre mal à l'aise. J'en ai parlé avec Julie Neveux. Elle est linguiste et dramaturge. En 2020, elle a publié chez Grasset Je parle comme je suis : ce que les mots disent de nous, C'est un livre passionnant sur le langage dans lequel elle décortique pas mal d'anglicismes. Pour elle, au travail, nous utilisons des mots en anglais par mimétisme, et aussi par nécessité.
Julie Neveux : La plupart, mais 99% sinon plus, des locuteurs et des locutrices qui arrivent dans le milieu du travail, ils doivent s'adapter. Il y a un code qui est la langue que les autres parlent déjà. Donc, ils arrivent dans un milieu qui est déjà anglophone pour la plupart de ces gens-là et ils n'ont pas le choix. Donc, la plupart ne font pas ça par goût ou par snobisme, mais parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut bien s'adapter. C'est comme un code qu'ils doivent apprendre à maîtriser. Et s'ils ne maîtrisent pas ce code, ils ont eux mêmes la sensation de ne pas être intégrés, de pas réussir. Ils n'ont pas le choix, donc ils subissent ça. Et surtout, ils ne sont pas censés avoir un regard critique par rapport à ça. Si vous voulez le second degré, dire "oh mais on comprend rien, c'est quoi ces mots ? Ils servent à rien". Ce n'est pas une bonne… Je pense que ce n'est pas ce qui est requis au départ, quand on arrive dans un milieu. D'abord l'être humain, il s'adapte. Comme tous les êtres animés, animaux, il s'adapte. Il arrive dans un milieu, dans un environnement et il en attrape par mimétisme et par nécessité de survie les codes, donc il y a d'abord ça, que c'est un milieu qui existe et qui parle dans cette langue, et n'importe quel nouvel employé va essayer d'en apprendre les ficelles, le sens, en fait.
Hélaine Lefrançois : On adopte le langage de son environnement de travail pour s’intégrer, se fondre dans le moule, parce que c'est la norme. Et dans beaucoup d'entreprises, ce langage truffé d'anglicismes est devenu la norme pour plusieurs raisons.
Julie Neveux : La raison la plus évidente, évidemment, c'est le modèle économique qui est dominant et d'où s'inspirent tous les gens qui travaillent dans ces milieux : les techniques, le langage. Souvent, ils ont des interlocuteurs aussi qui parlent anglais, donc imposent qu'on parle anglais. Après, il y a en effet d'autres raisons qui sont des raisons culturelles, des raisons de connotations si vous voulez qu'on essaie de transmettre par ce langage qui est une sorte d'illusion d'expertise et d'efficacité. Le mythe du succès qui part de zéro est vraiment très spécifiquement américain. Le business man, le self-made man, celui qui part du début pour arriver au top, ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans "start-up", le début de l'entreprise. Parce que entreprendre, c'est intéressant, ça voulait dire aussi commencer. Mais l'idée de commencer et d'y arriver, et surtout, l'idée de profit, qui accompagne ces mots, si vous voulez, c'est apporté par le vocabulaire anglais beaucoup plus que par le vocabulaire français.
Hélaine Lefrançois : Les start-ups sont des repaires à anglicismes. Comme ce modèle d'entreprise est très médiatisé, les entrepreneurs sont devenus des cibles faciles. L'humoriste Karim Duval en a fait sa marotte : dans ses vidéos YouTube, il adore reprendre leurs éléments de langage et se mettre dans la peau de jeunes CEO qui se veulent inspirants.
Extrait du sketch de Karim Duval : La culture de Baffing c'est une culture, de guerre une culture de fight. On est des GI’s, des djihadistes de l'entrepreneuriat, c'est un combat. Âmes sensibles, allez mourir. Bonjour, je m'appelle Archibald de Buzzman, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de Baffing. Baffing c'est la start up qui modernise la politique RH des entreprises en les aidant à recruter des têtes à claques comme moi pour en faire des tueurs qui pousse la croissance des boîtes et qui surtout règle le plus gros problème actuel à savoir le désengagement des talents. Pour moi, ma fierté avec Baffing c'est la culture de Baffing. La culture de Baffing, elle est extrêmement violente, extrêmement agressive, extrêmement cannibale et c'est cette culture qui fait que notre équipe est soudée à mon bureau et finalement engagée. Jamais personne n'a fait de réussite sans travailler comme moi je travaille, et la valeur travail est au centre de l'équation de mon nombril que je vénère depuis toujours.
Hélaine Lefrançois : Ce qui est drôle, c'est que ce sketch est une parodie d'une vraie interview d'un vrai entrepreneur qui s'appelle Théobald de Bentzmann. C'est le fondateur de Chefing, une start-up qui propose des services de traiteur à des entreprises. Quand elle est sortie début 2020, la vidéo de son interview a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Au point que le petit média numérique qui l'a mise en ligne a préféré la retirer, en accord avec l'entrepreneur.
Dans cette vidéo, il dit, je cite que “La culture de Chefing, c'est une culture de guerre, c'est une culture du fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat et âmes sensibles s'abstenir.“ Plus tard il dit aussi, je cite encore : “Nous, on a trois grosses valeurs. Un : intensité. Deux : client and business focus. On veut des gens qui sont business, business, business. Et troisième valeur : team player. On a une stricte no asshole policy chez Chefing.
Si cette interview a fait tant réagir, si elle a été tournée en dérision et parodiée, c'est parce que cet entrepreneur adopte une posture très caricaturale.
Il incarne la figure du start-upper qui est très engagé dans son projet et qui valorise la persévérance, le dévouement, la résistance au stress. Dans ce cas-là, le franglais trahit une certaine vision du travail basée sur le rapport de force et la performance.
Julie Neveux : Bien sûr qu'il y a plus ou moins d'enthousiasme à embrasser des codes et il y a les zélés. Voyez,il y en a qui eh bien ont été élevés, peut-être,croient en ce mythe et vivent leur travail comme une compétition. Donc les mots anglais, très souvent, connotent le travail de façon positive, ludique et sous l'angle de la compétition sportive. Ce qui est très intéressant. Donc, il y a matcher, challenger, qui est très, très à la mode. Ça, c'est des mots qui colportent l'idée de compétition et d'un succès qui soit un peu glamour, voyez, un succès qui soit à la fois glamour et profitable économiquement.
Les discours sur l'entrepreneuriat valorisent l'esprit d'initiative, la prise de risque, tout ce qui fait qu'on devient acteur de son avenir professionnel. Cette idée se retrouve même dans le nom de la boîte, Chefing, et plus précisément dans le choix du suffixe -ing, qui est utilisé à tout va en français. En anglais, ce suffixe sert à former le participe présent et à exprimer une action. Alors Théobald de Bentzmann n'en avait peut-être pas conscience. Mais pour Julie Neveux, ce détail linguistique n'est pas anodin.
Julie Neveux : Le suffixe ing, c'est un des suffixes très, très, très productifs en anglais pour former donc des noms à partir de verbes normalement comme co-working, etc. Et ce qui est génial, ce qu'on trouve vraiment le suffixe -ing, là on est passées par un espace de co-working pour venir ici, les gens font des brainstorming, ou plutôt des brainstorm maintenant. Mais c'est pour dire que, c'est transformer quelque chose en une activité dont on est responsable et à laquelle on a envie de s'identifier. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que si vous mettez -ing en anglais, c'est vraiment pour dire : “je l'ai choisi. C'est ça que j'ai choisi de faire”. On devient proactif dans l'activité et c'est intéressant parce que du coup, il y a une sorte de dérive de ça. On l'utilise pour transformer des réalités en fait pas évidentes, difficiles, indigentes, des espaces qu'on partage parce qu'on n'a pas plus d'argent pour avoir un espace en plus. Et c'est du coworking et ça devient cool. Donc, il y a vraiment une sorte de vernis qu'apporte l'anglais là.
Antoine Gouritin : C’est toujours pareil. Il faut réussir à distinguer ce qui est du jargon, ce qui est vraiment opérationnel, je dirais, et puis, ce qui est du folklore, qu’on entend souvent à la radio ou sur Internet ou ailleurs. C'est souvent repris quand on fait un repas partagé à la French Tech Rennes Saint-Malo au mois de juin, parce qu'il fait beau, on va dehors, on fait du pique nique, on appelle ça un co-lunch. Voilà ce genre d'exemples-là, évidemment, ça fait rire tout le monde. Mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait ces termes-là au delà du jargon et que ça fasse rire tout le monde, ça peut être d'un autre côté intéressant pour eux parce que on se moque d'eux là-dessus et on rentre pas dans les détails de ce que ça veut dire et de tout le reste.
Hélaine Lefrançois : Lui, c'est Antoine Gouritin. Il a travaillé pendant quatre ans dans une start-up du secteur culturel. Aujourd'hui, c'est plutôt un observateur critique. Dans son podcast Disruption Protestante et dans son essai Le Startupisme : le fantasme technologique et économique de la start-up nation, il s'attarde beaucoup sur le langage utilisé dans cet écosystème. Et quand je dis écosystème, je parle bien sûr des start-uppers, mais aussi de tous les acteurs qui gravitent autour : les investisseurs, les personnes qui travaillent dans les incubateurs, les chargés d'innovation des administrations et des grandes entreprises. Pour Antoine Gouritin, leur langage est souvent enchanteur. Les anglicismes vont servir à donner une connotation positive à des mots ou des concepts qui inspirent la défiance.
Antoine Gouritin : Quand la traduction française le fait pas, on va utiliser le mot anglais parce que ça craint.
Hélaine Lefrançois : Par exemple, les acteurs de l'innovation parlent de "venture capital" pour parler des capitaux apportés aux jeunes entreprises en pleine croissance, qui peuvent à tout moment se casser la figure.
Antoine Gouritin : Les investisseurs, tous là, ils finissent par utiliser la version anglaise parce qu'en français, un fonds qui fait de l'investissement, on appelle ça un fonds de capital-risque... Ils vantent le risque partout, mais quand quelque chose s'appelle capital-risque, alors là ça ne va plus du tout.
Hélaine Lefrançois : Ce que veut dire Antoine Gouritin, c'est que prendre des risques dans le monde de l'entreprenariat est bien vu. Mais le mot "risque" associé au capital, donc à l'argent, ce n'est pas vendeur. La novlangue truffée d'anglicismes contribue aussi à brouiller les pistes. Un bon pitch, avec les bons mots clés, va donner l'impression que le projet est innovant, même si ce n'est qu'une vieille idée recyclée.
Antoine Gouritin : C'est des gens qui se pensent en rupture tout le temps et dès qu'ils ont une idée, alors ils ont tendance à croire que c'est une idée géniale parce qu'elle vient d'eux. Mais en plus, ça va tout changer. C'est du changement de paradigme, tout le temps, et ça a été repris en français dans une traduction littérale du coup : “disruption”. Alors que quand on regarde un petit peu de plus près la plupart des idées ne sont pas très neuves, les modalités ne sont pas très neuves non plus.
Hélaine Lefrançois : Ces dix dernières années, les pouvoirs publics ont soutenu la création de start-ups à coups de dispositifs et de fonds publics. Avec sa campagne en 2017, Emmanuel Macron les a mises un peu plus sur un piédestal. Les start-ups sont présentées comme une réponse au chômage et aux inégalités. Mais leur novlangue peut donner une impression d'entre-soi et d'opacité.
Antoine Gouritin : Dans une industrie qui se veut le futur, à qui on a dit depuis toujours qu'elle était le futur et qui y croit, ce langage en franglais, c'est très excluant, tout simplement.
Hélaine Lefrançois : En réalité, n'importe quel jargon professionnel peut être excluant. Si vous êtes chargé·e de com’, que vous discutez avec des personnes qui travaillent dans le domaine médical qui utilisent plein de termes techniques, vous n'allez pas tout comprendre, et vous pouvez vous sentir exclu·e.
Mais avec les anglicismes, il y a deux choses. D'abord, tout le monde ne comprend pas ces mots, parce qu'il y a la barrière de la langue. Et en plus, parler franglais est souvent considéré comme une forme de snobisme.
Ce qui n'aide pas, c'est qu'il existe beaucoup de stéréotypes sur les start-ups. Pour pas mal de gens, elles font partie d'un petit milieu parisien, assez élitiste. Et c'est vrai que les enquêtes sociologiques montrent que la majorité des start-uppers sortent de grandes écoles et viennent de milieux privilégiés. Le franglais peut donc renforcer ces clichés.
J'en ai parlé avec Loïc Coudret, le directeur de l'1Kubator de Rennes, où travaille Mathilde Saulnier, la start-up manager que vous avez entendu au début de cet épisode. Loïc Coudret a conscience de ce problème. D'ailleurs, l'1Kubator, qui est un réseau national, cherche à transformer son image de marque.
Loïc Coudret : Dans la stratégie d’1Kubator, on a ouvert très tardivement le bureau parisien, parce qu'on voulait justement faire de l'innovation en Province, amener l'innovation dans d'autres métropoles autres que Paris. Et on voulait, avec cette idée de l'entrepreneuriat pour tous et éviter d'apporter cette culture là avec ces codes là. Notre première baseline, notre premier message, c'était : crée ta start-up on t'accompagne, on te finance. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui que beaucoup de porteurs de projets ont plein d'anglicismes et tombent un peu… On a quelques caricatures dans notre portefeuille et ça nous fait rire. En interne, on n'est pas sûr·es que ça soit l'image qu'on souhaite renvoyer non plus. Et on prend bien conscience – on a cinq ans maintenant – que le mot startup est complètement galvaudé, c'est utilisé à tout va. Nous on a une autre définition qui nous semble la plus correcte, mais qui n'est pas du tout partagée par tout le monde. Et donc, on souhaite ne plus utiliser le mot startup dans notre communication.
Hélaine Lefrançois : Pour Loïc Coudret, cette novlangue risque de desservir l'1Kubator et de décourager ceux et celles qui ne s’y reconnaissent pas. Il veut donc éviter que les entrepreneurs et les entrepreneuses qu'il accompagne cochent les cases du cliché du startupeur. Et lui-même veut éviter de renvoyer cette image.
Loïc Coudret : Je suis le morphotype du start uppeur. En fait, je suis un jeune cadre blanc sorti d'école de commerce et je voulais pas ressembler à ça. Et je pense que le vocabulaire favorise ce morphotype de ce que peut être le start-upper.
Hélaine Lefrançois : Tu voulais pas être une caricature ?
Loïc Coudret : Oui carrément, c'est ça, je ne voulais pas tomber dans cette caricature. Je pense qu'en plus, dans les valeurs de l’1Kubator et dans les miennes, il y a quelque chose qui est le fait que tout le monde peut entreprendre, quelque soit son profil, qu'on n'ait pas d'argent. On demande d'avoir 1000 euros, c'est le minimum pour la création juridique de la société, mais on apporte l'argent derrière, nécessaire au développement. Et on pense, que ce soit 1Kubator ou moi, c'est quelque chose qui est dans mes valeurs, que tout le monde aujourd'hui en France peut entreprendre. Il existe plein de dispositifs qui permettent de trouver les financements ou d'être accompagnés pour, et je trouve que le vocabulaire et cette culture startup, est un réel frein, justement, permet de rendre ça peut inaccessible parce qu'on ne fait pas partie ou on n'en comprend pas les codes. L'idée, c'est de casser ça au maximum.
Hélaine Lefrançois : Concrètement, Loïc Coudret fait attention au langage que les entrepreneurs et les entrepreneuses utilisent. C'est ce que j'ai pu constater lors du point d'étape pitch que l'1Kubator organise tous les trois mois.
Mathilde Saulnier : Merci à tous d'être là, du coup l'idée c'est un quart d'heure de pitch, 10 minutes de questions réponses, on va vous challenger sur vos projets…
Hélaine Lefrançois : Le point pitch, c'est un entraînement pour les porteurs et les porteuses de projet qui seront amené·es, plus tard, à convaincre les éventuels investisseurs. Leur présentation s'appuie sur des slides et suit une trame, ce qu'on appelle un pitch deck.
Loïc Coudret : Le pitch deck, c'est un format de documents demandés par les investisseurs. C'est le support de présentation de son business plan sous forme de Slides, un powerpoint ou ce genre de document qui permet d'expliquer le projet, la startup, ses perspectives financières, son besoin de financement et c'est un document demandé par tout partenaire financier.
Hélaine Lefrançois : Lors de ces présentations, les porteurs et les porteuses de projet utilisent parfois des mots techniques pas français, qui font partie du pitch deck. Comme workflow, business plan, ou persona, qui est le terme utilisé en marketing pour désigner la cible du produit… Mais ce n'est pas non plus une avalanche d'anglicismes.
Loïc Coudret : Je mets un chrono, tu as 15 minutes, c'est parti.
Oscar Landry : Hop, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je vais commencer par un chiffre, 16 000€…
Hélaine Lefrançois : Le premier à passer s'appelle Oscar Landry et il est tout jeune. Il a 19 ans, il vient de finir sa deuxième année d'IUT.
Oscar Landry : YouJob c'est une application d'aide à la recherche d'emploi basée sur les softskills, elle s'adresse à des grands groupes, ETI et PME qui recrutent sur des postes qui demandent peu ou pas de qualifications. Donc, mon idée, c'est que le candidat s'auto-évalue sur des soft skills, que ces soft skills là, ça constitue un profil et que ce profil, pour éviter les biais qui sont liés à l'auto-évaluation, il va pouvoir le partager avec ceux qui le connaissent le mieux, qui finalement, sont ses amis. Ça peut être son coach de sport. Ça peut être son ancien employeur. Et donc, à leur tour, vont évaluer son profil. Et cela va permettre aux recruteurs d'avoir un double point de vue, une double évaluation et donc de trouver vraiment le profil qui match le mieux. Très rapidement, au niveau du fonctionnement…
Hélaine Lefrançois : Au moment des questions-réponses, Loïc Coudret lui fait des remarques sur les éléments de langage utilisés.
Loïc Coudret : Sur la slide workflow. Tu nous parles de swipe, mais je ne comprends pas ce que c'est. On ne sait pas ce que fait Tinder. Tu peux pas me dire que c'est comme Tinder, explique-nous ce que c'est que, en fait, c'est de passer d'une image, d'un écran à un autre en allant à gauche, j’accepte, à droite, je refuse. Il faut que tu expliques plus clairement la mécanique. C'est vraiment pas clair. Et du coup, la deuxième mécanique que tu nous dis, tu dis : ensuite, les profils match, mais je ne sais pas ce que ça veut dire matcher. Concrètement, comment tu fais pour faire ce matching ?
Hélaine Lefrançois : Ce qui est intéressant, c'est que là, Loïc Coudret, le reprend sur des termes qui sont entrés dans le langage courant. À priori, notre génération connectée qui a grandi avec les applications de rencontre les connaît bien. Sa démarche est pédagogique : il veut le pousser à être plus précis, plus professionnel.
Loïc Coudret : Ils ont vite tendance à jargonner, à utiliser soit des langages qui sont issus de leur secteur d'activité, soit les codes de la startup. Je pense qu'il faut être vraiment attentif que tout le monde comprenne ce qu'on dit et c'est super facile de jargonner et de vouloir ressembler à Steve Jobs ou autre. Donc je suis attentif à ça. Et puis, si concrètement, j'ai un exemple de partenaires financiers qui, boh, n'acceptent même pas de regarder ou d'écouter certains porteurs de projets parce qu'ils savent très bien d'entrée, soit en lisant le business plan ou les documents envoyés, que ils comprendront pas parce que c'est un secteur d'activité qui c'est trop complexe. Si c'est compliqué à comprendre, s'il y a trop de jargon, on va pas prendre le temps de regarder.
Hélaine Lefrançois : Dans certains cas, ce jargon anglicisé peut même rebuter les potentiels clients. C'est ce dont s'est rendue compte Laura Candas, une autre entrepreneuse qui pitchait son projet ce jour-là.
Laura Candas : Je suis Laura, et je vais vous présenter Bulle d’autonomie, un projet à fort impact social qui va pouvoir concerner n’importe lequel d’entre nous dans cette salle.
Hélaine Lefrançois : Laura Candas a 37 ans et elle a travaillé pendant 9 ans dans le médico-social avant de créer son entreprise. Elle l'a baptisée Bulle d'autonomie. Son but, c'est d'accompagner les aidants, les personnes qui soutiennent un parent vieillissant tout en continuant à travailler.
Laura Candas : Nous sommes pour l'instant une dizaine à s'être lancés dans ce nouveau secteur qu'on appelle dans notre jargon le care management. En fait c'est de la coordination, voilà tout simplement.
Hélaine Lefrançois : Elle, elle ne parle pas de "care management" ou "care manager". Même si c'est un terme homologué, elle trouve que c'est contre-productif de l'utiliser.
Laura Candas : Alors déjà, au niveau de mon public, j'ai toujours été en contact avec les personnes âgées. Donc, c'est vrai que l'anglais, pour les personnes âgées, c'est toujours très compliqué et j'avais vraiment envie que mon projet touche la majorité des personnes et que ce soit compréhensible par tous. J'ai intégré une commission nationale sur la nouvelle branche que je suis en train de développer, donc le care management, c'est ce qu'on arrête pas de dire, c'est des care managers pour le métier. Et justement, j'ai commencé à en parler à mes clients sur le terrain et j'ai bien vu que ça ne collait pas du tout. Déjà, ça colle pas avec moi et en plus, ça colle pas du tout. Donc, j'ai décidé, au lieu de parler de care manager, de vraiment parler de coordinateur. Je trouve que c'est beaucoup plus clair et je me rends compte que mes partenaires et mes clients comprennent beaucoup mieux les choses comme ça. Et ils ont beaucoup moins peur, moins d'appréhension.
Hélaine Lefrançois : Ça peut nous arriver d'être mal à l'aise avec des mots anglais qu'on est censés utiliser, et c’est à nous de trancher. Dans sa situation, Laura a dû arbitrer toute seule et trouver une solution pour utiliser un équivalent français.
Mais pour comprendre si on pourrait faire autrement, j’ai envie de faire un détour par le Québec, un endroit où cette question des anglicismes est encore plus prégnante qu’en France. Et en l’occurence, si Laura vivait au Québec, les institutions publiques se seraient chargé de cet arbitrage pour elle, bien avant qu'elle ait à se poser la question.
Julie Neveux : En fait, au Québec, la donne est très différente. Je ne dis pas que c'est pas souhaitable d'avoir une politique gouvernementale très réactive et que le peuple suit. Mais ce qui est sûr, c'est que au Québec, il y a l'Office québécois de la langue française qui réagit très, très vite et qui propose tout de suite des mots. Par exemple, on dit pas spoiler, on dit divulgâcher, et la population suit majoritairement parce qu'elle est informée très tôt, c’est une politique plus réactive au Québec.
Hélaine Lefrançois : En France, il existe bien une institution qui détermine la politique linguistique : c'est la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Mais elle n'est pas aussi réactive que son équivalent québécois. Et quand les mots commencent à se répandre dans le langage courant, c'est compliqué de changer les habitudes.
Il y a tout de même une loi qui régit l'usage des mots anglais, notamment en entreprise. C’est la loi Toubon et elle date de 1994. Le Code du travail a été modifié par trois de ses articles : si on s'en tient à la loi, les offres d'emploi, contrats, accords et convention, règlements intérieurs et plus largement tout document "dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail", doivent être rédigés en français. S'il n'y a pas de traduction, le mot anglais doit être explicité.
Des entreprises ont été sanctionnées pour ne pas avoir respecté cette loi. C'est le cas de General Electric Medical Systems, Europe Assistance, Nextira One, qui imposaient des logiciels et des documents de travail en anglais à des salariés français. Les syndicats y prêtent attention parce qu’ils estiment que la généralisation de l'anglais en entreprise peut être discriminante et mettre en difficulté des salariés qui ne parlent pas anglais.
Mais cette loi permet surtout de régler des contentieux qui concernent des documents tout en anglais. Elle n'a pas d'effet dissuasif sur l'usage des anglicismes à l'oral, et même à l'écrit.
Quand on regarde des offres d'emploi sur des sites de petites annonces, on trouve plein d'offres avec des intitulés de poste en anglais comme Data analyst, Customer operations manager, Business developer sales…
En théorie, ces offres ne respectent pas la loi Toubon. Mais en pratique, personne n'engage de poursuites judiciaires. Tant que les missions sont clairement expliquées dans la fiche de poste, les anglicismes sont tolérés. Dans le contexte du travail, la loi Toubon sert avant tout à défendre les droits des salariés, plus qu'à protéger la langue française.
Si au Québec, les institutions accordent plus d'importance à la préservation de cette langue, c'est parce qu’il y a un fort enjeu identitaire, bien plus qu’en France.
Julie Neveux : Et donc, au Québec, il y a non seulement des autorités linguistiques plus présentes qu'on entend, plus audibles. Et puis, il y a aussi cet enjeu, pour le coup très nationaliste, très identitaire, qui est qu'au Québec presque la seule valeur culturelle qui les différencie les Québécois de leurs voisins. Ce sera la langue. Nous il y a tellement d'autres valeurs culturelles, voyez la nourriture, bien sûr, mais d'autres qui font qu'on ne se sent pas menacé dans notre identité. Il y a moins d'enjeux dans la langue, même s'il y en a encore quelques uns, puisque voyez qu'il y en a beaucoup qui critiquent et qui se sentent menacés aussi. Mais la menace, en tout cas, est perçue comme une réalité géographique beaucoup plus prégnante au Québec.
Hélaine Lefrançois : Il n'empêche qu'en France aussi, les pourfendeurs des anglicismes sont réellement inquiets pour l'avenir de la langue française.
Mais Julie Neveux m’a dit quelque chose là-dessus qui m’a beaucoup rassurée. Ce n'est pas parce qu'on se laisse séduire par quelques anglicismes que le français va disparaître. C'est une langue vivante, donc par définition elle n'est pas figée. Comme l'anglais, elle évolue et incorpore des mots étrangers. En fait, les deux langues ont toujours beaucoup échangé. C'est amusant de voir que des mots soi-disant anglais viennent en réalité du français.
Julie Neveux : Vous savez les deux tiers, enfin, il y en a qui disent la moitié d'autres les deux tiers, du vocabulaire anglais vient du français, par la conquête anglo normande en 1066 de Guillaume le Conquérant, donc, en fait, bien sûr c'est pour ça que je suis toujours réticente à combattre les anglicismes sous l'angle national, parce que parce que c'est absurde, il suffit de regarder le passé et l'histoire de la langue pour voir que le mot anglais une fois sur deux vient du vieux français, qu'au fond, les deux viennent du latin finalement.
Hélaine Lefrançois : Manager, par exemple. On a complètement francisé sa prononciation, mais c'est un anglicisme. Sauf que le terme anglais vient de l'italien maneggiare, qui porte en lui le mot mano, la main, qui vient lui-même du latin manus…
Les anglicismes font partie de notre manière de parler et de penser. Au travail, on n'a pas toujours le temps de peser chacun de nos mots. Ce n'est donc pas un drame si on ne peut pas s'empêcher de dire "meeting" à la place de "réunion", par automatisme.
Ce qui pose surtout problème, c'est quand les anglicismes deviennent une barrière excluante et brouillent le message, que ce soit volontaire ou pas. Donc c'est important de garder ça en tête et de s’adapter à son interlocuteur ou son interlocutrice, comme Laura avec sa clientèle.
Camille Maestracci : Travail (en cours) est un podcast de Louie Media. Si vous souhaitez nous raconter votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello@louiemedia.com
Cet épisode a été tourné et écrit par Hélaine Lefrançois. Louise Hemmerlé est chargée de production. L’épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. Anaïs Dupuis est responsable de production, et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounoua est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.
Travail (en cours), c’est un jeudi sur deux. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l’habitude d’écouter vos podcasts : Deezer, Apple podcast, Spotify, Soundcloud. Et si l’épisode vous a plu, n’hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louie : Emotions, Injustices, Passages. À bientôt.