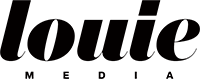Retranscription - Culpabilité: y a-t-il une bonne dose avec laquelle on peut vivre ?
Adélie Pojzman Pontay : Avant que vous ne plongez dans cet épisode d'Émotions, je voulais vous prévenir qu'il aborde des sujets difficiles. Nous allons parler d'automutilation, de meurtre et de violences sexuelles. Assurez vous d'être prêt à entendre parler de ça et préservez peut être les jeunes oreilles autour de vous.
Est ce que ça vous arrive que la culpabilité vous ronge comme de la rouille, lentement ? Est ce que vous ressentez parfois le poids de la culpabilité sur votre poitrine ou sur vos épaules ? Vous avez oublié de répondre à un mail ou un texto, et plus vous attendez, moins vous trouvez le courage de le faire.
Vous avez bousculé quelqu'un dans le métro ce matin. Vous avez oublié de souhaiter son anniversaire à un pote ou à votre grand mère. Mais peut être avez vous aussi d'autres souvenirs qui vous crispent encore tellement vous vous êtes sentis coupables. Des histoires soigneusement rangées dans une boîte dans votre tête avec l'inscription « Attention, danger! »
Vous avez peut être poussé Quentin dans la cour de récré en primaire et il s'est cassé le poignet. Ou quand vous aviez 15 ans. Vous avez dit des choses vraiment cruelles à votre mère pendant une engueulade d’ado.
Il a peut être d'autres choses qui vous hantent, des choses plus graves, un ou une ex envers qui vous vous êtes vraiment mal comporté.e ou même un accident dont vous êtes responsable. Est ce que c'est normal d'éprouver autant de culpabilité quand on réouvre la boîte de nos actions passées ? Est ce qu'on peut arrêter de penser à ce moment où on a fauté, ou est-ce que c'est nécessaire de continuer à se sentir coupable, des années plus tard ?
J'ai essayé de savoir s'il y avait une bonne dose de culpabilité avec laquelle on pourrait vivre au quotidien.
Pour y réfléchir, j’ai deux histoires à vous proposer, celle d'une femme qui culpabilise tout le temps pour des choses qui peuvent paraître dérisoire ou anodines, et celle d'un homme qui a commis quelque chose de terrible et qui a dû apprendre à vivre avec son passé. Je m'appelle Adélie Pojzman Pontay.
Bienvenue dans Emotions.
Mathilde Truong : J’ai ma petite amie qui est venue passer le week end avec moi et qui avait très envie de marrons chauds et c'est la période, donc j'ai acheté des marrons. Et en fait, il se trouve que c'était des mauvais marrons et donc ils étaient tous pourris. En fait, si on n'avait pas un à sauver et je m'en suis voulu alors que je pouvais rien, ils étaient pourris et je ne pouvais pas les tester dans le magasin et je m'en suis voulue énormément.
J'ai envie du coup de refaire et de lui reprendre des bons et de les tester avant. Ou j'en sais rien, des les acheter ailleurs.
Adélie Pojzman Pontay : Cette personne qui culpabilise pour des marrons pourris, c'est Matilde Truong. Elle a 19 ans et elle est arrivée à Paris il y a quelques mois pour son premier job. Mathilde est quelqu'un qui se sent énormément coupable de tout, tout le temps. Même sa soeur Juliette, qui a 14 ans, me l'a confirmé.
Juliette : Tout le temps. Rien que quand quelqu'un aborde le sujet de la culpabilité, je lance un regard à ma soeur qui veut dire, sens toi visée parce que là, ça va parler de toi.
Adélie Pojzman Pontay : Du coup tu la fait culpabiliser de culpabiliser pour qu'elle arrête de culpabiliser ?
Juliette : Ouais *rires*, exactement !
Adélie Pojzman Pontay : Mais la réalité, c'est qu'éprouver de la culpabilité tout le temps, pour tout et n'importe quoi, comme c'est le cas de Mathilde Truong, c'est vraiment difficile à vivre au quotidien.
Mathilde Truong : Ça peut me pousser à faire ou à ne pas faire des choses, à agir d'une manière ou d'une autre, de manière à essayer de faire les choses le mieux possible, a essayer d'agir le mieux possible. C'est quelque chose qui me fait beaucoup ruminer sur mes actions et revenir dessus. Y songer à nouveau et me demander à quel point j'aurais pu mal agir, à quel point certaines conséquences néfastes pourraient être de ma faute.
Adélie Pojzman Pontay : Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Mathilde a toujours ressenti beaucoup de culpabilité. La moindre erreur lui semblait irréparable, comme cette fois où elle a cassé un verre.
Mathilde Truong : Quand je remplissais de la vaisselle le soir et que je faisais tomber un verre et que je le cassait, je me mettais à pleurer mais jusque tard, à 9 ans, un enfant pleure plus pour ça. Et moi, je pleurais parce que parce que j'avais cassé un verre, c'était grave et que c'était une erreur.
Adélie Pojzman Pontay : Peut être étais-ce parce que la famille de Matilde avait des attentes très importantes vis à vis d'elle et de ce qu'elle était censée accomplir. En tout cas, elle avait toujours peur de ne pas coller à cette image de petite fille sage et brillante, de ne pas correspondre à ce qu'on espérait d'elle et de ne pas être parfaite. Mathilde était pourtant loin d'être un cancre à l'école. Elle a sauté trois classes et a eu son bac à 15 ans. Mais figurez vous qu'elle repense encore souvent à ce 8 qu'elle a eu en SVT en classe de troisième.
Mathilde Truong : J'ai foiré. J'ai 8 et en fait je le vis encore mal et si j'y réfléchis, je me souviens qu’en CM2, Il y a un contrôle de maths sur les fractions où j'ai eu 9 et je me dis mais j'ai 19 ans, je devrais pas me souvenir de ça et je devrais pas continuer à m'en vouloir pour avoir pas compris une leçon une fois. Et pas réussi une évaluation une fois.
Adélie Pojzman Pontay : En grandissant, cette culpabilité a pris des proportions vraiment malsaines et a eu des conséquences graves sur la vie de Mathilde. Pendant des années, Mathilde s'est auto-mutilée.
Mathilde Truong : J'avais des gros problèmes de gestion de la culpabilité et je me scarifiais et je me suis fait subir ça un bon nombre de fois et ça a duré plusieurs années. Mais il y avait une grosse forme de punition là dedans et, de dire en fait, t’en vaut pas la peine et tu fais mal les choses donc fais toi du mal et j'ai beaucoup fonctionné comme ça pendant longtemps.
Adélie Pojzman Pontay : Constamment ressentir le besoin de se punir pour soulager sa culpabilité ça a un nom.
Aurélien Graton : : Cet effet a été baptisé de façon un peu anecdotique. L'effet Dobby,
Adélie Pojzman Pontay : C'est Aurélien Graton qui m'a expliqué ça.
Aurélien Graton : Je suis enseignant chercheur à l'Université Savoie Mont Blanc, plus exactement maître de conférences en psychologie, psychologie sociale et psychologie de la prévention.
Adélie Pojzman Pontay : L'effet Dobby, c'est un nom presque dérisoire par rapport à la souffrance de Matilde.
Aurélien Graton : C'est le nom de l'elfe dans Harry Potter, qui est en permanence en train de s'infliger des blessures. Parce que c'est un peu cette idée que si je ne peux pas réparer ou si je suis dans l'impossibilité matérielle de réparer et que j'éprouve quand même de la culpabilité. Eh bien, je vais avoir un comportement, je vais m’infliger des blessures, j'ai m'infliger du mal pour me punir finalement.
Adélie Pojzman Pontay : Chez Mathilde Truong, c'est une torture quotidienne à la fois psychologique et physique.
Aurélien Graton : Si vous avez en permanence la sensation d'avoir causé du tort à autrui en permanence, la sensation d'avoir enfreint les normes morales, ça va derrière. être plutôt problématique dans le sens où vous n'allez pas pouvoir toujours réparer. Ou alors, si vous le faites ou vous faites plus que ça, vous pensez plus qu'à ça. Mais si ça devient permanent, on sait que c'est problématique pour le bien être, pour la santé mentale.
Adélie Pojzman Pontay : C'est terrible parce qu'elle a l'impression de devoir en permanence réparer des torts qu'elle infligerait à autrui. Ce désir de réparation est irrépressible et monte avec le besoin de se violenter elle même.
Mathilde Truong : C'est étouffant. Il y a une sensation d'urgence. C'est urgent. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que ça sorte. Il faut que ça s'arrête sur le moment. Et c'est hyper compliqué à gérer parce que justement, tu ne sais pas ce qui se passe en toi. T’as l’impression que tous les malheurs du monde sont de ta faute et que tout ce que tu fais, c'est mauvais et que tu mérites que de te faire du mal et donc c'est la seule manière d'obtenir une sorte de pardon de toi même. Pas vraiment pardon. Mais au moins, si tu a été punie, tu peux continuer à faire des choses parce qu'il y a une sorte de justice ou d'équilibre qui se rétablit.
Adélie Pojzman Pontay : Aurélien Graton m'explique qu'éprouvait trop de culpabilité, comme c'est le cas de Matilde, ça a des conséquences en termes de santé mentale et c'est souvent associé à la dépression ou à l'anxiété généralisée. Car justement, on ne peut pas éternellement réparer quelque chose, a fortiori qu'on n’a pas fait sans tomber dans des comportements nocifs. Si la culpabilité peut avoir de telles conséquences sur la santé mentale, c'est aussi lié à la nature même des émotions.
Aurélien Graton : Quand on éprouve une émotion, ce n'est pas censé durer éternellement une émotion. Une émotions ce sont des sensations qu'on a qui sont censées répondre à une problématique, à un besoin sur le court terme.
Adélie Pojzman Pontay : Éprouver une émotion sur le long terme. Ça a des conséquences délétères.
Pour les marrons, tu t’en es voulue combien de temps ?
Mathilde Truong : Je m'en veux encore. La différence, c'est que maintenant, par rapport à avant, j'en fais plus un cas, c'est plus aussi dramatique et surtout, je le sais. Je sais que je m'en veux et je sais que je vais probablement m'en vouloir longtemps et que peut être que c'est un truc où pendant 5 ans, à chaque fois que je verrais des marrons je penserais à ça. J'essaie de fonctionner sur l'autodérision pour moi même, me rendre compte à quel point c'est bête, on a bien rigolé et c'était un moment marrant, mais oui, je m'en veux encore et je m'en voudrais certainement encore un petit moment.
Adélie Pojzman Pontay : Mathilde est suivi depuis plusieurs années par des thérapeutes et elle travaille avec eux à trouver une manière d'atténuer sa culpabilité. Il y a quelques mois, elle a décidé d'arrêter de se scarifier. Son entourage l'aide avec bienveillance et avec patience.
Mathilde Truong : J'ai décidé d'arrêter de laisser la culpabilité me limiter. J'ai décidé d'arrêter de me punir parce que je me sens coupable pour des choses qui, en plus, ne sont pas toujours de mon fait. Et j'ai essayé d'arrêter de me condamner à cause de ça et plutôt de voir les erreurs et les échecs comme la possibilité d'apprendre et d'aller plus loin au lieu de quelque chose d'immuable et de grave et de sans issue.
Adélie Pojzman Pontay : Sur une échelle de 0 à 100, tu penses que t’en éprouves combien de culpabilité ?
Mathilde Truong : J’ai été très clairement à 100. Je pense que maintenant, je suis plus sur 65, 70 un truc comme ça je dirais. Je suis en train de doucement réduire,
Adélie Pojzman Pontay : T’aimerais arriver à quel chiffres ?
Mathilde Truong : Je ne sais pas parce que tant que j’y serai pas, je n'aurai pas commencé. Et donc, je saurais pas si c'est ça qui me convient.
Adélie Pojzman Pontay : Donc, ce qu'on sait grâce à Mathilde Truong et Aurélien Graton, c'est que trop de culpabilité, ce n'est jamais sain pour un individu. En revanche, ce que j'ai appris, c'est que pour la vie en société, un minimum de culpabilité est malgré tout vital. Car Aurélien Graton m'a expliqué que la culpabilité, aussi désagréable soit elle, avait une fonction. Elle existe pour réguler nos rapports sociaux.
Aurélien Graton : Comment ça se passe? Ça se passe dans le sens où elle va vous servir d'indice, vous servir d'alerte que vous avez enfreint, justement, une norme morale. Que vous avez causé du tort à autrui est la culpabilité est en quelque sorte une activation qu'il faut restaurer une relation qu'il faut réparer le tort que vous avez quand vous avez commis. Et cela va permettre, au niveau sociétal, au niveau du groupe, de réguler les relations sociales les unes entre elles.
De telle sorte que si une personne sent qu'elle a causé du tort à une autre, qu'elle a fait du mal. Le fait de ressentir de la culpabilité va l'aider à aller réparer le tort qu'elle a causé.
Adélie Pojzman Pontay : La culpabilité, c'est ce qui nous permet de vivre en société, de ne pas être des personnes horribles avec les autres. Ne pas éprouver de culpabilité, c'est une pathologie psychiatrique comme la psychopathie ou la sociopathie. Et comme l'explique Aurélien Graton, si la culpabilité est un indice, on a fait du mal à quelqu'un. C'est aussi pour engendrer une action qui nous sortira de ce mauvais pas.
C'est là qu'intervient la réparation, la culpabilité et la volonté de réparation, ça va ensemble comme les deux faces d'une même pièce. La culpabilité, c'est donc quelque chose de nécessaire et de positif. Ça nous pousse à bien nous comporter, à nous racheter et à faire mieux la prochaine fois. Et pour atteindre ce minimum vital de culpabilité, il faut parfois du temps pour Jean-Rémi Sarraud. Il a fallu quatre ans.
GPS : Tourner à gauche, puis vous arriverez à destination.
Adélie Pojzman Pontay : Quatre années qui ont séparé le moment où il a tué de celui où il a commencé à éprouver de la culpabilité.
GPS : Vous êtes arrivé.
Adélie Pojzman Pontay : Jean-Rémi a une cinquantaine d'années aujourd'hui, de longs cheveux poivre et sel en catogan et un anneau à l'oreille gauche. Il m'accueille avec un grand sourire dans sa maison en pleine campagne bretonne, au milieu des champs. A l’intérieur, c'est chaleureux et confortable. Il y a un poêle qui chauffe toute la pièce, une collection de DVD pour enfants autour de la télé, du matériel d'aquarelle sur un coin de table.
Adélie Pojzman Pontay : Difficile de faire le lien avec le Jean-Rémi de 21 ans que j'ai vu en photo dans des coupures de journaux des années 80.
En décembre 1983, il a été arrêté avec deux complices, Valérie Subra et Laurent Hattab, pour le meurtre de deux hommes. La Presse les appelle alors le trio diabolique. Guy Debord lui parlera plus tard de sinistre innocence. A l'époque, Jean-Rémi est un gamin des rues. Les deux autres sont un couple qui fréquente les boîtes et les restaurants branchés, et tous les trois en seraient fou de faire fortune aux Etats-Unis.
Pour ça, leur plan, c'est de dévaliser des hommes riches. Valérie doit les choisir dans des soirées mondaines autour des Champs Elysées, se faire inviter chez eux et laisser la porte entrouverte pour que ses complices s'introduisent ensuite sur les lieux. Il espère trouver des coffres forts remplis de billets et de lingots d'or. Ça rate dès le premier coup, la victime numéro 1, Gérard Le Laidier, essaye de résister, de négocier, Jean-Rémi et Laurent le tabasse et se rendent compte qu'il n'y a pas grand chose à voler dans l'appartement.
Il ne voit qu'une seule solution pour ne pas se faire dénoncer. Jean-Rémi Sarraud tue Monsieur Le Laidier de six coups de couteau à la gorge et au torse. Puis les trois complices vont danser en boîte et dépensent l'argent trouvé en bouteilles de champagne. Dans le noir, personne ne remarque les taches de sang sur leurs vêtements. Dix jours plus tard, le trio recommence. Il s'attaque cette fois à Laurent Zarade 29 ans, un commerçant du sentier qui a bien réussi.
Même stratagème. En 2010, Jean-Rémi Sarraud témoigne dans Faites entrer l'accusé. Le journaliste Christophe Hondelatte lui demande :
Christophe Hondelatte : Si on réfléchit bien. Valérie vous a balancé. Vous vous avez balancé Laurent. En fait, vous n'aviez strictement aucun plan. Vous n'aviez pas préparé l'hypothèse d'une arrestation ?
Jean-Rémi Sarraud : Non.
Adélie Pojzman Pontay : A 21 ans, Jean-Rémi est donc condamné à 20 ans de prison pour le meurtre des deux hommes.
Jean-Rémi Sarraud : Le début de l'incarcération, le sentiment de la culpabilité, en tout cas chez moi, c’est pas ce qui est arrivé en premier.
Adélie Pojzman Pontay : Vous ressentirez pendant ces premières années, du coup ?
Jean-Rémi Sarraud : Je me suis demandé si il fallait me suicider ou continuer à vivre pour essayer de faire autre chose. Parce que je savais que la peine que j'allais prendre, j'allais au moins passer une vingtaine d'années en prison. Mes réflexions étaient plus là dessus.
Adélie Pojzman Pontay : Si vous êtes du genre à culpabiliser pour un mot déplacé ou pour un morceau de verre mis à tort dans la poubelle recyclage, vous vous demandez peut être comment c'est possible ? Comment on peut tuer quelqu'un et ne pas être dévoré par la culpabilité ? Aurélien Graton, le chercheur en psychologie, explique que la culpabilité, c'est une émotion qu'on dit secondaire, c'est à dire qu'elle n'est pas innée chez l'homme. Elle est construite.
Aurélien Graton : Alors la culpabilité, c'est une émotion qui apparaît sous deux conditions. La première condition, c'est d'avoir le sentiment d'avoir enfreint une norme morale. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir constitué des normes morales. Ça peut être par la famille, par l'apprentissage, par la société dans laquelle on vit. Et la deuxième condition, c'est que le fait d'avoir enfreint cette norme morale est causé du tort à une personne est causé du tort à autrui. Donc, si vous avez la sensation d'avoir causé du tort à quelqu'un et qu'en plus, ce tort a été causé par l'infraction, le fait de la violation d'une norme morale, là, vous allez éprouver de la culpabilité.
Adélie Pojzman Pontay : Abandonné à la naissance par sa mère, qui ne pouvait pas s'occuper de lui. Trimballé entre la DDASS et la maison de ses grands parents, puis à partir de ses 8 ans chez son père routier qu'il ne voit qu'une fois par mois. Jean-Rémi s'élève seul. Il lui manque à la fois la construction de ces normes dont parle Aurélien Graton et l'attention portée à l'autre.
Jean-Rémi Sarraud : Quand on grandit tout seul, quand on s'élève tout seul, quand on n'a pas cette sensibilité de l'autre, puisqu'on pense d'abord à soi, il faut qu'on pense d'abord à soi pour s'en sortir. Du coup, l’autre il vient que après.
Adélie Pojzman Pontay : Prendre en compte la souffrance de l'autre, intégrer que ce qu'on a fait est mal. Ce sont des éléments cardinaux pour assumer la responsabilité de ses actes. C'est Magali Bodon-Bruzel qui m'a parlé de ça.
Elle est psychiatre et chef de pôle à l'hôpital psychiatrique de la prison de Fresnes.
Magali Bodon-Bruzel : C’est un hôpital psychiatrique pour personnes détenues, si vous voulez. Il y a 100% de détenus et ils restent le temps de l'hospitalisation psychiatrique.
Adélie Pojzman Pontay : Elle travaille principalement avec des gens qui ont commis des crimes sexuels, des crimes différents de ceux commis par Jean-Rémi, mais qui impliquent également de réfléchir à la culpabilité.
Magali Bodon-Bruzel : Moi, mon métier, ça consiste à prendre en charge des personnes qui ont commis des actes et pour une partie de mon travail et une partie de mon équipe, travailler spécifiquement sur l’acte.
Adélie Pojzman Pontay : L'acte dont elle parle. C'est donc le crime que les détenus ont commis.
Magali Bodon-Bruzel : En général, lorsque l'on travaille avec des auteurs qui sont d'accord pour travailler, il y a une reconnaissance minimale de l'acte et de l'appropriation de l'acte et de la culpabilité. La posture de dire j'ai rien fait ou « je l'ai fait, mais j'en ai strictement rien à foutre. C'est bien fait pour sa gueule », on l’a mais là, c'est en soi pénalement ordonnés. C'est des gens qui viennent « bah docteur. Je viens parce que je suis obligé, mais de toute façon, elle était d'accord.
Je ne vois pas pourquoi on continue. J'ai été condamné et elle fait ça pour l’argent. »
Bon, alors là, on voit bien que l'acte n'est pas reconnu. Il y a zéro culpabilité. Il y a un dénigrement de la victime, etc. Et on commence mal. J'ai un peu envie de dire en termes de soins, on va voir que ça va pas forcément évoluer beaucoup.
Mais souvent, il y a une reconnaissance minimale, une culpabilité minimale et notre travail ça consiste à la faire évoluer jusqu'à ce que, on l'espère, la totalité de l'acte soit reconnu.
La totalité de la souffrance de la victime et une culpabilité viennent d'émerger.
Adélie Pojzman Pontay : Et ce n'est pas gagné d'avance. Car pour s'autoriser à commettre un crime sexuel, par exemple pour s'autoriser à transgresser la norme morale, ils se mettent en place dans le cerveau de l’agresseur toute une série de pensées qui évacue précisément la responsabilité et la culpabilité. Magali Bodon-Bruzel définissi ça comme des distorsions cognitives.
Magali Bodon-Bruzel : Les distorsions cognitives les pensées que peuvent avoir ses sujets violeurs, agresseurs à leur insu, parce que ce n'est pas des pensées conscientes. Mais ce n'est pas des conseils inconscientes non plus de prêts, schémas de pensée qui permet que l'acte puisse avoir lieu.
Ce sont des pensées permissives et souvent des pensées soulageantes. Les pensées permissives, c'est de dire aux patients « bon, quand vous avez fait des attouchements sur les enfants dans les parcs, que c'est comme ça que vous commettiez les faits essayer de comprendre ce que vous avez pu vous dire pour vous dire que finalement, vous vous autorisez à le faire au regard justement des aspects moraux et des aspects de culpabilité. Qu'est ce que vous vous êtes raconté à vous même ? »
On arrive peu à peu à faire émerger ce genre de chose qui peut être « bah de toute façon, c'est pas grave puisque juste une caresse comme ça, c'est pas grave. » Ou « C’est un garçon de 12 ans, j'ai bien vu que il avait une excitation sexuelle. Donc finalement, lui aussi, ça a été bien pour lui. » Ou bien, « Bah, de toute façon, je fais ça juste une fois et après, c'est fini » ou bien « De toute façon, comme je lui ai dit de pas le dire, personne le saura. »
Vous voyez que tout ça, c'est des croyances parce que aucune n’est vraie. Ça, c'est des éléments, par exemple, qui visent à mettre de côté les aspects de culpabilité, c'est à dire de là où la morale doit arriver en disant « Mais qu'est ce que tu es en train de faire? C'est vachement mal. »
Adélie Pojzman Pontay : Confronter l'agresseur à l'irrationalité de ses pensées. C'est une des techniques thérapeutiques qui permettent au docteur Bodon-Bruzel et à son équipe de travailler avec les détenus sur la reconnaissance de l'acte.
Cette confrontation à son propre discours, fonctionne particulièrement bien dans les thérapies de groupe.
Magali Bodon-Bruzel : Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas ça en individuel, donc là où un agresseur pourra expliquer quelque chose comme encore une autre pensée permissive : « Bah de toute façon, c'est vrai que bon maintenant elle a porté plainte contre moi, ma belle fille mais bon, elle disait pas non, moi, je pensais qu'elle était d'accord. Je me demande même si elle n'était pas d’accord ». Si moi, je réponds en tant que thérapeute: « écoutez bien sûr que non, elle n'était pas d’accord. Elle avait 13 ans, elle osait pas. », c'est une chose.
Mais si c'est un auteur qui répond parce qu'on est dans le groupe, un autre agresseur qui dit « arrête de dire ça, c'est pas vrai. Moi, je sais bien maintenant qu'elle n'était pas d'accord. Toi, tu es prévenu, t'es pas encore allé au procès, mais moi, au procès, je les ai vus, mes victimes. Et bien sûr qu’elles n’étaient pas d'accord. Tu dis des conneries, c’est des trucs que tu te racontes à toi même. A 13 ans, tu oses pas dire non, surtout à ton beau père. »
Vous voyez bien que l'impact, il sera complètement différent.
Adélie Pojzman Pontay : Faire émerger la culpabilité est un élément du processus sur lequel Magali Bodon-Bruzel travaille avec les détenus.
Magali Bodon-Bruzel : Le but n'est pas de faire émerger la culpabilité, ce n'est pas un but ultime dans le soin. Ça fait partie des différentes composantes qui montrent que le sujet est en train de progresser.
Adélie Pojzman Pontay : Il y a plusieurs autres éléments qui interviennent dans ce processus.
Magali Bodon-Bruzel : Alors, j'attire votre attention sur la différence entre culpabilité, honte, remords. Ce sont pas les mêmes termes, mais ça correspond pas au même produit psychique.
La honte, c'est un sentiment diffus de malaise qui apparaît lorsque le sujet repère que il y a un regard sur ce qu'il a fait et sur lui. C'est le regard de l'autre qui entraîne la honte. Le regret, c'est regretter l'acte, mais ça peut être un regret froid. « Oui, finalement, il y a une bagarre, Il y a eu un mort, je regrette. »
Le remords ça renvoie à des aspects de mise en place des émotions. C'est à dire, il y a un regret : « Ça n'aurait pas dû être comme ça. » Mais il y a des aspects d'émotion et d'empathie. C'est à dire, on a fait du mal à la victime : « Je regrette à la fois l’acte, mais je regrette ce que j'ai commis parce que j'ai fait du mal. »
Alors la culpabilité, c'est c'est plus précis, ça cible, si vous voulez vraiment, pas la question de la compassion c'est à dire avoir mal pour la victime, mais repérer que ce qui a été commis lui donner une connotation morale : « c’est mal. »
Donc, la culpabilité, c'est un outil et c’est plus exactement un indicateur.
Adélie Pojzman Pontay : Chez Jean-Rémi, c'est en décembre 1987, juste avant le début du procès, que ce sentiment de culpabilité va commencer à apparaître.
A l'époque, ça fait quatre ans qu'il est en prison et il attend toujours son procès. Il est incarcéré à la prison de la Santé, à Paris, dans une cellule de deux mètres sur 4. Quand il tend les bras à l'horizontale, il touche les murs.
Dans les premières années de son incarcération, Jean-Rémi passe beaucoup de temps au secret, comme on dit, il ne voit jamais les autres détenus.
Il ne voit jamais personne, si ce n'est celui qui lui apporte son repas. Il reste dans cette pièce 22 heures par jour, ses deux heures de promenade quotidienne, il les fait seul, dans une petite cour triangulaire du type qu'on nomme les cours camembert.
Il ne reçoit presque pas de visites, car Jean-Rémi Sarraud n'a pas de famille. Il est donc extrêmement isolé. Jusqu'au jour où il reçoit des lettres.
Jean-Rémi Sarraud : Ça a commencé en décembre 87.
Adélie Pojzman Pontay : Au cours de ses premières années en prison, Jean-Rémi Sarraud est en contact avec une personne, Michel de Truchis.
C'est un prêtre qu'il a connu avant les faits, quand il habitait à Saint-Mandé, en région parisienne.
Derrière l'église de Saint-Mandé ya un square et donc c'était notre lieu, le soir, on se retrouvait là y’avait le prêtre qui était là tous les soirs, il regardait à travers son petit truc et tac quand il voyait qu'on était là, il sortait pas. Et un jour, un jeune prêtre est arrivé et il a ouvert la porte. Il a vu qu'on était là. Il est venu discuter avec nous.
Adélie Pojzman Pontay : Jean-Rémi et Michel, le prêtre, s'étaient liés d'amitié. Une fois Jean-Rémi en prison, Michel est l'unique personne qui lui rend visite et qui lui écrit.
Et c'est lui qui s'est organisé pour que Jean-Rémi reçoive du courrier. C'était peu de temps avant Noël. Le procès allait commencé en janvier 88, juste après, donc.
Jean-Rémi Sarraud : Je recevais pas de courrier donc voilà, et là subitement quand on vous tend un paquet de lettres, j'ai dû me mettre à table, regarder chaque lettre, prendre le temps de les lire. Il y avait des dessins, des fois sur les enveloppes. Je me rappelle de ça. C'est un moment, c'est un moment.
Adélie Pojzman Pontay : Qu'est ce que vous ressentez en lisant ces lettres?
Jean-Rémi Sarraud : De l'étonnement d'abord, de la joie, c'est une surprise, c’est un grand moment. Ces lettres, on les relit. Ça reste quelque chose d'important.
Adélie Pojzman Pontay : C'est en lisant ces lettres de soutien où des inconnus lui parlaient de fête de Noël en famille, que Jean-Rémi commence à prendre conscience des conséquences concrètes de son crime.
Plus seulement des conséquences du crime sur sa vie, comme d'être incarcéré pendant vingt ans mais sur les autres.
Non seulement tuer un homme, mais aussi détruire une famille. Il pense aux personnes qu'il a tué qui ne passeront plus Noël avec leur famille et à ses familles où il manquera désormais toujours quelqu'un.
Ces lettres, qu'il reçoit au cours de ce mois de décembre 1987 lui permettent de créer, en lien avec d'autres personnes, un lien qu'il n'avait jamais créé auparavant.
Jean-Rémi Sarraud : J'ai pris conscience de ce qui se passait dehors, de la vie réelle grâce à ces lettres, grâce à ces courriers. J'ai pris conscience de toutes ces choses, de toutes ces relations humaines qui ne faisaient pas partie de ma vie, qui n'ont pas fait partie de ma vie. Donc, là où je prenais conscience de tout ça.
Adélie Pojzman Pontay : En janvier 88, c'est le début du procès.
Jean-Rémi Sarraud : Vous savez que vous allez passer des sales heures parce que vous avez fait quelque chose de sale.
Adélie Pojzman Pontay : Et un fait, le marque particulièrement pendant les dix jours d'audience.
Jean-Rémi Sarraud : La maman de la personne que j’ai tué est venue me prendre la main dans le box, ça, c'était un moment whaou. Tu peux pas oublier ça.
J'ai tué son fils à cette dame mais elle vient, elle me prend la main quoi. C’est un truc whaou.
Adélie Pojzman Pontay : A cette période, Jean-Rémi découvre donc la culpabilité. Sauf que la culpabilité, ce n'est pas une fin en soi. Il faut aller jusqu'à une réparation, car quand la culpabilité émerge chez un individu, quel qu'il soit, elle va de pair avec un besoin de réparation.
C'est une émotion qui déclenche dans votre cerveau cette envie.
Aurélien Graton : Concrètement, cela veut dire que si, par exemple, j'éprouve de la culpabilité parce que pour une x ou y raisons, parce que j'ai croisé un SDF le matin, que je lui ai pas donné de pièce et que ça me rend un peu coupable, eh bien, je vais être plus rapide qu'une autre personne qui n'éprouve pas l'émotion de culpabilité pour repérer sur un passage clouté une vieille dame qui a du mal à traverser. Mon cerveau va finalement activer mon attention visuelle, activer mes muscles des yeux pour être plus rapide à détecter ce qui est autour de moi va me permettre de réparer.
Et c'est en ce sens que la culpabilité, on agit vraiment comme un déclencheur vers les vers la réparation. Ça va activer vos fonctions motrices, vos fonctions cérébrales dans le sens de cette réparation, y compris en vous rendant plus rapide pour détecter des indices autour de vous.
Adélie Pojzman Pontay : La bonne dose de culpabilité. Si tant est qu'il y en ait une, c'est celle qui atteste de votre intérêt pour les autres sans vous nier vous même, vous violentée vous même et qui vous pousse à faire ce que vous pouvez pour réparer l'acte commis qui est en adéquation avec ce que vous pouvez réparer.
Aurélien Graton : Qu'est ce que je peux faire pour réparer ? Comment est ce que je peux me comporter pour restaurer une relation ? Si, par exemple, j'ai causé du tort à quelqu'un. C'est ça qui va être caractéristique de l'émotion de culpabilité.
Adélie Pojzman Pontay : Réparer, ça peut passer par différentes choses. On peut présenter ses excuses. On peut aussi avoir un comportement qui montre qu'on cherche à mieux faire. C'est aussi en partie à ça que sert la peine de prison.
Aurélien Graton : Une des fonctions de la peine est de permettre cette réparation vis à vis de la société qu'il n'est pas possible si, par exemple, la victime est décédée ou si, par exemple, la victime est inaccessible ou autre.
Dans ces cas là, pour les criminels, il est important qu'il y ait une peine qui soit prononcée parce que cela va leur permettre de réparer alors que la victime n'est pas là.
MUSIQUE
Adélie Pojzman Pontay : La culpabilité donne lieu à un désir de réparation qui doit pouvoir s'incarner en un ou une série d’actes.
Qui doit en retour soulager au moins en partie la culpabilité et restaurer la relation abîmée. Il est là le cercle vertueux de la culpabilité, quand il permet d'aller vers un apaisement et non vers une plus grande violence comme c'est le cas pour Mathilde. Et parfois, cette volonté de réparation peut aussi s'incarner de manière symbolique. Magali Bodon-Bruzel m'a raconté l'histoire d'un ancien détenu qui était en prison pendant quinze ans pour viol.
Pendant sa peine, il a recueilli dans sa cellule un pigeon blessé et l'a soigné. À sa sortie. Il s'est mis à recueillir plein de pigeons et il est devenu bénévole pour une association qui s'occupait des oiseaux en ville. Magali Bodon-Bruzel m'explique que c'est peut être un acte symbolique de réparation.
Magali Bodon-Bruzel : Il m'a semblé qu'il cherchait à réparer des êtres fragiles et fragilisés et que ça pouvait être mis en miroir avec ce qui s'était passé dans sa propre histoire, à savoir que lui, il avait abîmé des personnes. Mais ce n'est pas lui qui me l'a dit comme ça. C'est mon interprétation à moi.
Adélie Pojzman Pontay : À défaut de pouvoir vraiment réparer, Jean-Rémi Sarraud explique que la culpabilité a été pour lui un moteur qui lui a permis d'aller de l'avant, de dépasser le crime qu'il avait commis à tout juste 21 ans.
En prison, il a lu beaucoup. Tout Balzac, tout Victor Hugo, Crimes et châtiments de Dostoïevski, deux fois avec l'aide d'un dictionnaire. Il a aussi travaillé pour l'INA à numériser des bandes sons d'archives, puis passé un BTS en informatique à la fin de sa peine.
Jean-Rémi Sarraud : Le juge m’avait dit voilà, « Si vous obtenez votre diplôme, vous êtes libéré." Du coup, j'ai obtenu le diplôme et voilà.
Adélie Pojzman Pontay : Jean-Rémi a trouvé un CDI. L'autre condition de sa libération après vingt ans de prison. Depuis la fin de son incarcération, il a aussi accepté de témoigner sur les faits pour, selon lui, « finir de payer sa dette. »
Aujourd'hui, il travaille comme informaticien. Il est marié. Il a un fils. Il vit dans cette jolie maison en Bretagne, où je l'ai rencontrée. Elle est en pleine campagne, entourée de moutons.
Jean-Rémi Sarraud : Souvent, les gens me demandent « est-ce que t’estimes que t’as payée ta dette ? » Mais c'est quoi comme dette ? T’as enlevé la vie de quelqu’un, qu’est ce que tu veux faire qui fasse que. « Ben non, je n'ai pas payé ma dette. Après il y a une justice. Il y a des lois. Je suis passé devant un tribunal, il m'a condamné à tantJ'ai fait cette peine. J'ai eu la chance de pouvoir sortir, refaire ma vie voilà.
Après est-ce que j'ai payé ma dette ? Ça dépend à qui on pose la question. Si vous vous posez la question des judiciaires on va vous dire que oui, parce que voilà, c'est terminé. Après, si on va interroger la famille des victimes, ils vont peut-être dire que « ben non ».
Alors c'est quoi avoir payé sa dette. C’est difficile de répondre à ça.
Adélie Pojzman Pontay : Aujourd'hui, vous ressentez encore de la culpabilité ?
Jean-Rémi Sarraud : Bien évidemment. Le doute ça aussi, ça nous permet d'avancer. Ce n'est pas une ligne droite, c'est en dents de scie. Y a des hauts et des bas. Il y a des moments. Voilà est-ce que toute ma vie j'aurais de la culpabilité d'avoir fait ça ?
A présent, je peux rien faire qui puisse qui puisse modifier ça. J’aurais beau devenir milliardaire, je pourrais donner des tas d'argent aux gens que ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien. Donc pfff est-ce que j'y pense, oui, ce que j'ai toujours de la culpabilité par rapport à ça, évidemment, est-ce que ça m'empêche de vivre ? Non.
Ça ne m'empêche pas d'avancer. Ça ne m'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas de construire, voilà.
Adélie Pojzman Pontay : Magali Bodon-Bruzel a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a autant de culpabilité que de crimes que d'individus et que surtout, la culpabilité n'est pas quelque chose de linéaire. Ce n'est pas une donnée constante avec laquelle on vit. Mais c'est une chose avec laquelle on apprend à vivre. On continue à certains moments, on y pense, d'autres non.
Magali Bodon-Bruzel : Comment vous dire? Le cheminement que je vois de la plupart des personnes que je prends en charge? C'est que à un moment donné, c'est comme si la vie était plus forte que la mort si vous voulez.
Que finalement, pour continuer, il faut bien, même si on accepte le fait que les faits étaient graves, même si la personne accepte que ce qu'il a commis, c'est mal, même si il prend la mesure où une certaine mesure des souffrances de la victime, à un moment donné, j'ai le sentiment que ces sujets font un choix de vie pour eux.
A la différence de faire un choix de mort pour eux, c'est un peu comme ça. Et donc finalement, ils s'autorisent à se construire une vie et à accepter qu'ils puisse avoir une vie où ils puissent finalement être heureux.
Jean-Rémi Sarraud : Quelle est la bonne dose de culpabilité, j'en sais rien moins que la bonne dose de culpabilité. Je pense qu'il faut pas trop. C'est comme quelqu'un qui a énormément de problèmes et qui reste la tête dans sa bassine à problèmes.
Si il relève pas la tête pour regarder ce qui se passe ailleurs, il faut qu'il ait le juste milieu de chaque chose, qu'il est juste milieu de la culpabilité.
Moi, je me dis que vu là où j'en suis aujourd'hui, je me dis que j'ai eu la bonne dose parce que j'ai pas sombré. J'ai pris conscience de ce que j'ai fait. C'était très important. C’est difficile de répondre à ça quoi.
Adélie Pojzman Pontay : Trouver la bonne dose de culpabilité, c'est peut être penser aux autres sans se laisser définir entièrement par un acte passé, c'est essayer de comprendre ce que l'on doit réparer. Pour qui ? Et si l'on est vraiment celui qui doit le réparer, comment ?
Magali Bodon-Bruzel : Une personne n'est pas réductible à son acte. C'est la différence entre l'être et l'avoir. « J'ai commis un acte, j'ai commis un meurtre, mais je ne suis pas forcément un meurtrier » Au moment des faits, oui, j'ai été un meurtrier. En tout cas, j'ai commis un meurtre, mais je ne vais pas avoir cette étiquette tout le temps. Il n'y a pas d'étiquette. Il y a un acte commis qu'il faut assumer. Qu'il faut comprendre qu'il faut traverser, qu’il faut réparer et accepter.
Vous venez d'écouter Emotions, un podcast de Louie Media.
Cette émission a été réalisée avec l'aide de Maud Benakcha. Gabriel Raman a participé à l'édition et Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. L'enregistrement, la création sonore et le mixage ont été réalisés par Jean-Baptiste Aubonnet, Claire Cahu et Nicolas Vair. Merci à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez écouter Emotions sur toutes les applications de podcasts comme iTunes ou Google Podcasts, par exemple, ainsi que sur YouTube, Spotify et Soundclound.
Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux @Emotions sur Facebook, Instagram et Twitter.