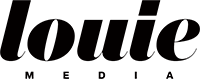Retranscription - Enfermé·e
INTRODUCTION
Générique
Maureen Wilson : vous rentrez de vacances, vous êtes avec des amis, peut être en train de boire un verre et vous leur raconter ce voyage dont vous revenez tout juste. Vous leur partagez les émotions qui vous ont traversé en déambulant dans cette ville. Vous leur parler de la beauté, des paysages... Et là, non, mais pas du tout. Un voisin de table a voyagé dans ce même endroit et n'a rien vu de semblable à vous. Une même expérience, mais des ressentis diamétralement opposés. C'est ce que raconte l'épisode d'aujourd'hui. Deux histoires parallèles. En 2022, on dirait qu'il s'agit de confinement, mais nous sommes à la fin des années 80, alors on parlera d'enfermement volontaire. L'enfermement de la spéléologue Véronique Le Guen et de l'écrivain Philippe Jaenada qui se rejoignent par la similitude de leurs expérimentations. Ce que vous allez entendre, c'est l'histoire du romancier dans sa propre voix et celle de Véronique Le Guen, à travers des extraits de son livre témoignage Seule au fond du gouffre, publié aux éditions Arthaud.
Ces extraits sont lus par Babeth de Firmas et cette histoire qui, avec le recul de ces deux dernières années, fera sûrement écho en vous, en positif ou non, selon le confinement que vous avez vécu, cette histoire est signée Jérôme Massela.
Je suis Maureen Wilson.
Bienvenue dans Passages.
Philippe Jaenada : Véronique le Guen a été extrêmement importante dans ma vie. C'est grâce à elle que je vis ce que je vis aujourd'hui. Mais en fait, je n'ai pas beaucoup pensé à elle, elle m'a simplement et involontairement, donné l'idée de l'enfermement. Je n'ai même pas lu son livre pendant 30 ans, je l'ai mise un peu dans un tiroir de ma mémoire, alors que sans elle, je ne sais pas où je serais. Donc en 1988, j'ai 24 ans, je ne fais pas grand chose, je travaille sur Minitel, je suis animateur, animatrice de Minitel. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'écris dans des journaux érotiques, juste pour gagner un peu d'argent facilement. Des fausses lettres érotiques pornos, même, dans les petits journaux genre Union. C'était pas Union mais de ce genre là qui sont uniquement à base de courrier des lecteurs, des lectrices. Je m'amuse beaucoup en apparence, je sors beaucoup, je picole, je vois des gens tous les soirs, je rentre à 5 h du matin. J'ai pas d'amis, vraiment, je n'ai pas d'amoureuse, je couche avec pas mal de filles d'une nuit. Je ne vois pas quelqu'un à qui je peux faire des confidences. J'ai mes amis d'enfance, mais que je vois presque plus. C'est l'âge ou à partir de 20 ans ou les chemins se séparent. J'ai une vie, une vie décousue, agitée, qui, en apparence et une vie joyeuse, une vie ou j'ai aucune responsabilité : je travaille quand je veux, quand je peux. Mais au cours de l'année 88, à partir du début de l'année 88, je me mets à faire des trucs bizarres. C'est juste pour m'amuser. Je fais des expériences. Je me dis que j'ai pas une vie très réglée, très contraignante, alors je peux faire des expériences. Par exemple, je fais l'expérience de ne pas me nourrir d'autre chose que de café au lait pendant un mois. Je fais l'expérience de ne pas manger pendant quatre ou cinq jours. Je fais une expérience, j'attends un mois ou deux, j'en fais une autre. Et puis ça s'accroît de plus en plus. J'ai fait cette nuit sans dormir avec une cigarette, je me brûlais tous les doigts, mais profondément, pour ne pas pouvoir utiliser mes mains. J'ai fait une semaine chez moi sans me lever. J'avais tendu des bandes de cassettes audio partout dans l'appartement, mais des centaines et des centaines pour ne pas pouvoir me tenir debout. Et donc j'ai rampé pendant une semaine chez moi... En fait, toutes les expériences que je faisais, c'étaient des expériences de privation. C'est-à-dire : je me prive de nourriture, je me prive de sommeil. Et puis, vers l'automne 88, ça a carrément pris des proportions très dangereuses. J'ai hébergé chez moi deux filles, prostituées, toxicomanes au dernier degré, vraiment toxicomanes et séropositives. Elles avaient toutes les deux le sida déclaré. Je faisais des expériences aussi à l'époque de conservation des matières vivantes ou pas dans des bocaux. Et donc j'ai voulu faire ça avec mon sang, donc je leur ai demandé de me prélever du sang avec leurs aiguilles. À l'époque, on ne changeait pas ses aiguilles tous les jours ni toutes les semaines. Et donc là, les filles ont dit mais non, t'es complètement fou, on a le sida. J'ai insisté elles tellement dans un état de défonce permanente que bon, elles n'ont pas résisté beaucoup. Si je ne prononce pas les mots, j'ai envie de me suicider. Je le fais quand même, c'est-à-dire qu'elles me plantent des aiguilles contaminées. Donc, elles partent. Là, je me dis “ça va pas”. Je pense, évidemment à l'internement psychiatrique, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. J'ai pas envie. Je ne me vois pas en blouse blanche avec des calmants, des choses comme ça. Je cherche, je cherche, et en regardant la télé, je vois : "c'est aujourd'hui que la jeune scientifique Véronique Le Guen sort de la grotte". Je ne savais même pas qu'elle était dans une grotte.
Véronique Le Guen : L'expérience hors du temps est une opération qui consiste d'abord à mettre un être humain en isolation temporelle totale. Cela signifie que cette personne ne verra pas le jour et qu'elle n'aura aucun repère de temps. Le premier but d'une telle expérience est d'étudier les rythmes biologiques et le sommeil humain qui vous apparaissent. En effet, ces rythmes ne seront plus régis par l'environnement succession jour et nuit, appelé aussi rythme nycthéméral terrestre de 24h, mais par les horloges internes de l'individu en question.
Philippe Jaenada : Cette fille a de la chance. J'aurais bien voulu faire ça moi aussi, m'enfermer pendant trois mois sous terre. Et puis, tout à coup, très naturellement, je me dis mais en fait, je peux. Et comme on est à la fin de l'année 88, tu me dis on va faire un truc bien carré, bien scientifique presque. Je vais commencer le 1ᵉʳ janvier 89 et je le ressortirez le 1ᵉʳ janvier 90. Ce sera une sorte d'électrochoc lent. C'est la chose la plus violente que je puisse faire, c'était me couper du monde.
Véronique Le Guen : Michel Siffre a choisi, en matière de laboratoire, un site naturel qui procure à moindre frais, toutes les conditions d'une chambre forte artificielle : température et taux d'humidité constants, isolation totale de la surface et du jour, réduction des stimuli sonores, visuels, olfactifs, etc.
Philippe Jaenada : Mes parents ont eu cette chance extraordinaire d'acheter un appartement à Paris, dans le 17ᵉ populaire, au métro Brochant. J'habite dans une rue : la rue Gauthey qui est quand même assez calme. On entend évidemment si une voiture passe ou si quelqu'un crie dans la rue, mais ce n'est pas la rue Lafayette, quoi. C'est quand même assez calme. Je suis au troisième étage, j'ai un appartement qui doit faire à peu près 45 mètres carrés. C'est un deux pièces avec un grand salon, une chambre normale. J'ai trois fenêtres, par exemple dans mon salon-salle à manger, une fenêtre dans ma cuisine et une fenêtre dans ma chambre. De l'autre côté, sur cour. Je ferme les volets et les rideaux.
Véronique Le Guen : l'entrée du gouffre a été artificiellement bouchée par un épais sas de bois duquel seule une trappe cadenassée donne accès au puits. En guise de communication, un téléphone relie le camp souterrain au laboratoire de surface. À dater de la mise hors du temps, il ne marchera qu'à sens unique jusqu'à la fin. C'est moi qui communiquerai toutes les informations au veilleur du haut.
Philippe Jaenada : Alors à l'époque il n'y a ni internet ni téléphone portable, mais je supprime mon téléphone fixe, l'enlève de chez moi, ma télé, ma radio, ma chaîne hi fi.
Véronique Le Guen : Par ailleurs, un micro a été installé dans ma tente qui doit permettre d'entendre jusqu'au moindre de mes soupirs.
Philippe Jaenada : Je m'étais fixé comme contrainte, un peu bébête, un peu ado, de ne pas ouvrir la bouche, de ne pas parler pendant un an.
Véronique Le Guen : La coupure du monde doit être la plus grande possible. Aucune nouvelle ne me sera jamais donnée. La température de la grotte est de 9,5 degrés, avec un taux d'humidité frisant les 99 %. Au jour de ma descente, il y avait sous terre tous les repas congelés et conserves pour plus de trois mois, 1000 litres d'eau et 900 livres. De quoi tenir un siège, celui de la solitude.
Philippe Jaenada : Moi, je me suis pas dit je vais me faire des provisions de boîtes de conserve pendant un an et de cigarettes, il en aurait fallu beaucoup. J'avais en bas de chez moi un tabac, juste au coin de la rue et à 50 mètres, un Franprix. Donc j'ai dit au buralistes : "Écoute pendant un an, tu vas me voir tous les jours, ne m'en veux pas, je te dirai ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Donne moi un paquet de Camel et je repars. Je suis allé voir mes parents, j'imagine, la semaine avant, j'ai appelé mes amis, mais c'était vraiment juste d'un point de vue pratique pour les prévenir. Et surtout, j'avais peur que quelqu'un vienne frapper à la porte.
Véronique Le Guen : Vendredi 12 août 1988. Il y a encore un peu de monde dans la grotte pour les dernières mises au point et prises de vue. Personne n'a descendu de montre, mais les estomacs qui crient famine m'indiquent l'heure mieux qu'une horloge. Ma lampe frontale est faible. Elle s'éteint. Je vais changer la pile pendant qu'André s'installe sur la corde. Puis, comme attirée par un aimant, je retourne en bas de l'éboulis pour regarder les petites lucioles qui me disent "au revoir, à dans trois mois", de leur doux balancement. André a disparu. Thierry monte à son tour. Il me fait un dernier geste et crie "Salut la vieille !", pour cacher son émotion et se fond dans les hauteurs, happé par la roche. J'ai encore le bras levé en signe d'adieu quand j'entends la trappe. Elle se referme dans un bruit grave qui n'en finit pas de rebondir sur les parois du gouffre.
Philippe Jaenada : Le 31 décembre 1988 à minuit, quand j'ai fermé ma porte, j'ai dû dire ouf ! Avec cette certitude extrêmement réconfortante qu'il ne pouvait plus rien m'arriver.
Véronique Le Guen : À 80 mètres de profondeur, je regarde encore vers le haut, essayant de capter le moindre petit rayon de lumière du dehors. Mais rien. Seule l'obscurité me renvoie son écho silencieux. J'aperçois du coin de l'œil les stalactites pointues darder leurs aiguilles coupantes vers moi. J'entends les gouttes d'eau résonner comme des coups de gong.
Philippe Jaenada : J'ai le plaisir, le confort de me sentir en sécurité. Mais j'ai aussi une excitation, une vraie, de me lancer dans une expérience, de faire quelque chose de grand. J'imagine que les gars qui traversent l'Atlantique à la rame, ils ont l'excitation de réussir un exploit.
Véronique Le Guen : Cycle 1 : je déjeune en terrasse face à l'assemblée muette des notables de pierres, stalagmites, qui ne devraient pas rester de bois à mes exhortations passionnées car je parle toute seule. Déjà, en surface, je me surprenais à résonner tout haut, mais alors là, ça prend des proportions monstrueuses.
Philippe Jaenada : Pendant au moins deux mois, j'étais dans un truc de performance. Je ne parle à personne, je ne vois personne, je n'entends rien, je ne fais rien. Je suis un héros.
Véronique Le Guen : Cycle 8 : je me réveille plutôt bien. Je n'ai pas fait de rêve. Je ne me suis pas levé dans la nuit. Je crois que j'ai roupillé pendant environ 10 h. En fait 17h et 13 min.
Philippe Jaenada : Je ne faisais rien de rien. Je me levais, je m'asseyais et j'attendais assis toute la journée. A un moment, je mangeais et puis quand je voyais qu'il faisait nuit dehors, je faisais cinq pas pour aller jusqu'à mon lit. Je m'endormais. Et puis voilà, je ne sais même pas comment j'ai réussi à dormir alors que je faisais la journée. Mon principal objectif dans les au moins six ou huit premiers mois, c'est simplement de tenir le coup. Comme je pense à un prisonnier qui fait des petites barres sur le mur de sa cellule parce qu'il sait qu'il a un an ou trois ans ou six mois à faire là. Moi, j'attends simplement que les jours passent. Chaque jour qui passe, je me dis c'est bien, je me rapproche. Je réfléchis pas beaucoup, je veux juste arriver au bout de l'année.
Véronique Le Guen : Je me fais un café et je décide de travailler mon anglais en voyageant un peu. Au hasard, je prends un National Geographic dans la pile et, bien calé sur mes oreillers, j'ouvre cérémonieusement la première page. Les photos m'absorbent immédiatement. J'ai eu le temps de vider ma tête de la multiplicité des images qui nous sont chaque jour apportées par la presse, la télé, le cinéma, la publicité, les magasins, la rue, tout simplement. Le terrain est redevenu vierge et la moindre photographie, je la détaille jusqu'au plus petit arrière plan, même flou. Je rentre dedans. C'est la porte d'un monde renouvelé. En tailleur au fond de ma grotte, je vole sur le tapis de l'imaginaire et la revue à la célèbre couverture jaune m'emmène jusqu'en Australie. Quel hasard ! Je revois les énormes vagues du Surfers Paradise, la plage qui fait rêver le monde entier. Je sens encore le soleil d'une dure journée de plage. Je hume la langouste fraîche et revois la longue route bordée d'eucalyptus.
Philippe Jaenada : Je pourrais très facilement ouvrir mes volets et regarder dehors et ne serait-ce que regarder mes voisins. C'est une rue assez étroite. Je vois ce qui se passe chez les voisins. Je pourrais, je ne le fais pas. Je cherchais pas trop à voir comment je réagissais, me demander si je me sentais plutôt triste ou plutôt joyeux, optimiste ou pessimiste. C'est devenu très vite quelque chose de presque physique, c'est-à-dire que l'ennui ou la solitude sont des choses qui prennent : c'est pas simplement mental, ça écrase, ça oppresse.
Véronique Le Guen : Cycle 16 : je sens que ça va être une journée indécise, une longue période improductive qui n'aura même pas le goût des vacances. Je sors d'une nuit un peu éprouvante ou je me suis battu contre mes sens.
Philippe Jaenada : Tout est ralenti, tout est comme ouaté, étouffé. Tout était plus lent, plus arrondi, j'ai l'impression.
Véronique Le Guen : J'ai vécu une sensation de manque terrible. J'ai besoin de caresser un corps, d'être près de lui, de sentir sa peau, de serrer mes bras autour du torse de Francis, puissant et doux, de me sentir investi par l'amour.
Philippe Jaenada : Je sais que vers mai, je me suis dit “j'arrête”. J'aurais pu tout d'un coup me dire "et merde" et je ouvre la porte, je sors. C'est une arme de se dire "je peux sortir, je peux arrêter ça quand je veux. Je m'ennuie à mort. Mais pour l'instant, si je ressors, ça va être pareil. Je vais être pareil qu'avant", donc je l'ai toujours gardé sous la main, sous le coude, sans jamais m'en servir.
Véronique Le Guen : Cycle 22 : mais qu'est ce que je fais là ? Et comment je suis arrivé là ? Cycle 27 : ma gaieté m'a désertée et je vis mon apathie comme une fatalité. Je me contente de la subir sans révolte ni chagrin. Et Dieu sait si je n'aime pas ce genre d'état, moi qui ait la bougeotte permanente. Je m'allonge et, au lieu de lire, reste immobile, les yeux fixes à ne penser à rien. Je suis dans un épais coton, mais aucun désir, aucun projet. J'attends que ça se passe.
Philippe Jaenada : Je sentais qu'il y avait quand même des trucs qui changeaient en moi. Je me sentais plus sûr de moi. C'est aussi parce que rien ne vient me percuter, rien ne vient me troubler. Évidemment, c'est facile de se sentir sûr de soi quand on ne rencontre personne, on ne risque pas d'avoir de chagrin d'amour, des choses comme ça.
Véronique Le Guen : Cycle 28 : au détour d'une phrase, Thierry me fait remarquer que j'ai encore la chance de ne pas être en isolation totale. Je suis convaincu que l'isolation totale sans lien téléphonique avec la surface n'aurait pas été aussi pénible qu'on le pense. J'irais même plus loin. Il aurait rendu le séjour plus supportable. Car me retrouvant seule dans un domaine complètement neuf, j'aurais entièrement reconstruit ma vie. Je me serais organisée en fonction de moi et de moi seule. Tandis qu'avec des informations parlées, je suis en partie projetée vers l'extérieur. Je suis à cheval sur un dehors de vie normale qui se rappelle à mon souvenir à chaque coup de fil, et la vie interne de la grotte reprend ses droits sitôt le casque raccroché. Pour moi, la différence entre mes deux vies est d'autant plus sensible. Et quelques fois, je me sens fortement tiraillée. C'est comme si on mettait de la nourriture empoisonnée au pied d'un homme affamé. Il doit s'efforcer de l'ignorer tout en mourant d'envie de l'engloutir. Et j'en suis au même stade. Les voix que j'entends au bout du fil sont autant de sirènes qui me chantent la lumière, le soleil, la tendresse, la musique qui existe chez elles. Mais je dois me ligoter au mât rigide d'une stalagmite pour ne pas céder à la tentation de remonter.
Philippe Jaenada : Moi, si j'avais dû, ne serait-ce qu'une fois par semaine, passer une demi heure au téléphone avec mon meilleur ami ou ma mère pour m'expliquer ça aurait été terrible. Je pense que je n'aurais pas tenu un an, je n'aurais pas pu. Parce que là, il y a quelque chose : on se blottit sur soi-même et ça renforce, en fait, on se renforce soi même dans la solitude complète. Moi, j'avais plus de chance qu'elle en fait. Je m'en rends compte dans pas mal de domaines, donc je voyais des gens, j'allais au supermarché, mais ça ne m'apportait rien, c'est-à-dire que je ne les écoutais pas. Je ne discutais avec personne. Je n'ai pas souvenir d'avoir essayé de tendre l'oreille pour entendre des conversations entre êtres humains dans les rayons. Donc pour moi, ça m'aérait un peu de voir de la lumière et des gens. Mais ça ne nuisait pas à ma solitude, ce qui n'aurait pas été possible. Elle aurait été détruite à chaque fois que j'avais un coup de téléphone ou un signe vraiment tangible, concret de l'extérieur. Il aurait fallu que je recommence à replonger à chaque fois dans la solitude, alors que là, petit à petit, je suis devenue vraiment presque une sorte de monstre, un monstre de solitude, mais aussi un monstre de force. C'est à dire que je me suis construit quelque chose comme une créature qui se développe dans un cocon. Exactement, et je sens toujours ça maintenant. 30 ans après.
Véronique Le Guen : Cycle 31 : des élancements rapprochés dans les reins titillent et un petit saignement m'annonce un grand jour. Alors là, tout de suite, je prends un papier, un crayon et fais de savants calculs. Et voici mes conclusions : dans douze cycles environ, je devrai recommencer une nouvelle période menstruelle et arriver à la fin du séjour. Je commence vraiment le dernier tiers de l'expérience. Tous ces chiffres dépendent naturellement d'une seule hypothèse : que les intervalles entre les cycles menstruels soient égaux et équivalents à 28 jours. Mais je pressens que mon corps ne m'a pas trahi. On verra bien. Là dessus, je pique un petit roupillon d'après-midi qui me réconcilie totalement avec la vie. Ça me rappelle que Thierry m'a fait part des inquiétudes de certains. Mais est ce qu'elle ne va pas devenir folle ? Je n'ai nullement l'impression de devenir tarée. Bon, d'accord, il faut déjà avoir un grain pour se cloîtrer trois mois dans une thébaïde souterraine. Enfin, s'il y avait eu le moindre doute quant à ma santé mentale, je crois que Michel, dans sa grande sagesse et sa large expérience humaine, n'aurait pas pris le risque de faire descendre quelqu'un de fragilement équilibré.
Philippe Jaenada : A un moment de l'année, je me suis dit "en fait, ça va avoir l'effet inverse, je vais être encore plus fou que ce que j'étais". Ça, c'est vraiment une fois que j'ai un peu surmonté l'ennui abyssal des mois. Trois, quatre, cinq, peut-être. Tout d'un coup, je me suis dit j'ai passé un cap puisque j'arrive à m'ennuyer du matin au soir. J'y arrive. Je peux rester sans rien faire, sans bouger, à penser à des trucs. Je sais même plus à quoi je pensais. C'est dur à dire maintenant, mais, mais là, j'ai eu peur de devenir fou. Je me suis dit je vais devenir comme un ermite, ces ermites qui errent dans les rues, qui ne supportent plus. Peut être que je ne pourrais jamais retrouver le moyen de discuter avec des gens, d'aller dîner chez des gens, de me retrouver dans les endroits où il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit. J'ai eu cette crainte qui m'a occupé, je pense, une bonne partie de l'été, j'imagine, mais que quand j'ai senti approcher la fin, j'ai dû me dire "tant pis, on verra bien. Peut être que je serai fou, mais maintenant que je suis là, je vais au bout."
Véronique Le Guen : Cycle 32 : aujourd'hui, vraiment, je ne ressens rien. J'ai beau me sonder et me triturer la cervelle, je n'ai rien à dire. Et j'ai bien l'impression que mes pensées ont acquis l'infranchissable lourdeur des parures de pierre qui me surplombent. Cette grotte finit par me peser dessus comme un tombeau. Rien ne bouge, rien ne vit, que moi. Et c'est bien ce dernier sujet qui m'intéresse. Je suis devenue une esclave du temps.
Philippe Jaenada : Même si au point de vue contact humain, j'ai moins qu'elle. Je suis quand même en surface. On ne sait pas comment ça joue sur le sur la tête d'être sous terre sans aucune lumière naturelle. Moi, j'ai de la lumière naturelle. Il paraît que c'est très important pour la stabilité psychologique. Moi, j'ai ça quand même.
Véronique Le Guen : Cycle 42 : j'ai le sentiment de surestimer le temps que je vis ici. J'ai les nerfs en boule. Chaque appel pour signaler une salive, une urine ou autre chose me coûte de plus en plus. Je n'ai qu'une envie : me cacher. Fuir les voix, me fuir.
Philippe Jaenada : Si quelqu'un avait oublié une guitare chez moi, j'aurais essayé de jouer de la guitare. Si j'avais eu des puzzles très compliqués, j'aurais essayé de faire des puzzle. Il se trouve que j'avais rien. J'avais juste du papier et un crayon. Qu'est ce que je vais faire encore aujourd'hui ? Je vais essayer d'inventer une histoire. Ma première nouvelle, c'est un mariage sur la plage d'un village, alors que moi je ne connais pas de village, mais là c'est un village. Et sur cette place, il y a deux mariages en même temps, deux mariés et toute la famille autour. Et je décris, je ne sais pas pourquoi, je décris ce qui se passe autour des mariés, le vieil oncle, le neveu turbulent. Il y a un bistrot, des gens qui entrent et qui sortent de bistrot. La première nouvelle que j'ai écrite, c'est ça. Ça s'appelle Des guêpes, parce qu'il y a des guêpes qui viennent piquer. Je ne sais pas ce qui m'a pris, en plus j'ai jamais été porté vers la littérature. J'ai imaginé peut être l'inverse de l'endroit ou j'étais, c'est à dire un truc à la campagne avec du monde, une fête de famille, des tensions plein de gens différents, un bistrot. Je suis content d'essayer d'imaginer ce qui se passe, d'essayer d'imaginer la suite et puis de voir comment je pourrais décrire au plus juste et au plus près de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que j'ai imaginé. Sur le coup, vraiment, je n'ai pas eu, je suis à peu près certain, je n'ai pas eu de révélation, je me suis pas dit "j'adore écrire, oh, qu'est ce que c'est formidable de pouvoir écrire". Juste me disait "Bon, bah, je vais raconter ce mariage sur une plage de village, comment je vais faire ?" Et ça, déjà, ça occupe, ça occupe le temps, ça occupe l'esprit, ça occupe la main. Puis ensuite, j'ai dû écrire quatre nouvelles, je pense, qui étaient des bonnes nouvelles. D'une quinzaine d'une vingtaine de pages, peut être. La deuxième, bizarrement, c'est l'histoire d'une religieuse au Moyen Âge, alors que je n'y connais rien au Moyen Âge, en religieuse encore moins. Sainte-Cécile, je ne sais pas d'où ça m'est sorti, j'avais aucune documentation derrière. Et voilà, c'est des nouvelles très très différentes qui sont dans un style que je n'assume plus du tout maintenant que j'ai essayé de faire de la littérature, je n'écrirais plus du tout comme ça. Mais c'est comme un peintre amateur. J'étais exactement comme un peintre amateur et en fait, à partir du début de l'automne je pense, j'attends avec grande impatience la sortie, vraiment comme quelqu'un qui est sous l'eau et qui se dit bientôt je vais remonter à la surface, je vais pouvoir respirer. C'est vraiment, c'est vraiment ça.
Véronique Le Guen : La nouvelle de Charles Bukowski que j'amorce, elle porte le suggestif titre de Tous les trous du cul et le mien, qui n'engage que l'auteur, je n'en verrai pas la fin. Et pour cause, à chaque paragraphe, il renie une mouche qui vient isolément badiner sous mes yeux. Je me replonge dans le récit passionnant des hémorroïdes de Monsieur Bukowski. Lorsqu'une première sonnerie de téléphone retentit, puis une deuxième, je n'ose le croire. Si c'est Michel, c'est pour la grande nouvelle. Là, je sais définitivement et j'attends. D'un ton qu'il souhaite naturel. Il me demande : "ça va tu es allongée, tu lis ?" Et enfin, n'y tenant plus lui-même, il me dit la phrase que j'espérais tant : "Ça y est, c'est fini. Tu as gagné". D'un seul coup, je me refroidis. J'ai les mains glacées, moites, mais je pousse un immense et très aigu soupir de soulagement. C'est fini. Est-ce possible ? Déjà ?
Philippe Jaenada : Je pense que le 15 décembre, je me dis “yes plus que quinze jours et je peux sortir !” Je me vois au bistrot, je me vois retrouver mes potes, je me vois me remettre à courir après les filles. Parce que mine de rien, à 24 ans quand même, moi, avant, j'avais une activité sexuelle un peu fournie. Et tout d'un coup, à 24 ans, ce n'est pas le moment de se mettre à un an tout seul. Donc ça, ça joue aussi. Enfin, je suis content, je suis vraiment excité, content. Je me dis en plus, là, je ne peux plus échouer. Quand on est le 15 décembre, je ne suis pas une bête, je ne vais pas sortir. Donc j'ai réussi mon truc. Je me sens mieux et donc je suis content de sortir. Et en fait, plus ça approche. Je ne me l'avoue pas tout de suite, je m'en rends compte qu'après. Mais plus ça approche, plus je m'inquiète, plus je me dis "Bon quand même, un an, est ce que je vais savoir encore...Est ce que je vais supporter les gens de moi ? Et puis, est ce que je vais savoir leur parler ? Ce que je veux savoir ? Être rigolo, intéressant. Qu'est ce que je vais leur dire ?"
Véronique Le Guen : 29 novembre, c'est le jour-J de la remontée prévue à 13h pour des besoins télévisés. Mon corps est un vrai chaudron. Jamais je n'ai eu si chaud ici.
Philippe Jaenada : Je n'étais pas obligé de m'enfermer, mais je n'étais pas non plus obligé de sortir. C'est à dire que elle là quand on lui dit ça y est, c'est fini, je me mets à sa place, il faut sortir. Moi, le 31 décembre, je me dis c'est bon. À partir de demain, je peux sortir. Et en fait, le 1ᵉʳ janvier passe, tout est mort, les commerces sont fermés, les bars sont fermés. Ça sert à rien que je sorte aujourd'hui ou demain, c'est pareil le premier. Et petit à petit, je repousse. Alors, il n'y a pas vraiment une peur panique de l'extérieur. Il y a juste une sorte de lâcheté à revenir. Et évidemment, en voyant que je repousse le deux, le trois, le quatre, je commence à me dire mais ça fait un an que j'attends ça et je ne veux pas sortir. Je suis toujours enfermé chez moi parce que c'est confortable. J'ai pris d'habitude et je suis protégé et donc je ne change rien, sauf dans ma tête où dans ma tête je sais tous les jours, je sais que je peux sortir dans la minute qui suit. Je le sais, je suis là, je suis prêt, je peux y aller quand je veux. Ça fait très peur. Si on sait qu'on peut y aller quand on veut, ça fait peur, mais on choisit soi-même le moment où on saute.
Véronique Le Guen : Mes jambes sont en plomb et c'est avec lenteur que je parcours seule ce lieu devenu sacré pour moi. Je regarde, touche, caresse, cette grotte enfin apprivoisée. Je réalise qu'à l'échelle de son temps, mon passage ne représente qu'un millionième de millionième de seconde.
Philippe Jaenada : Je réfléchis d'abord parce que je ne veux pas aller directement dans un café par exemple ou je ne connais pas les gens et tout ça, et je cherche parmi mes amis qui je pourrais appeler. Il y a des cabines téléphoniques à l'époque. Et donc j'ai une amie qui s'appelle Anne Claude, qui est une amie que j'ai rencontrée sur Minitel dans les années 80, au milieu des années 80, qui est une fille que j'aime beaucoup, avec qui il y a jamais eu rien d'autre que de l'amitié. On n'a pas couché ensemble ni rien. Donc c'est quelqu'un qui me semble inoffensif et quelqu'un qui est extrêmement rassurant. Donc je la choisis, je lui téléphone et là, on est le quinze ou le 16 janvier. Ça fait quand même deux semaines. Et puis je dois me dire quelque part si ce n'est pas maintenant et jamais je vais rester enfermé toute ma vie. Et donc je lui dis voilà, je veux sortir. Il était temps et je dis "écoute, je ne me sens pas très à l'aise avec la parole". C'est mes premiers mots depuis plus d'un an et elle me dit "T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Si tu n'as pas envie de me parler pendant tout le repas, c'est pas grave, on se regarde. Et quand t'as envie de me parler, tu me parles. Il y a un petit resto à côté de chez moi qui est rue du Pré-Saint-Gervais". La rue du Pré-Saint-Gervais est une toute petite rue avec un seul restaurant. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir là. C'est qu'il y a peu de monde et il ne se passe jamais rien.
Véronique Le Guen : J'ai relevé les lunettes en Mylar qui vont protéger mes yeux de la trop vive lumière extérieure. Le signal est donné, la corde se tend. Déjà, mes pieds ont quitté le sol. Déjà, je suis arrachée à la terre. Et tout en tournant lentement sur moi même. Je dessine avec mes bras de grands adieux silencieux.
Philippe Jaenada : Véronique le Guen, quand elle est sortie, je l'ai vue moi à la télé, elle avait exactement le contraire de ce genre de conditions. Quand je vois, moi, à quel point j'avais peur, ne serait-ce que d'aller au bistrot, elle projetait direct. Ça me fait de la peine pour elle. Moi, le 1ᵉʳ janvier, la télé vient frapper à ma porte. Je suis terrifiée, je pense.
Véronique Le Guen : Salut, grotte ! Salut ! On se retrouvera.
Philippe Jaenada : Le trajet, je ne m'en rappelle pas du tout, je devrais m'en rappeler. C'est mon premier déplacement depuis plus d'un an. Mais je ne sais même pas si j'y suis allé à pied, en métro, en taxi. Je n'ai aucun souvenir. Je me revois simplement : c'est un petit restaurant, une petite table près de la baie vitrée. Moi, j'ai la porte dans mon dos. On se met à discuter. Elle me dit alors ça s'est bien passé. "Oh je me suis ennuyé", je raconte tout ce que j'ai vécu pendant un an, mais d'une manière, j'ai l'impression que c'est comme si rien ne s'était passé. Je vois que je suis pas devenu fou. J'ai l'impression d'être plus fort, j'ai l'impression d'être plus calme. J'ai l'impression d'avoir acquis des armes et en fait, ça se passe normalement. Autant les premiers jours de janvier, j'ai pu m'inquiéter en me rendant compte que je sortais pas en me disant "est ce que je ne suis pas allée trop loin ? Est ce que ce n'est pas trop tard ?" Autant, dès ce premier dîner avec Anne-Claude, je comprends que ça va aller. Ça y est, le plus dur est fait. Comme un dépucelage, presque. Donc je rentre me coucher, j'imagine, avec un sourire béat, flotte comme un bébé. Et le lendemain, en début d'après-midi tout a été effacé. Je sors comme si j'allais tous les jours au bistrot boire mon café et j'arrive au bistrot qui s'appelle Le Soleil et à l'angle de l'avenue de Clichy et de la rue Sauffroy, à côté de la rue Gauthey. Je regarde autour de moi. Je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré des gens que je connaissais, qui viennent surtout le soir à l'apéro. Mais j'entends à la radio qui est diffusée dans le café que Véronique Le Guen s'est suicidé ou a été retrouvée morte dans sa voiture, rue du Pré-Saint-Gervais. Cette nuit, ce matin ou hier soir. En sortant, j'ai longé les voitures, les quelques très rares voitures qui étaient garées là. Si ça se trouve, je pouvais même la voir par la baie vitrée, si j'avais tourné la tête. En tout cas, j'ai dû passer devant elle, devant sa voiture. Il y a vraiment quelques mètres, en sortant de la rue du Pré-Saint-Gervais. J'y crois pas. Quand j'entends ça, je me dis "C'est pas possible. Je suis dans la cinquième dimension. Au même endroit de Paris, à quelques mètres près, au même endroit. La jeune femme qui en a involontairement donné l'idée meurt le jour ou moi je reviens à la vie". C'était presque trop kitsch. Ce n'est pas juste une vague inspiration. Je me suis appuyée sur ce qu'elle a fait pour m'enfermer, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mystique dans mon esprit. C'est une coïncidence ahurissante et extrêmement triste et douloureuse, sauf pour moi. Pas une seconde, je me dis il va peut être m'arriver la même chose. Elle, finalement, c'est un an après être sortie. Peut être qu'il faut un an pour que ça te ronge. Je ne sais pas quoi. Je n'y pense pas du tout. Moi, je suis sûr de repartir, de recommencer presque une vie. Alors évidemment, quand on voit ça de loin, avec le recul du temps, moi-même je me dis c'est là que j'ai commencé à écrire. En fait, c'est quand je me suis retrouvé seul et coupé du monde que j'ai commencé à faire ce que je fais toujours 30 ans plus tard, et que je pense que je ferais jusqu'à ma mort. Mais sur le moment, ce n'était pas ça du tout. Et donc je me dis ce qui l’a tuée, alors c'est peut être pas vrai, mais moi, à l'époque, je me dis ce qui l’a tuée, c'est moi, ce qui me permet de reprendre ma vie. Là maintenant, par exemple, notre fils a 21 ans. La semaine prochaine, il prend un appart à Paris, donc il sera plus à la maison. C'est extrêmement tentant pour moi de recommencer après un an, et d'aller me mettre quelque part deux mois à trois mois, c'est extrêmement tentant.
Véronique Le Guen : Cycle 32 : je ne cherche plus de sens à ma vie. Je suis, c'est tout. Mon existence a suspendu son cours. Je n'évolue plus, je ne change plus. Je ne subis plus ces chocs émotionnels qui nous font tourner comme des girouettes deux, dix, cents fois dans la journée. Je me fonds dans l'éternelle solidité du milieu qui m'entoure. La caverne est là, je suis là. Nous sommes dans le même monde ou le temps n'a plus cours.
FIN DE L’EPISODE
Maureen Wilson : Cet épisode de Passages a été tourné et monté par Jérôme Massela. Thomas Rozès en a fait la musique, la réalisation et le mix. Louis Hemmerlé en a coordonné la production. Le générique de Passages a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passages est une production de Louie Media.
Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast et nous envoyer vos histoires à hello@louiemedia.com. Et avant que vous ne partiez, j'en profite pour vous dire que nous avons ouvert un répondeur téléphonique. On aimerait vous entendre et partager vos histoires de travail pour notre podcast. Travail en cours. Alors si vous avez des histoires rocambolesques, des questionnements sur votre travail, des théories sur le monde en entreprise, vous pouvez nous envoyer vos notes vocales directement sur notre numéro 0695772718 ou sur hello@louiemedia.com.
A très vite!
Si vous