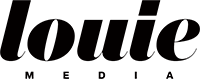Retranscription - Vous aussi, vous avez la haine ?
Brune Bottero : dans mon classement personnel des meilleurs films du monde, il y a assurément La nuit du chasseur, le premier et seul film réalisé par Charles Laughton, sorti en 1955. Dans ce chef-d’œuvre du cinéma hollywoodien, Robert Mitchum interprète Harry Powell, un faux révérend cupide et misogyne, assassin aussi dangereux que séduisant.
Sur ses doigts sont tatouées des lettres. Les phalanges de sa main droite disent LOVE, amour, et ceux de sa main gauche HATE, haine.
A ce personnage fascinant s'opposent John et Pearl, deux enfants innocents confrontés au mal. Mal qu’ils ont de la peine à repérer sous les traits charmants de l’assassin.
Dans une scène, Harry Powell leur raconte l’histoire de la main droite et de la main gauche, l’histoire du bien et du mal. Entremêlant ses doigts, il mime un combat de force dans lequel la main gauche, HATE, essaie de vaincre la droite, LOVE. Dans son histoire, c’est l’amour qui l’emporte, mais Harry Powell est en réalité un homme habité par la haine.
Ce film, dont l’ambiance extraordinaire oscille entre cauchemar et conte de fées, est aujourd’hui un symbole du combat entre la haine et l’amour, comme un condensé de ce qui définit l’humanité.
La haine, ce sentiment puissamment négatif, a des sources complexes. Harry Powell incarne à lui seul cette émotion dans ce qu’elle a de plus sombre, mais qu’est-ce qui l’a poussé à devenir ainsi, le film ne l’explique pas.
En réalité, quelles sont les origines de la haine ? Comment cette émotion peut-elle s’emparer de nous et nous modifier, voire nous abîmer profondément ?
Dans cet épisode, la journaliste Judith Chetrit étudie la haine.
Attention, il comprend des descriptions d’agressions sexuelles et d’inceste, aussi, nous vous recommandons de l’écouter dans des conditions adaptées à votre sensibilité.
Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
Générique
Judith Chetrit : le 16 novembre 2015, après l’assassinat au Bataclan de sa femme, Hélène, Antoine Leiris écrit sur Facebook un texte d’une vingtaine de lignes titré “Vous n’aurez pas ma haine”. A l’époque, j’avais partagé à mon entourage son texte, j’avais lu et relu ces mots. “Non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr”. Il s’adresse aux terroristes. “Vous l’avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère serait céder à la même ignorance qui a fait ce que vous êtes”.
J’avais trouvé ces phrases terriblement dignes et poignantes. Il nous livrait à vif sa tristesse, son effroi, mais se distanciait d’un marqueur qui avait caractérisé les derniers jours, la haine. La haine des terroristes envers leurs victimes et la société française, puis le climat de peur, de vulnérabilité qui a pu instiller de la méfiance envers des migrants et des musulmans. Dans sa lettre ouverte qui est une déclaration d’amour à Hélène, sa femme et la mère de son fils, Antoine Leiris démentait ce qui m’apparaissait inexorable : le sentiment de rage d’avoir perdu si affreusement et subitement un être aimé. Bien sûr, je comprenais la force et la portée symbolique de son message. Mais j’avais aussi envie de comprendre ce qui nous a rendu et nous rend si méfiants de la haine. La haine individuelle, la haine collective. Par exemple, Antoine Leiris écrit qu’il ne veut pas haïr car, ce serait je le cite “céder à la même ignorance”, et puis il n’a, “pas plus de temps à leur consacrer”. Comme si la haine portait une part d’échec, de perte de temps. Cela vous apparaît sans doute comme du bon sens, une évidence. Nous envisageons la haine comme un état affectif suspect et négatif.
Pourquoi nous inquiète-t-elle autant ? Comment savoir lorsqu’on la ressent ? Et comment se rendre compte de ce qui en a été le terreau et ce qui l’a fait se développer en nous ?
Quand j’ai commencé à travailler sur cet épisode, je me demandais bien comment j’allais approcher les personnes que je souhaitais interviewer. “Avez-vous déjà haï quelqu’un?”, “la haine, ça vous parle encore aujourd’hui ?”. Ce n’est pas l’entrée en matière la plus simple. Surtout, j’avais l’impression de poser une question tabou, comme si mon ton trahissait déjà la défiance que j’éprouvais moi-même envers la haine et ceux qui auraient déjà pu l’éprouver.
Puis, j’ai rencontré Vanessa.
Musique
Vanessa : on a tendance à dire “je suis en colère”, “j'ai de la colère”, mais la colère, j'ai vraiment compris que c'était quelque chose de passager et de ponctuel, alors que la haine, elle reste constamment. Je faisais souvent allusion à une sorte de poison qu'on a dans les veines, mais qui est toujours là, qui ne s'en va pas.
Et la colère, on a tous des colères, on pique tous des colères. On est en colère envers ces enfants. On est en colère avec une situation, mais on boit un coup, on fume une cigarette, on rigole entre potes, on dort. Le lendemain, c'est passé. La haine, elle est là, elle ne nous quitte pas, elle ne nous lâche pas. Elle est autre que toutes ces émotions de base en fait et elle est beaucoup plus compliquée à appeler et à distinguer
Judith Chetrit : aujourd’hui, Vanessa a 35 ans, cette mère de quatre enfants vit dans les Landes. Dans son salon, le son de la télé se mêle à celui de la musique et de la préparation du déjeuner. Elle attend la sieste de son petit dernier avant de discuter avec moi.
C’est après un reportage dans la maison d’accueil Jean Bru à Agen qu’une connaissance commune nous a mis en relation. Ce lieu accueille des jeunes filles victimes de violences sexuelles intra-familiales. Vanessa y a vécu il y a une quinzaine d’années. Après avoir porté plainte contre son beau-père pour attouchements sexuels lorsqu’elle était adolescente.
Vanessa : c'était des guilis. C'était des disputes, bastonnades comme on peut avoir entre fratries. Il utilisait la pyramide, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'étais sur mon lit. Il arrivait sur moi, mes frères et sœurs se mettait au-dessus de lui et personne ne pouvait voir. Il faisait glisser ses mains et il en profitait pour toucher. Et une fois que c'était fini, je n'ai rien fait. Ou alors la première fois que cela s'est produit, il est venu me voir dans la salle de bains en me disant “c'est bon, ce n'était qu'un jeu, c'est pas grave, j'ai pas fait exprès”. Sauf que moi, à ce moment-là, je savais que c'était grave et ça pouvait l'être davantage.
C’est cette insécurité et le fait de ne pas pouvoir crier. On a l'impression au quotidien que ça peut être super facile. En gros, il se passe quelque chose, il faut le dire. Mais ça va au-delà de soi et je crois qu'on en arrive à ne plus faire partie de ce corps.
Parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose dans mes tripes, dans mon ventre. C'était c'était au quotidien. Je me levais avec, je me couchais avec. A ce moment là, la haine et la peur, elles vivent ensemble en moi. Je ne connais rien d'autre que ça.
Judith Chetrit : de ses 13 ans à ses 15 ans, Vanessa est moins concentrée à l’école. Elle prend du poids, a souvent ses poignets recouverts de bandages pour couvrir des scarifications. C’est ce qui intrigue le collège. Et elle commence à raconter. En un week-end, la justice ordonne un placement provisoire en urgence. Elle est éloignée de sa famille, désormais au courant. On lui dit que sa mère va quitter son mari.
Vanessa : sauf que le lundi, revers de situation, une éducatrice vient me chercher, m'amène à la gendarmerie. Et là, on me répond que ma maman a enlevé la plainte et qu'elle a amené un sac d'affaires et qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de moi. Et là, c'est.. je m’écroule, c'est violent, je m'attends pas du tout à ça et là, la haine reprend le dessus et je me retrouve toute seule, je perds tout. Mes frères et sœurs j’étais très accrochée, aucune possibilité de les voir, d’être en contact avec eux, rien. On m’a tout coupé du jour au lendemain.
Judith Chetrit : tout ça, Vanessa l’apprend et le vit à distance. Pendant trois ans, elle est hébergée dans des familles d’accueil, des foyers, des structures psychiatriques. Souvent dans un autre département que le sien.
Vanessa : je me lève seule, je me lève et je ne suis pas chez moi, donc tous les jours me rappelle que j'ai été enlevée de chez moi et qu'on m'a fait du mal et que j'ai perdu mes proches. Et je me couche tout le temps avec ça. J'arrive pas à m'en défaire en fait
C'est moi qui ait subi. C'est c'est moi à qui on fait du mal et à ce moment-là, c'est moi qui suis rejetée, qui suis toute seule, qui ai pas le droit d'avoir ma famille et lui, par contre, il a tout encore, il a ma famille, ma mère, même la maison enfin.
Je dirais que lui, j'avais la haine vraiment pour ce qu'il m'a fait et ce qu’il m'a volé. Ma mère j'avais la haine parce qu'elle ouvrait pas ses yeux et j'avais envie de la secouer et d'avoir une machine à remonter dans le temps pour qu'elle assiste à la scène quoi et qu'elle se rende compte qu'elle était mariée avec un pervers. Lui, le secouer, ce n'était pas suffisant. Elle, c'était vraiment “réveille toi quoi ? Comment tu peux abandonner ta fille ? Comment tu peux ?”.
C'était de la haine. Mais le sentiment d'amour, il était quand même là, l'amour et la haine, c'est très limite, on bascule facilement. Elle, c'était vraiment les deux.
Ça a continué et ça a été nourri parce que au fil des années, les rapports par rapport à l'aide sociale à l'enfance, qui se charge d'avoir toujours des liens entre guillemets familiaux ou de passer des informations, me rapportent toujours que ma famille ne veut pas me voir, que ma famille me traite de menteuse, que ma famille a inventé que j'avais fait ça pour l'achat d'un scooter, que j'avais fait ça parce que j'étais amoureuse de mon beau père. En fait, tout ce qui est en train de se dire sur moi de leur part à eux qui sont censés être mes proches quoi...
Judith Chetrit : Vanessa ne voit plus sa mère, son beau-père, ses frères et sœurs, mais l’éloignement n’amoindrit pas sa haine. Le souvenir lui suffit. Elle me raconte comment à chaque fois le bas de son visage se contracte, comme si elle allait claquer des dents dès qu’elle a l’image de son beau-père en tête.
C’est un sentiment qui parasite son quotidien, mais il y a des moments où la haine est plus tenace. Comme lorsque la plainte qu’elle a déposée en son nom a été classée sans suite en 2001, faute de preuves.
Vanessa : combien de fois en fait en pleurant, je disais, et c'est cru ce que je vais dire mais je le pensais sincèrement, “c'était putain mais pourquoi tu ne m'as pas violée? Pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout ?”. Pour que je prouve que tu as fait ça et que tu sois plus à la maison et que mes sœurs ne risquent plus rien. Parce qu'il y avait ça aussi. J'avais peur sans savoir qu'il recommence avec mes sœurs et vu que j'étais loin de tout, je ne pouvais pas savoir et je pouvais surtout pas les protéger. Parce que à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était moi qui avait échoué de ne pas donner assez d'éléments pour prouver ce qu'il avait fait, en fait.
Judith Chetrit : plus j’écoute Vanessa, plus je perçois sa haine comme légitime. Parce qu’elle a appris avec le temps à mettre des mots sur ses m-a-u-x comme lui avait conseillé un éducateur, elle arrive à l’expliquer, à la rendre logique en quelque sorte. Cela tranche forcément avec d’autres perceptions que nous avons de la haine.
Quand j’ai commencé à travailler sur cet épisode, j’ouvrais compulsivement mon dictionnaire des synonymes pour m’aider à affiner une définition et j’y lisais : antipathie, exécration, hostilité, inimitié, malveillance, ressentiment. Sans grande surprise, uniquement des termes négatifs. Et c’est une constante depuis le 19ème siècle et la première définition écrite dans le dictionnaire universel de Pierre Larousse en 1873. L’auteur de l’article “Haine” indique que c’est un “sentiment qui nous éloigne violemment de quelqu’un et qui nous porte à lui faire, ou à lui désirer du mal”. Historien à l’université de Poitiers, Frédéric Chauvaud y a consacré un livre entier. Histoire de la haine, une passion funeste.
Frédéric Chauvaud : si on prend par exemple les grands dictionnaires du 19ème siècle, que ce soit le Larousse ou le Littré, puisqu'on dit que c'est l'époque des dictionnaires, eh bien la haine est jamais revendiquée comme quelque chose de positif. La seule fois où on peut trouver donc une mention qui peut s'apparenter à une forme de légitimation de la haine, c'est au moment de conflits armés. Mais sinon, la haine n'est jamais légitimée. C'est considéré comme quelque chose qu'il faut absolument essayer de discipliner. Et jamais on ne peut, si je puis dire, se flatter ou s'enorgueillir d'avoir agi sous l'impulsion de la haine.
Judith Chetrit : on y associe rarement des adjectifs positifs, par exemple. Vous n’entendrez jamais ainsi dire qu’une haine est admirable, ou un exemple à suivre. Ce n’est pas un compliment. Lorsqu’elles sont imputées à la haine, les décisions prises sont perçues comme péjoratives. Mais que se passe-t-il exactement dans nos cerveaux lorsque l’on est en proie à ce sentiment ? En 2008, une équipe menée par Semir Zeki, un neuroscientifique britannique de la University College London, a voulu observer quels circuits neuronaux la haine empruntait par rapport à d’autres sentiments comme l’amour. Deux sentiments qui se fondent sur des émotions puissantes.
Chacun des participants devait apporter quatre photos de personnes, trois personnes qui leur sont “neutres” ou qu’elles aimaient et une photo de leur ennemi intime. Lorsque la photo de cette personne détestée était montrée, une série d’aires cérébrales s’activaient : le putamen qui peut indiquer la peur et le mépris, l’insula qui interviendrait dans le dégoût et surtout la zone du cortex préfrontal. Cette région du cerveau est celle qui nous sert pour projeter nos actions et anticiper celles des autres. Ce qui prime est le désir de nuire et de riposter.
Parce qu’une réflexion se met en marche, la haine pourrait être décryptée comme un processus avec des mécanismes et des étapes spécifiques. Pour mieux les identifier, deux chercheuses de l’université Grenoble Alpes, l’une en sciences de l’éducation, Martine Pons, et l’autre en sciences du langage, Claudine Moïse, se sont intéressées à la haine des maths. Je vous vois venir, vous vous demandez sans doute quel est le rapport. Après une vingtaine d’entretiens avec des jeunes de 18 à 25 ans qui racontent leur haine de cette discipline à l’école - et c’est le mot qu’ils emploient -, je laisse Claudine Moïse vous convaincre.
Claudine Moïse : la haine des maths, c’est une expression en fait, on dit “j’ai la haine des maths”, alors c'est un peu minimisé puisque la haine telle qu'on la conçoit généralement, c'est la haine contre des personnes. Là, on vise une haine contre un objet. Donc, ce qu'on a voulu montrer dans cette expression, la haine des maths, c'est que le processus haineux et le même que vis à vis d'une personne. Ce sentiment de haine part d'une blessure. Souvent, le sentiment de haine part d'une blessure, même si on ne le sait pas, si on ne la voit pas. Si on ne peut pas l'identifier, ça va être un mépris subi, une honte, une colère.
Judith Chetrit : dans une classe, cela peut commencer par des mauvaises notes pas forcément comprises, l’idée d’une incapacité à progresser, des humiliations au tableau avec le/la professeur devant les autres élèves, des remarques déplaisantes qui assignent l’un d’entre eux au statut de mauvais élève. A terme, encore une fois parce que la haine pousse à agir, à riposter, cette détestation va même engendrer un changement de comportement. Dans le cas des mathématiques, l’élève cherche à se protéger et à se revaloriser.
Claudine Moïse : après, l'expression de cette haine est un peu la même qu'à l'égard d'une personne, c'est à dire qu'on va avoir un mépris pour les mathématiques qu'on veut rayer, on veut éliminer les mathématiques, c'est nul les maths, ça sert à rien, comme dans la haine vis à vis d'une personne. “Toi, tu sers à rien, t'es bon à rien, t'es bon qu’à tuer”, etc. “Je vais t’étrangler” etc. Pareil à l'égard des mathématiques. Donc, on a vraiment un processus qui est identique et donc une blessure profonde aussi ressentie par la personne. Et qui dure, qui peut vraiment rendre la vie difficile, notamment pour intégrer la vie sociale et la vie professionnelle.
La grosse différence, évidemment c'est que c'est à l'égard d'un objet. Tant que ça reste à l'égard d'un objet. ce n'est pas la même chose dans les effets performatifs, c'est à dire si on arrive à rayer les maths, tuer les maths tant qu'on ne va pas viser, et parfois c'est le cas, c’est là, les profs de math qui incarnent la discipline.
Donc cette expression, elle n'est pas anodine. Si les élèves utilisent la haine des maths, c'est parce qu'effectivement, le processus est le même. La différence, c'est qu'on vise un objet jusqu'à ce qu'on ne dépasse pas l'objet.
Judith Chetrit : dans le cas de Vanessa, ce n’est pas un objet dont il s’agit, mais de deux sujets, son beau-père et sa mère. Sauf que son changement de comportement ne peut pas être à effet immédiat à leur égard, elle ne les voit plus, ne leur parle plus. Donc cela finit par se retourner contre elle-même.
Vanessa : j'ai commencé à l'extérioriser dans des colères, dans des comportements où je pouvais m'énerver. Péter un câble. Taper dans les murs. Vouloir fuguer et beaucoup me scarifier, beaucoup me faire du mal. C'était tellement empli en moi que la seule chose de me faire redescendre un peu et de m’apaiser, c'était de me donner des coups de lame de rasoir sur les poignets. C'est bête, mais ça avait vraiment un effet apaisant. Et comme quelqu'un à qui on donne une piqûre pour faire redescendre quelque chose.
En fait, je haïssais tellement ces personnes et moi-même que, en même temps, ça me donnait la seule possibilité de voir que j'étais vivante.
C'est un peu contradictoire, mais c'est les effets que ça faisait
Judith Chetrit : l’auto-mutilation est une pratique qui est récurrente chez les victimes d’inceste. Vanessa décrit aussi que ces comportements à risque ont été, de manière ambivalente, sa technique de survie pour extérioriser sa haine. Car la haine traîne avec elle un besoin de destruction. Daniel Zagury est psychiatre et expert auprès des tribunaux.
Daniel Zagury : c'est donc un affect, un affect qui, habituellement, est dirigé sur un tiers et qui véhicule des contenus négatifs sur la personne en question.
L'invariant de la haine, c'est que c'est un affect chaud, qui vise la destruction de l'autre, soit réel, soit imaginaire.
Judith Chetrit : mais ce travail de destruction, réel ou imaginaire, du sujet haï suppose déjà de reconnaître cette haine et donc le lien qui nous y unit.
Daniel Zagury : si je ressens de la haine et si j'admets que j'ai ressenti, que j'ai éprouvé de la haine, au fond, un lien va exister entre cette haine et les raisons de cette haine.
Et c'est quoi les raisons de cette haine ? Ça peut être un abandon primaire, ça peut être une suite de carences. Ça peut être des sévices, ça peut être des traumatismes.
Judith Chetrit : ces différentes raisons, qui peuvent toutes alimenter un sentiment de haine, provoquent une altération du comportement. Vis-à-vis de soi et des autres. Mais la haine peut être aussi un relais dans une relation qui se termine. Une transition, explique Daniel Zagury.
Daniel Zagury : je crois important de ne pas enfermer la haine dans un carcan d’emblée plutôt de réfléchir en fonction d'un certain nombre de situations pour savoir. Par exemple, le défaut de haine parfois, peut être l'incapacité à penser psychiquement la haine, à la contenir peut avoir des conséquences graves. Et la possibilité, a contrario, de pouvoir penser la haine, peut permettre de passer un certain nombre de caps. Par exemple, la rupture amoureuse. Quand on compte un couple se sépare. On s'aperçoit qu'il y a parfois des choses extrêmement choquantes, dans la façon dont on traite l'autre. Ça passe par les enfants, il m’est arrivé de faire un certain nombre d’expertises dans le cadre de séparations conjugales, de garde d'enfants, résidence, etc. Et en fait, bien sûr que c'est terrible, surtout si ça passe par les enfants. Mais quand c'est transitoire, quand c'est un moment, ça permet de se détacher, de se détacher de l'objet d'amour.
Donc, la haine peut être aussi momentanément, transitoirement un affect qui permet de faire le deuil d'une relation amoureuse.
Judith Chetrit : que l’on ait déjà ressenti la haine ou non, on s’attache souvent à en trouver l’acte de naissance. L’événement qui en est le point déclencheur, l’explication qui nous permettra de dérouler un lien de causalité. Mais ce n’est pas aussi simple que cela. D’abord, car un même événement n’aura pas la même conséquence sur ce que peuvent ressentir des personnes, et ce qu’elles feront de ce sentiment. Ensuite, parce que cet événement en question n’est pas toujours identifié par la personne. Comme s’il n’y en avait pas un en particulier. La manière dont on emploie le mot “haine” est déjà révélatrice : certains d’entre nous disent “j’ai la haine”, cela désigne alors une haine indifférenciée, un état général. Et cette expression, elle a, en partie, été véhiculée par un film de Mathieu Kassovitz. J’y ai immédiatement pensé quand j’ai préparé cette émission. Le mot “haine”, il en a fait le titre de son film, comme un adjectif accolé à toute une génération. Y compris pour la chercheuse Claudine Moïse. Avant de travailler sur la haine des maths et les discours de haine, elle a été une des premières sociologues à s’intéresser dans les années 90 à la pratique du hip-hop dans les banlieues françaises.
Claudine Moïse : j'ai travaillé pour le ministère de la Culture sur la danse, pour la programmation des compagnies hip hop. Donc j'ai circulé pendant 7 ans dans les banlieues . J'ai rencontré d'ailleurs Kassovitz à ce moment-là. C'était vraiment l'expression, on l'a aujourd'hui, “j'ai la haine”. Mais alors en ce temps-là, tout le monde avait la haine. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu appeler son film autrement que la haine parce qu'on l’avait, tout le monde en parlait. J'ai la haine, j’ai la haine, j’ai la haine.
Je me suis engueulé avec lui. Ils ne doivent pas s'en souvenir, mais j'étais une de ses premières projections, il était tout jeune, moi aussi. J'étais en colère en fait contre ce film. La mise en scène et les effets esthétiques sont énormes. Ça m'agaçait, mais je trouve qu’en fait, ça a permis quand même une prise de conscience. Mais oui aujourd’hui je changerai d’avis.
Judith Chetrit : Mathieu Kassovitz a écrit et réalisé ce film sorti en 1995. Deux ans avant dans un commissariat du 18ème arrondissement de Paris, Makomé M’Bowolé, 17 ans, est tué d’une balle dans la tête par un policier pendant une garde à vue. Dans le film, Abdel est dans le coma après avoir été passé à tabac durant un interrogatoire de police. Il y a une nuit d’émeutes dans une cité des Yvelines et on suit ses amis Vinz, Saïd et Hubert pendant 24 heures. Une tragédie s’y joue. Le premier veut se venger, les deux autres redoutent le cercle vicieux. “La haine engendre la haine”, dit Hubert.
Au milieu du 19ème siècle, que Frédéric Chauvaud étudie, ce n’est pas le cinéma, encore inexistant, qui reflète ce sentiment mais la littérature populaire. La fiction, inspirée du réel, qui raconte avec un certain mordant l’intérieur des couples et des familles.
Frédéric Chauvaud : c'est souvent des petits fascicules. L'histoire n'est pas toujours rondement bien menée, mais du coup, c'est ces écrivains, évidemment, se font un peu la caisse de résonance des émotions que les uns ou les autres peuvent évidemment ressentir, exprimer ou observer. Ils l'écrivent que finalement, la haine fait partie, si je peux dire, du réservoir psychique ou psychologique de chacun et que parfois il suffirait de pas grand chose pour que celle-ci puisse éclore.
On peut prendre un autre roman qui est peut être le grand roman de la haine. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent qui datent du 19ème siècle, qui a été publié en feuilleton pour la première fois en 1835, qui est dû à Théophile Gautier. Et le livre s'appelle Mademoiselle de Maupin. Et parmi les différents personnages, un protagoniste qui déambule à travers le récit. Il y en a un qui s'appelle d'Albert. C'est en fait un jeune oisif, mais c'est le personnage principal et à un moment donné, il a une phrase qui dit “J'ai en moi un trésor de haine et d'amour dont je ne sais que faire”. Sous entendu, c'est là. Et puis, il faut qu'il trouve une façon de l'extérioriser. Alors, il peut très bien décider de contrôler à ce moment-là ces trésors de haine ou au contraire, leur donner libre cours.
Judith Chetrit : ces romans, ce ne sont pas des fables avec une morale claire en fin de texte, mais ils vont encore un peu plus ancrer une interprétation de la haine qui est répandue à l’époque, et se consolidera quasiment un siècle plus tard avec les premiers textes de la psychanalyse. Si la haine nous inquiète, c’est parce qu’elle serait d’abord tapie, terrée en nous, dans l’attente d’une expression potentielle. Parfois, il n’y aura jamais d’éclosion. Certains y feront face en cherchant comment la canaliser. Et enfin chez d’autres, des circonstances, des choix, des stimulateurs feront qu’ils se laisseront envahir par ce sentiment et surtout débordés par les actes et pensées qui en découleront. “L’important, c’est pas la chute, c’est l’atterrissage”, le film “la Haine” ouvre avec cet avertissement.
Et en 1995, parmi les spectateurs qui visionnent le film et entendent ces mots à Bordeaux, il y a David. Il a alors 24 ans.
David : le film La haine dans les années 90. Moi, j'étais dans la mouvance skinhead, toujours. Alors déjà, J'ai détesté, bien sûr, ce film parce que bien sûr, les héros, oui, c'était vraiment les c'était vrai, mais ils représentaient vraiment tout ce que tout ce que je détestais à l'époque quoi.
Judith Chetrit : l’époque dont il parle, c’est celle de ces années skinhead entre ses 16 ans et 29 ans qu’il a raconté dans une BD, Mirador tête de mort, publiée en 2013. La quatrième de couverture promet “l’histoire de sa descente dans des recoins glauques de la vie où il aurait pu perdre au moins la raison”. C’est un témoignage sur son basculement dans une haine collective, de groupe, mais ce n’est pas une morale, il insiste au téléphone avant que je vienne le rencontrer à Agen où il a grandi et habite encore.
David : moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans et j'avais des anciens copains d'école que je fréquentais déjà et qui, eux, étaient dans la mouvance skinhead. Ils étaient déjà lookés quoi, le crâne rasé. Comme ils n'avaient pas trop les moyens, ils n'avaient pas les Doc Martins. Ils avaient des rangers, des chaussures de l'armée à la place, des jeans délavés à la javel. Et un blouson de l'armée, ils n'avait pas les moyens de s'acheter un bomber, le fameux bomber, ce que portaient les skinheads. Donc oui, j'y étais. J'étais assez fasciné par leur dégaine. Je trouvais ça chouette quoi. Moi, j'étais plutôt branché punk.
Et donc parmi ces potes, il y en avait un avec qui j'avais beaucoup, vraiment, beaucoup d'affinités et lui faisait de la batterie.
Ils avaient une attitude qui était propre, propre à quelqu'un de violent. Par exemple, déjà, ils avaient des propos racistes. Ça craint vraiment de faire ça, je disais qu'ils abusent quand même, mais ça leur donnait quelque chose d’un peu inaccessible pour moi. Quand j'ai commencé à être pote avec eux, j'étais content. J'étais content d'être avec eux.
Judith Chetrit : ensemble, ils montent un groupe de musique, la Cinquième colonne. Le nom du groupe est déjà évocateur. Depuis la guerre d’Espagne au milieu des années 1930, cela renvoie à des partisans cachés dans une organisation pour agir de l’intérieur dans un environnement hostile. C’est comme ça que débute son introduction à un groupe de skinhead, une série de rencontres, de déplacements un peu partout en France, de bagarres pour gagner le respect. Son engagement carbure à l’alcool et à l’effet de groupe.
David : c'était des concerts. Il n'y avait pas de publicité pour faire un concert, totalement clandestin. C'était que du bouche à oreille, tout se faisait par téléphone et par courrier pour pouvoir venir aux concerts. Donc, on joue devant 200 ou 300 personnes.
Et là, quand on voit qu'il y a toute une foule devant soi, le bras tendu, ou alors qui connaissent les paroles et qui répètent les refrains, ça fait monter l'adrénaline et ça donne vraiment envie de continuer, de se dire que là, vraiment, on a touché quelque chose. Et il ne faut pas baisser les bras. Il faut passer à la vitesse supérieure quoi.
Judith Chetrit : et ça veut dire quoi, passer à la vitesse supérieure ? Au-delà des concerts ?
David : Créer une structure, un groupe, au-delà de la musique et c’est ce qu’on a fait à Bordeaux, en 94-95.
Judith Chetrit : David reconnaît que c’est à ce moment-là qu’il a passé un cap, que sa haine a encore pris davantage forme dans son quotidien. Dans son discours d’abord. Après l’avoir rencontré, je me suis donc demandé qu’est-ce qui, dans ses mots, aurait pu être qualifié comme une verbalisation de sa haine et ce qui pouvait dangereusement en déboucher.
Au sein du groupe de recherche européen Draine, la socio-linguiste Nolwenn Lorenzi Bailly a décrypté une multitude de discours. Dans un ouvrage collectif sur la haine en discours, auquel Claudine Moïse que nous avons entendu plus tôt a également participé, trois caractéristiques ont été ainsi définies.
Nolwenn Lorenzi Bailly : c'est même très rare, finalement, qu'on dise” je te hais, je te déteste. Je veux ta mort”, etc. C'est vraiment quelque chose qu’on va retrouver très rarement. On ne peut pas dire que ça soit évident de définir ce que serait un discours de haine, d’ailleurs ça nous a pris beaucoup de temps
On constate nous qu'on peut définir ce discours de haine direct à partir du moment où il va remplir trois conditions concomitantes, c'est à dire que il va s'appuyer sur une dimension pathémique, donc liée au pathos, c'est à dire aux émotions et au fait de toucher l'autre. Donc là, on va avoir plusieurs stratégies qui vont être différentes. On va retrouver aussi des marqueurs de négation de l'autre. Donc, parce que le discours de haine, c'est aussi en rapport à cet autre dans lequel je ne me retrouve pas, dans lequel je souhaite anéantir, détruire, etc
Et enfin, on va retrouver pour le coup des marques de ce que nous on a appelé aussi la violence verbale, c'est à dire des actes de condamnation de l'autre, des actes de langage grâce auxquels je vais réussir à condamner l'autre, où on va retrouver l'insulte, on va retrouver la menace. On va pouvoir retrouver le mépris aussi, tous des actes de langage qui vont nous amener à malmener l'identité de l'autre.
On va parler du coup, effectivement, de discours de haine dissimulée qui ne va pas présenter de façon évidente tous ces éléments, mais qui vont s'appuyer sur des préjugés, sur des stéréotypes, sur une mémoire aussi, des discours. Et ça, la question de la mémoire, ça va énormément jouer. Dans l'ouvrage, on donne un ces exemples où on a, par exemple si on a “Mort aux juifs”, bon, là, clairement, on va avoir un discours de haine qui est direct. Il n’y a pas de sous-entendus. Par contre, si on a cette phrase, “un bon juif doit être cuit à point”. Là, pour le coup, on ne va pas avoir d'insultes, mais on va avoir cette référence à tout un historique, à toute une mémoire qui va nous dire qu'effectivement on est, on est dans le discours de haine qui serait du coup plus dissimulé.
Mais encore une fois c'est le principe de l'analyse du discours, c'est à dire qu'on est en aucun cas capable de dire ce qui se passe dans le cerveau du locuteur ou de la locutrice. Par contre, on peut dire comment ces mots, son discours, qu'il ou elle va mettre en mots est fait et fonctionne
Judith Chetrit : dans un discours de haine dit direct, trois conditions sont réunies : le recours à des émotions, la négation de l’altérité et des mots pour condamner par l’insulte ou la menace par exemple. Lorsque David me cite les refrains xénophobes et racistes des chansons qu’il jouait avec son groupe, ce sont surtout des représentations dénigrantes qui généralisent, réduisent des personnes à leur appartenance à un même groupe. Puis, ce qui apparaît comme une haine floue s’est resserrée sur des personnes en particulier.
David : au départ, ce n'était que des idées racistes et il n'y avait même pas de nationalisme, j’ai découvert le nationalisme au fur et à mesure.
Pour moi, j'en étais resté aux Arabes. C'est tout. Non parce qu'il faut le dire à Agen, à l’époque, c'était la campagne, quoi. Et de tout ce qu'on connaissait, c'était les Arabes, les histoires de Noirs, de Juifs, d'autres ethnies, ça ne nous parlait même pas.
Et juste parce que l'arabe, il est méchant, parce qu’il m'embête. Quand je suis en mobylette, il m'embête. Voilà, c'est tout. C'est moi, c'était ça. Je parle pour moi là. Quand je disais, on ne cherchait pas à taper le moindre Arabe qui traîne dans la rue. On avait toujours les mêmes têtes. Il y avait des personnes en particulier sur qui on espérait pouvoir mettre la main dessus quoi et lui faire sa fête, des personnes avec qui on avait déjà eu des problèmes.
Au début, j'étais gentil, mais après, à force, je me battais. Puis je disais “Je suis raciste, je t'emmerde”. Puis je me battais.
Et vu que je savais que je commençais à rentrer dans un engrenage, je me disais il y a plus, je sentais qu'il y avait plus, je sentais le non-retour.
Judith Chetrit : le non-retour dont il parle, c’est aussi par rapport à son éducation, le milieu familial dans lequel il a grandi.
David : mon père a toujours été très à gauche. Très, très à gauche. Je pense que il y a ça aussi qui me fascinait, c’était à l’opposé de mon père.
Il suivait vraiment tout ce que je détestais de ce qui se passait à la télé. Nous bassiner avec SOS Racisme, tous ces trucs là, c'était la grande époque de fin des années 80 tout le monde se faisait un peu ambassadeurs de ce qui est bien ou mal.
Et là, il y avait une espèce de chasse aux sorcières, la moindre chose qu'on disait qu'on faisait. Un comportement qui ne rentrait pas dans le moule de cette nouvelle mouvance là… Mon père, il a été complètement défait, complètement défait tout ça.
Il disait : Pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi ? Mais arrête, mais qu'est ce tu fais ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais qu'est ce qui s'est passé ? C'est qui ? Qui ? Qui a dit ça ? Pour lui, ça ne pouvait venir de moi. C'était toujours “qui t’a mis ça dans la tête ?”. Et ça, ça m'énerve encore plus. J'ai trouvé ça complètement dénigrant quoi.
Judith Chetrit : plus je discute avec David, plus je sens qu’il est difficile de décortiquer sa haine avec lui. D’en comprendre, comme avec Vanessa, le point de début et le point de fin, et tout ce qui l’a conduit à s’investir dans un tel groupe et à vivre avec eux. Il n’y a pas eu un fait perturbateur particulier. Comme s’il y avait eu un événement muet initial derrière cette haine avant qu’elle ne se décline en violences ou en déclarations.
David : j’écoutais ce qu'on me disait. Je prenais ce qui me plaisait, mais je ne faisais pas la démarche d'acheter un livre ou d'adhérer à un parti politique. Déjà, la télé, je ne la regardais jamais, la radio, je ne l'écoutais jamais. Je n'avais que ce que m'apportaient mon entourage et mes potes, quoi. Ça me suffisait pour moi de me faire une opinion sur la vie ou sur la vie, sur tout ça.
Judith Chetrit : chez David, l‘ancien skinhead, sa haine a pris racine dans l’ambiance, le monde binaire dans lequel il vivait. Elle a façonné son identité mais aussi l’unité de son groupe qui partageait ce même sentiment. Ce que l’historien Frédéric Chauvaud appelle le mimétisme de la haine.
Frédéric Chauvaud : c'est un aspect qui n'a pas été forcément beaucoup travaillé, creusé, mais qui me semble tout à fait intéressant, le mimétisme de la haine
Autrement dit, la haine peut être contagieuse, une personnalité haineuse peut entraîner dans son sillage et bien tous ceux qui sont un petit peu autour de soi.
Elle peut être contagieuse, moi je pense de plein de manières différentes. La première, c'est un ressort, si je peux dire, qui est humain, quand on souffre, on a besoin de haïr. Voilà donc là, à ce moment-là, on a un chemin qui est déjà tout tracé. Vous êtes par exemple dans une situation particulière. Vous êtes exploités, malmenés par un groupe ou même, par exemple, dans l'industrialisation du 19ème siècle. Voilà, il y a des journées de travail absolument épouvantables. Il y a des conditions qui sont désastreuses. Évidemment, on peut haïr le patronat, les ingénieurs d'encadrement. Et à ce moment-là, on va décharger un petit peu son agressivité. Et donc on a ce besoin de haïr. Ensuite, on peut aussi affirmer, à travers un certain nombre d'études, qu'un autre ressort de la haine, c'est finalement le refus du changement. On vit une situation où on peut considérer que ce n'est pas forcément la plus fantastique possible, mais elle nous convient parce que finalement, on est habitué. On est familier avec les différents cadres et éléments de cette situation. Et puis, il y a un changement qui intervient, alors ça peut être un changement culturel, un changement économique, un changement de société.
Quand quelqu'un ou un groupe, ça peut aussi toucher une collectivité, connaisse une sorte de désarroi psychique à ce moment-là, on ne sait plus trop où on en est. Qu'est ce qui se passe ? Quel va être l'avenir ? Les éléments vont être menacés, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est des réponses simples et les réponses simples eh bien la haine est bien évidemment là et formidable parce que la haine fournit une réponse simple. On refuse la complexité. On refuse le hasard. On a besoin de certitudes et la haine peut fournir évidemment cette certitude. C'est la faute à telle personne. C'est à tel groupe qui va jouer le rôle de bouc émissaire et la haine va se décharger dans sa direction.
Judith Chetrit : quand il a écrit et dessiné sa BD mettant en scène un Sam qui lui ressemble beaucoup, David a reconstitué les maigres clés de lecture et de compréhension qu’il avait sur sa vie à l’époque. A la fin, il y a même quelques photos de son groupe avec lui, le seul visage non flouté. Il parle notamment de ses trois mois passés en détention préventive pour complicité suite à la mort d’un homme dans un bar, tué par un de ses amis après une bagarre. Ensuite il se présume surveillé par les renseignements généraux.
Mais la prison ne le fait ni changer d’idées, ni de rythme de vie. Il reste un taiseux, conserve son poing américain à chaque fois qu’il sort. Nous sommes au milieu des années 90, pas d’espace en ligne pour s’en servir comme vitrine, mais un fanzine intitulé “Un jour viendra”.
Pour David, le confort de se retrouver intégré à un tel groupe à en partie joué. A un instant T, la haine lui a donné une direction de vie. Cela ne l’a pas empêché d’avoir parfois des doutes.
Et c’est lorsque cette cohésion de groupe s’étiole que David se remet progressivement en question avant de quitter ce mouvement en 2000 après plus d’une dizaine d’années.
David : ce qui m'a fait arrêter, ça a été quand je me suis retrouvé un peu tout seul à Bordeaux. Ne plus avoir mes potes parce que la plupart étaient, bon, on a grandi et là, il y en avait pas mal qui étaient en couple et qui ont eu des enfants et qui ont fait leur vie et je faisais toujours un boulot de merde. Équeuter les fraises à 3 heures du matin, jusqu'à 10 heures du matin. Équeuter des fraises six jours par semaine. Et là, je me suis dit “Mais qu'est ce que je fais là ? Mais qu'est ce que je fais ?”. J’ai fait une rétrospection sur tout ce que j'ai fait et je vais avoir 30 ans.
Je me suis rendu compte que le racisme, le nationalisme, c’est quelque chose que je n'avais pas en moi au départ et je me rends compte qu'en fait non, je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas, parce qu’une personne est noire ou une personne pas comme moi, ne pas lui parler, voire l'agresser non je peux pas faire ça tout le temps c’est complètement débile
Judith Chetrit : pour David, ce qui l’a donc aidé à évacuer sa haine, c’est de réfléchir à son utilité dans la vie, il ne se reconnaissait plus dans ses choix passés. Dans le cas de Vanessa, il y a eu deux événements. Le premier survient quand elle devient majeure après trois ans passés dans l’aide sociale à l’enfance.
Vanessa : je rencontre quelqu'un qui est 18 ans plus vieux que moi et je vis une histoire d'amour avec lui où je fonce tête baissée, sans réfléchir et il m'offre une famille, c'est-à-dire que je tombe très vite enceinte de mon premier enfant. Je suis toute jeune, oh je vais faire ma famille. Et là, je bascule complètement, enfin pas complètement, mais il y a quand même 50 pourcent de moi qui bascule dans autre chose puisque j'ai un bébé dans mon ventre.
C'est mon enfant, il est à moi, j'ai un homme que j'aime. On va vivre ensemble et là, c'est vraiment la bascule vers autre chose.
Je pense que sur le coup, ça a vraiment été. Je m'accroche à quelque chose. Ils deviennent, ils deviennent dans mon passé, mais j'y vois une opportunité d'avancer, d'aller de l'avant, d'être quelqu'un. Et puis, c'est l'amour qui prend place en moi.
C'est un autre sentiment qui vient de dégager le premier quelque part. Même si elle est toujours là en fond, c'est l'amour à ce moment-là, l'amour pour mon futur époux, pour le bébé qui va arriver. La vie qu'on va avoir, donc c'est vraiment complètement différent.
Judith Chetrit : quand elle me raconte son couple puis sa grossesse, la première image qui me vient en tête est celle de vases communicants. Comme si, pour s’installer, l’amour devait rogner sur un espace alors occupé par la haine. Le temps a sans doute joué aussi, et son souhait de reprendre partiellement contact avec sa petite sœur, ses grands-parents maternels puis sa mère. Mais sa haine va et vient. Elle subsiste encore jusqu’en 2014, presque 15 ans après les attouchements subis.
Vanessa : donc, en 2014, ma mère m’envoie des messages toujours sur ordinateur, en me disant que désormais, c'est fini, qu'elle me croit qu'elle va demander le divorce. Et elle met du temps pour mettre les mots et elle finit par me dire qu'il m'a violée. Et de là, ces deux sentiments complètement opposés que je vais ressentir. C'est le soulagement de la prise de conscience de ma mère et cette fameuse haine de cet homme que j'appelais par tous les noms d'oiseaux d’avoir fait ça, encore une fois à quelqu’un.
Et de là, moi je vais travailler mon histoire, je vais continuer à travailler mon histoire puisque j'avais commencé à voir une psychologue pour faire une thérapie et en fait, le fait de mettre des mots et de travailler mon histoire, cette haine-là a été travaillée et a été évacuée. Ce qui m'a permis d'appréhender les choses complètement différemment, puisque ça fait pas longtemps qu'on est passé au tribunal, donc trois victimes de ce monsieur-là, donc j’ai pu la vivre sans haine et plutôt avec pitié pour lui.
Judith Chetrit : en février 2021, son beau-père a été condamné pour des attouchements sexuels sur elle et sa petite sœur. Lors de la procédure, Vanessa a même fait un lien avec la haine et sa mémoire sur laquelle elle a dû s'appuyer pour déposer à nouveau une plainte.
Vanessa : et d'ailleurs, le tribunal l'a reconnu parce que quand on est passé là bas, ils ont dit “Mme Monjust, en 20 ans d'écart, tient le même discours sur les actes”.
Alors oui, il y a des détails, l'âge où des trucs comme ça, qui m'échappait ou mais par contre, sur les actes et la manière dont ça se passait. La haine m’a fait tellement ressasser le truc que j'ai le même discours aujourd'hui que je l'avais il y a 20 ans. Et le film est dans ma tête comme si c'était hier. J'espère qu'avec le temps, je l’effacerai, mais en tout cas aujourd'hui. Il est présent exactement de la même manière.
Avec le temps, on apprend à vivre avec. Mais ça n'enlève pas. Moi, il a vraiment fallu cette reconnaissance, donc à plusieurs degrés et plusieurs facteurs, pour qu'aujourd'hui je puisse en parler sans haine et même sans rancœur.
Judith Chetrit : tant la reconnaissance de la justice qu’un nouveau lien à créer avec sa mère et sa vie de famille ont aidé Vanessa à arrêter ce ressassement qu’elle décrit. Selon le psychiatre Daniel Zagury, cette rumination mentale maintient la haine.
Daniel Zagury : ce qui facilite la conservation de la haine, c'est sa non résolution. Je parle de recuite, de ressassement.
Effectivement, ce retour, cette répétition qui est une souffrance, témoigne du fait qu'on a fait très mal. Ça fait mal. Ça empêche de vivre, ça empêche de penser autre chose. Ça empêche de tourner la page.
C'est parce que le sujet est dans une impasse situationnelle qui continue de prouver la même chose. Et c'est pour ça qu'on entend aussi souvent. Je souhaitais en finir, tourner la page et ce sentiment de haine, effectivement, est destructeur pour le sujet qui l'éprouve.
Judith Chetrit : forcément, j’ai aussi demandé à David s’il ressentait encore de la haine.. Aujourd’hui, il se consacre à la BD à plein temps et est aide-soignant par intermittence la nuit. Si cette haine est plus vague, elle est encore présente, par traces et par moments. Vingt ans après.
David : récemment, en bas de chez moi, il y a des gamins qui ont essayé de me piquer un scooter. Et là, j'ai eu un réflexe comme j'avais avant. Je leur ai couru après, ça m'a rappelé les fois où j'ai couru après les mecs quand j’étais skin.
Et ça, quand j'y repense, ça me donne des frissons quand même. Ça ne me plait pas.
J'essaie d'aller de l'avant toujours. J'ai toujours réussi à rebondir, à aller de l'avant, mais au fond de moi, je ressasse tout le temps, le passé.
Puis même des fois aussi au boulot, je repense à des rapports avec des gens au travail que j’'estimais, qui m'ont manqué de respect. Ils m'ont pris pour une merde. Et là, j'ai de la haine envers ces gens-là et envers moi pour ne pas avoir eu le bon retour à ce moment-là.
Ca c’est inquiétant parce que ça fout des barrières. Je pense que quand on a la haine, on a toujours des préjugés, ça va avec je pense.
Judith Chetrit : ce que David restitue dans ses mots avec une franchise qui m’a quelque peu déconcerté, c’est l’idée d’une haine vagabonde, glissante, qui se déplace, s’atténue, se jugule par d’autres émotions, puis à un moment peut rencontrer une figure particulière pour s’y fixer et s’y accrocher.
Dans ses chroniques d’un enfant du pays, l’écrivain afro-américain James Baldwin avait pointé une explication à double tranchant sur l'inquiétude que provoque la haine. Lui en nourrissait à l’égard de son père. Alors que celui-ci est malade, sur le point de mourir, James Baldwin retarde son ultime visite, dit à sa mère que c’est parce qu’il le hait. La vérité, écrit-il, c’est qu’il veut conserver cette haine mais cela serait difficile s’il voyait son père dans un tel état. Ce n’était pas un homme en ruine qu’il avait haï. Puis, il poursuit : “J'imagine que l'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent de manière si tenace à leurs haines, c'est qu'ils sentent bien que, une fois la haine disparue, ils se retrouveront confrontés à la douleur".
Générique
Brune Bottero : vous venez de lire Émotions.
Cet épisode a été tourné et monté par Judith Chetrit. Elle fait entendre les témoignages de Vanessa et David, et les analyses de Frédéric Chauvaud, Nolwenn Lorenzi Bailly, Claudine Moïse, et Daniel Zagury.
Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leur travail sur notre site.
Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotions.
Cet épisode a été réalisé par Charles de Cillia. Jean-Baptiste Aubonnet s’est occupé de la prise de son et du mix. C’est Nicolas de Gélis qui en a composé le générique.
Émotions est un podcast de Louie Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard responsable de production, Mélissa Bounoua directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale.
Si vous vous interrogez sur les différences entre la Haine et la Colère, vous pouvez aller plus loin en écoutant ou ré-écoutant l’épisode d’Émotions « La colère est-elle si mauvaise conseillère ? », réalisé par Cyrielle Bedu.
Émotions, c’est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts : Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou Spotify.
Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n’hésitez pas à nous écrire à hello@louiemedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons.
Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts : Travail (en cours), Passages, Injustices, Fracas, Une Autre Histoire, Entre ou Le Book Club.
Bonne lecture/écoute, et à bientôt.