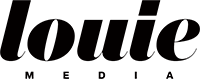Retranscription - Étudiant.e.s : comment l’isolement affecte le cerveau des jeunes
“Je n’y arrive tout simplement plus”, “À 19 ans, j’ai l’impression déjà d’être morte”, “Je suis devenu fou”, “Je veux revenir en cours, je n’en peux plus”...
Lucile Rousseau-Garcia : ces mots, ce sont ceux d’étudiants et d’étudiantes qui font part de leur détresse sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Après les tentatives de suicides de leurs camarades, ils créent le hashtag “étudiants fantômes" pour partager leurs témoignages et interpeller les pouvoirs publics.
À la fin du premier confinement, plus de la moitié des étudiants interrogés dans une étude de l’Observatoire de la Vie Étudiante disaient avoir souffert de solitude et d’isolement. Depuis, ils n’ont pu retourner à l’université que quelques jours tout au plus. Ils suivent leurs cours en ligne depuis leurs studios ou leurs chambres chez leurs parents, seul.e.s, en tête à tête avec leurs ordinateurs. Et cette situation dure depuis presque un an.
Je suis Lucile Rousseau-Garcia, et dans cet épisode, je me suis demandée quelles sont les conséquences de l’isolement sur la santé mentale des étudiants ? Est-ce que c’est particulièrement difficile quand on a cet âge-là et pourquoi ? Et à long terme, à quoi ressemblera cette génération privée pendant aussi longtemps d’interactions sociales ?
Bienvenue dans Émotions à emporter.
Générique
Il y a quelques semaines, je faisais défiler les témoignages sur le #EtudiantsFantômes et je suis tombée sur un tweet : celui de Marthani. Elle a 22 ans, elle est en première année de licence en langues étrangères appliquées à la faculté de Créteil. Et elle habite chez ses parents, qui sont tous les deux sans emploi. En fait, ils sont cinq à cohabiter dans un même appartement, avec son petit frère et sa petite sœur.
Depuis le début du premier confinement, il y a près d’un an, Marthani passe ses journées face à son ordinateur, devant une interface de visioconférence pour assister à des cours en ligne.
Dans son tweet, elle écrivait : “J’étudie pour étudier, mais je ne ressens rien... je suis complètement vide de l’intérieur, je n’ai plus aucune envie”.
Je lui ai demandé si je pouvais l’appeler, et au téléphone, ma première question, ça a été de savoir comment elle se sentait.
Marthani : je suis stressée, démotivée, un peu énervée. Il y a un peu de tout. En fait, c’est bizarre parce que je dis que je suis confiance et tout, mais j’ai toujours une peur au fond de moi qui apparait à chaque fois et c’est vrai que depuis le confinement, elle est un peu plus présente dans ma vie. Est-ce que plus tard les conséquences de la crise sanitaire qu'on est en train d'avoir.. enfin il y aura sûrement des conséquences pour plus tard aussi. Du coup oui, j'ai peur pour mon avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Lucile : elle m’a aussi décrit cette sensation de vide dont elle avait fait part sur Twitter.
Marthani : je ne ressens pas grand-chose, mais vraiment je travaille, ok il faut travailler, je travaille, mais je ne ressens pas de plaisir. Du coup, je travaille, mais pour moi, ce n'est pas du travail. J'ai l'impression de juste faire du copier coller ou d'écouter ce qu'on me dit et je le fais. Et du coup, ouais je me sens vide. J'ai un peu du mal à ressentir des sentiments, que ce soit positif ou négatif. C'est vraiment je ne ressens rien. Je ne sais pas si j'ai un cœur de pierre ou quoi, mais vraiment, je suis là, je suis... En fait ouais, je suis assise sur une chaise et je suis là face à mon bureau, et il n'y a rien. Je ne ressens rien du tout en fait.
Lucile : Marthani m’explique qu’avec les cours à distance, elle n’a pas eu le temps de se faire des amis.
Marthani : le jour de la rentrée, on n'a pas forcément fait connaissance avec les autres et juste après, on a directement été mis dès la deuxième semaine, on a été.. on a eu les cours en distanciel à la maison. Du coup, bah après on s'est pas parlé parce que sur Zoom et tout personne met la caméra, on parle pas. J'ai aucune interaction, que ce soit physiquement, je ne vois personne, je parle à peu de gens et en plus virtuellement aussi. Ouais je n'ai aucune interaction avec personne.
Lucile : tout ce que Marthani décrit, on est beaucoup à le ressentir, étudiants ou non… Alors j’ai voulu savoir si l’isolement avait des conséquences particulières chez les jeunes.
Pour répondre à cette question, je me suis rendue à l'institut Psychiatrie et Neurosciences de Paris. Là-bas, j’ai rencontré le docteur Ariel Frajerman. Il est psychiatre et chercheur en neurobiologie. Et ses travaux portent en particulier sur les jeunes adultes et le développement de la psychose.
Je lui ai demandé quelles étaient, de façon générale, les différences observées par la neuroscience entre des jeunes adultes de 18 à 25 ans et le reste de la population.
Ariel Frajerman : pourquoi on travaille sur les jeunes adultes ? Parce que cette population de 12-25 ans, en fait, c'est une population de grande vulnérabilité. Et c'est aussi à cette période qu'émerge la plupart des troubles psychiatriques puisque 75% des troubles psychiatriques débutent avant l'âge de 25 ans.
Et en fait, qu'est-ce qui se passe à cette période ? Des modifications au niveau cérébral, notamment, ce qu'on appelle l'élagage synaptique, c'est-à-dire qu' une synapse, c'est une connexion entre deux neurones, en fait au début on en a beaucoup et au fil du temps, on diminue, mais on va garder celles qui sont utiles, et ça va former après des réseaux de neurones et des réseaux de connexions entre régions cérébrales. Et en fonction de nos expériences de vie, notamment à ce moment-là, il y a des connexions qui vont se former.
Il y a aussi une autre chose, un autre phénomène qui peut être très important, qu'on appelle la myélinisation, c'est-à-dire que dans notre cerveau donc il y a de la matière grise et de la matière blanche. La matière blanche, c'est donc la myéline, notamment, et c'est ce qui permet de faire la connexion entre les régions cérébrales.
Lucile : jusqu'à nos 25 ans donc, notre cerveau se développe, via des connexions entre les neurones, mais aussi entre les différentes zones du cerveau. Mais ce que m'explique Ariel Frajerman, c’est que l’ensemble de ces connexions ne se développent qu'en réaction à des expériences auxquelles nous sommes confrontés.
En fonction des activités que l’on pratique, et des situations auxquelles on fait face, certaines zones de notre cerveau vont être plus stimulées que d’autres, et donc se développer davantage.
Ariel Frajerman : par exemple, l'exemple qu'on donne toujours c'est... ce qu'on sait, c'est que par exemple les pianistes ils ne vont pas avoir le même développement au niveau cérébral des zones impliquées dans la motricité de la main que les autres. L'autre exemple qui a valu un prix IG Nobel, c'est une étude sur les chauffeurs de taxis londoniens qui montrait qu'ils avaient une partie de l'hippocampe qui était beaucoup plus développée que la population générale, parce qu’à Londres les chauffeurs de taxi, à l'époque, avaient besoin de connaître vraiment la géographie de Londres et des choses comme ça.
Et ça c'est important, de rentrer dans ce détails là, parce que des chercheurs ont essayé de reproduire l'expérience dans une ville nord américaine et ils ont dit : “nous on retrouve pas du tout la même chose”. Donc, voilà, c'est pas répliqué, et en sciences c'est très important de répliquer les informations plusieurs fois par différentes équipes pour s'assurer de la véracité. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, les premiers chercheurs ont dit : “mais c'est parce que ce n'est pas quelque chose dans votre ville, dans votre ville, c'est des rues à angle droit nord américaines plus le GPS qui est autorisé pour les chauffeurs, donc ils n'ont pas du tout besoin de développer les mêmes capacités”. Donc, on sait que les apprentissages, ça joue sur le cerveau parce qu' on va renforcer les zones dont on a le plus besoin en termes de connexions, qui vont se faire plus souvent, plus fréquemment. Et donc, en fait, dans les interactions sociales, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas développé les mêmes capacités.
Si vous voulez, ces capacités elles vont laisser une empreinte au niveau du cerveau pour après rendre ça plus facile.
Lucile : le cerveau a donc besoin d'interactions pour se développer. D’ailleurs, des chercheurs australiens ont montré que le lien social permettait même de réduire les risques de développer des troubles psychiatriques.
Ariel Frajerman : à la base, dans les années 80, ce que les Australiens ont fait, c'est qu'ils ont dit : “dans la schizophrénie, on ne peut pas considérer que tous les patients sont identiques, notamment entre les patients chroniques et les patients qui en sont au début de la maladie”. Donc, l'idée, à la base, c'était de prendre en charge les patients le plus tôt possible pour les traiter de manière plus intensive et d'améliorer le pronostic.
Et donc ils ont obtenu de l'argent de la part du gouvernement australien pour la prise en charge précoce des jeunes de manière globale pour dépistage et la prise en charge des patients qui présentent déjà des problèmes en fait.
Dans ces prises en charge notamment il va y avoir de la psychothérapie : il y a différents types de psychothérapie, ça peut être des groupes de parole, ça peut être des actions plus centrées au niveau social, notamment pour trouver un travail pour les études, pour les accompagner en fait pour leur parcours, parce qu'en fait ce qu'on sait, c'est que ces jeunes, plus ils vont être insérés socialement, que ça soit au niveau d'études, ou au niveau du travail, bah meilleur est le pronostic parce qu'ils ne sont pas dans la solitude. Donc, de ce fait, ils n'ont pas les conséquences négatives de la solitude. Ils ont plus d'interactions sociales, ils sont plus aidés.
L'idée, c'est de dire que améliorer l'intégration sociale via des interventions en thérapie cognitivo comportementale, en groupes de parole ou autres, ce qu'on constate, c'est que ça permet d'améliorer le pronostic, d'améliorer les capacités cognitives, sans qu'on sache exactement pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que ça marche.
Lucile : avec cette étude, on a donc observé un lien entre interactions sociales et diminution des troubles psychologiques, cognitifs et neuronaux. Et ce lien fonctionne aussi dans l’autre sens, en cas d’absence d’interactions sociales : en 2015, l’équipe de chercheurs japonais de Seishu Nakagawa a mené une étude auprès de 776 étudiants âgés de 18 à 27 ans. Ils leur ont demandé de répondre à des questions afin de mesurer leur solitude, selon une échelle théorisée par l’Université de Californie de Los Angeles, la “UCLA Loneliness Scale”. En parallèle, ils leur ont fait passer des IRM du cerveau. Et ce qu’ils ont observé : c’est une corrélation entre les étudiants qui disent se sentir seuls et ceux qui présentent des anomalies de certaines de leurs régions cérébrales.
Ce que Ariel Frajerman m’explique, c’est que cette corrélation s’observe en particulier chez les jeunes, parce qu’ils sont à un moment clé du développement de leurs cerveaux.
Ariel Frajerman : c'est sûr que les étudiants et les jeunes de manière globale, parce qu'il n'y a pas que les étudiants qui sont en souffrance actuellement, mais les étudiants notamment, sont plus vulnérables aux conséquences du confinement, de l'isolement et de la situation que des personnes plus âgées qui ont fini leur développement cérébral et qui sont plus intégrées dans la vie.
Lucile : j’ai demandé à Ariel Frajerman si une fois le confinement terminé et les interactions sociales retrouvées, les choses pourraient revenir à la normale pour la santé mentale des étudiants ? Autrement dit : est-ce que les connexions qui n’ont pas pu être créées à cause de cet isolement forcé pourront se développer ensuite ?
Ariel Frajerman : après 25 ans, on peut aussi acquérir des capacités. Tout n'est pas perdu, mais disons que ce qu'on constate, c'est que souvent, c'est que c'est plus difficile, et ça on peut le voire même en dehors de la pathologie. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'apprendre par cœur, si on lui demande, à trente ans, de se mettre à apprendre par cœur il va avoir plus de mal.
Quand on perd des habitudes, pour s'y remettre, ça prend du temps.
Lucile : actuellement, l’habitude que l’on perd quand on est isolé.e la plupart du temps, c’est celle d’interagir avec d’autres personnes et d’être confronté.e quotidiennement à de nouvelles expériences.
Ça m'a fait pensé à ce que m’avait dit Marthani : elle a remarqué que récemment, elle n’avait plus vraiment envie de sortir, même à des moments où elle avait la possibilité de le faire.
Marthani : c'est vrai que, alors juste avant l'annonce du confinement, je me rappelle en mars parce que je ne me rappelle que de ça, j'étais avec une amie. On était allées au Starbucks, et tout. On a bu notre petit truc et tout. On a passé la journée à Châtelet les Halles, et après le soir, on a vu le discours d' Emmanuel Macron et deux jours après, c'était le confinement. Du coup, c'était vraiment compliqué parce que franchement, même si je n'allais pas tout le temps en cours, je voyais mes amis quoi. Je faisais le chemin avec une amie tous les soirs et tout et du coup, c'était compliqué de ne plus voir personne. Mais maintenant, quand les gens me disent : “allez, viens, on sort, viens chez moi”. Bah, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est loin. Je préfère rester à la maison, regarder la télé ou, ma série et tout, Netflix. Mais au fond de moi, des fois, j'ai envie de voir des gens, mais, j’ai un peu la flemme de sortir quoi, j'ai plus envie.
Lucile : c’est cette perte de l’habitude d’avoir des interactions sociales réelles qui fait que l’isolement des étudiants et des étudiantes pourrait avoir des effets sur le long terme. Car même si le cerveau est toujours modulable dans une certaine mesure, ils et elles n’auront plus l’habitude de se retrouver dans ce type de situations, et donc pourraient préférer rester dans un certain isolement social choisi.
Cet isolement a un autre effet négatif sur la santé mentale des étudiants : parce qu’ils sont isolés, cela limite leurs possibilités d’échanger entre eux sur comment ils se sentent. Certains n’en parlent même à personne. Marthani m’a confiée que j’étais la première avec qui elle en discutait de vive voix.
Marthani : le fait d'en parler avec vous, bah, c'est vrai que c'est un peu la première fois que je parle un peu de ce que je ressens, que ce soit le confinement, la peur, le stress que je suis en train de.. ce qui est en train de m'arriver. De ma tristesse, de ce vide que je ressens et tout. C'est vrai que des fois, j'ai envie de prendre mon téléphone et j'ai envie d'en parler avec quelqu'un. Ça m'arrive, mais je ne le fais pas parce que j'ai personne à qui parler. Du coup à la fin je reste.. enfin tout ça, ça reste au fond de moi et je n'en parle pas.
Lucile : pour Ariel Frajerman, ne pas avoir d’espace pour parler ne fait que renforcer ce mal-être. Il explique que les bienfaits de la parole sur la santé mentale sont un fait largement reconnu.
Ariel Frajerman : quand il y a certaines études qui se sont intéressées à comparer les différents types de psychothérapie, ils se sont rendus compte en fait que la part de la variance d'efficacité expliquée par la théorie de la psychothérapie était assez limitée et qu'en fait, ce qui était important, c'était déjà que le patient ait un lieu pour parler, qu’il s'entende bien avec son thérapeute. Donc déjà, ça, c'est très ancien. On sait l'importance de la parole, c’est très ancien. Après la question, c'est : à qui parler ? Chez les jeunes, souvent ce n'est pas vers les parents qui vont se tourner, c'est vers leurs pairs. Ce qui permet justement l'interaction sociale, que ça soit au collège/lycée ou à l'université, c'est que vous êtes avec vos pairs, vous pouvez échanger, vous pouvez discuter de vos problèmes. Là aujourd'hui, ils n'ont plus ça donc ils n'ont plus personne avec qui discuter.
Et c'est pour ça que ces lignes comme Nightline sont très importantes pour permettre justement ce lieu d'écoute et permettre aux étudiants de parler.
Lucile : Nightline, c’est une ligne d’écoute pour les étudiants, créée et gérée par des étudiants. Elle a été ouverte il y a trois ans dans le but d’offrir aux jeunes un espace où ils peuvent discuter de leurs problèmes. Depuis, chaque année, le nombre d’appels ne fait qu’augmenter. Florian Tirana, le président de l’association, m’a expliqué que depuis la fin du premier confinement, les lignes étaient constamment saturées.
Cette quantité d’appels témoigne du mal-être des étudiants, mais aussi du déficit d’infrastructures pour prendre en charge cette situation. Florian Tirana m’a expliqué que les instance internationales recommandent un ratio d’un psychologue universitaire pour 1000 à 1500 étudiants. Aux Etats-Unis, il y a un psychologue pour 1 800 étudiants. Au Royaume-Uni, il y en a 1 pour 3 000. En France, il n’y a qu’un psychologue universitaire pour 30 000 étudiants. Pour Florian Tirana, cette situation ne permet pas aux étudiants de bénéficier d’un soutien dont ils ont aujourd’hui particulièrement besoin.
Ariel Frajerman fait le même constat.
Ariel Frajerman : au niveau de l'offre de soins en psychiatrie dans le service public, il a ce qu'on appelle les CMP les Centres médico-psychologiques, il y a aussi pour les étudiants, les BAPU, les bureaux d'aide psychologique universitaire. Mais ces structures sont débordées et elles étaient déjà débordées avant la crise par un manque de moyens évident et notamment de psychologues.
Mais en fait, si on regarde les données, il y a aussi quelques études médico-économiques qui ont été réalisées qui montrent qu'un euro investi dans la prévention de la dépression, ça permet d'économiser 10 euros à terme. Chez les étudiants, les conséquences des troubles psy, ça va être un retentissement au niveau scolaire : examen raté, décrochage scolaire, sortie du système éducatif, donc des conséquences très graves pour leur vie, pour l'insertion socio économique.
Donc, ça a des conséquences sur tout le monde en fait. Donc, c'est très important d'investir dans la prévention, et c'est ce qu'ont fait les Australiens avec un grand succès. C'est ce que font d'autres pays. C'est ce que ne fait pas la France. Et c'est pour ça que l'idée n'est pas d'avoir une mesure : il y a un problème actuellement donc on fait un chèque une fois, l'idée c'est d'avoir des structures sur le long terme.
Lucile : la santé mentale des étudiants est aujourd’hui un véritable problème de société, pour Ariel Frajerman. Il explique que cette situation aura des répercussions sur l’ensemble de nos familles, de nos structures économiques, de nos modèles éducatifs et de nos systèmes de santé sur le long terme. Bien plus qu’une aide ponctuelle, c’est un développement global et durable des structures de prise en charge dont nous avons besoin pour faire face à cette crise.
En attendant, les étudiants se mobilisent et créent eux-mêmes des espaces de dialogue, comme la ligne d’écoute Nightline et le #EtudiantsFantômes. Ces initiatives, même si elles ne sont pas suffisantes, sont de véritables ressources pour les jeunes en difficulté. Preuve d’une solidarité, plus que jamais essentielle en cette période.