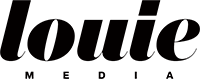Retranscription - Le deuil, une métamorphose infinie
Cyrielle Bedu : j’ai perdu mes grands-parents quand j’étais petite et adolescente. Je les aimais beaucoup, mais je les voyais très peu. Un été sur deux. Ils vivaient dans un autre pays. Je pense parfois à toutes les choses que l’on aurait pu partager, si je les avais connu quand j’étais adulte. Mais ce regret ne s’apparente pas, du moins j’en ai l’impression, au deuil qu’ont connu certaines de mes amies ou leur famille.
Je me souviens notamment qu’une amie, Myriam, m’a parlé un jour du deuil que vivait sa mère, qui avait perdu son père, dont elle était très proche. Un soir dans la cuisine, Myriam demande à sa mère comment elle tient le coup après la mort de celui-ci. Sa mère lui répond que ce qui l’aide, c’est de savoir que son père est toujours là, à ses côtés. Qu’à chaque endroit où elle va, elle sait qu’il veille sur elle, qu’il la protège. Elle le voit presque, posant les yeux sur elles, quand elle en a besoin. C’était sa façon de se raccrocher à quelque chose… pour ne pas s'effondrer.
Il y a autant de façons de faire un deuil qu’il y a de personnes, c’est ce qu’a découvert Agathe Le Taillandier en faisant cet épisode. Comment vivre quand on ne peut plus raconter des histoires à l’autre et avoir sa réaction d’emblée ? Comment vivre sans le ou la toucher, le ou la sentir ? Dans cet épisode, Agathe interroge comment le deuil est vu dans notre société et notre façon de vivre pleinement ou non avec nos morts.
Je m’appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotions.
GÉNÉRIQUE
Agathe Le Taillandier : peu après la mort de ma grand-mère, une amie m’a offert le texte de l’écrivaine américaine Joan Didion, L’ Année de la pensée magique. Elle y raconte le décès soudain de son mari, un soir banal. Elle est dans la cuisine, en train de préparer le dîner, et elle entend un bruit. Son mari tombe sur une table, victime d’une crise cardiaque foudroyante. En racontant cet événement, elle écrit ceci : “La vie change vite. La vie change dans l’instant. On s’apprête à dîner et la vie telle qu’on la connaît s’arrête”.
Pour Joan Didion, la vie bascule et le deuil teinte alors en permanence le quotidien d’une nouvelle couleur. L’expérience de la perte recouvre une multitude d’émotions que l’on serait bien incapable de comptabiliser ou d’organiser.
Pour beaucoup, le deuil est aussi un nouvel état au monde, en compagnie, toujours, des disparu.e.s. C’est ce qu’exprime l’écrivaine Sarah Chiche dans un très beau livre paru en 2020, intitulé Saturne : “Le deuil n’est pas toujours le lieu d’une douleur ou d’une affliction” formule-t-elle. Elle ne se sent pas séparée de son père mort alors qu’elle était enfant, car selon ses mots, : “On peut vivre pleinement avec ses morts, dans ses morts, dans ces mondes engloutis et ce n’est pas triste pour autant…”. C’est d’ailleurs pourquoi, dit-elle / "On ne fait jamais son deuil : on est fait par le deuil ou on fait avec et c’est tout ».
Musique
Magda : je me souviens d’un soir, je pense que c’était deux ou trois mois après le décès de mon père, je passe une soirée avec mon amie Emilie, qui elle-même a perdu son père il y a plusieurs années maintenant, et je me souviens de lui demander dans un grand moment de désespoir : “Comment on fait pour en guérir ? Est ce qu’à un moment on guérit de ça ? Dans combien de temps ?”... J’étais dans des trucs comme ça. Et j’ai le souvenir hyper ému de la voir tellement tendre et désarmée en même temps... elle m’a vraiment regardé, et j’ai su que ça ne se guérit pas.
Et d’un seul coup, ce soir-là elle me dit : “Mais tu sais, mon père, il est là, en fait il est à côté de moi”. Et elle me le dit comme ça. “Souvent… je ne sais pas comment te le dire autrement, souvent mon père, il est assis à côté de moi”. Et ça m’avait renversée, c’était superbe.
Musique
Agathe : vous venez d’entendre la voix de mon amie Magda. Elle a perdu son père à la suite d’un cancer fulgurant, le 6 décembre 2018. Pour moi, elle incarne ce que la vie a de plus puissant : avec sa tignasse bouclée et son regard brillant, je voulais que ce soit elle qui me parle de la mort et des métamorphoses qu’elle produit chez les vivants. Je lui ai donc demandé ce qu’elle avait ressenti en elle après la mort de son père.
Magda : les premiers mois, j’avais l’impression d’être dans un état de survie, et de libido, de puissance de vie décuplée. Je travaillais comme une furie, j’ai eu de très nombreuses histoires et aventures diverses et variées, non stop. Mais je ne sais pas comment dire... ça ne s’arrêtait pas. Et j’ai fait des trucs un peu de dingue quand même : je suis partie au Niger, sur un coup de tête, parce que j’ai eu un amant au Niger. Je me souviens d’avoir formulé : “J’ai plus peur de rien maintenant, ça y est, c’est arrivé, donc il n y a plus rien qui me fait peur”.
J’ai un souvenir physique très particulier, d’être à la fois, flottante et ancrée, et j’avais l’impression d’être boostée par quelque chose qui me dépassait complètement, et qui doit s’appeler le malheur je pense… mais c’est vraiment de la survie aussi. Et due à cette énergie, la tristesse elle vient par vague, elle vient tout prendre, elle est violente, elle est accrue. C’est aussi compliqué parce que comme je voyais beaucoup de gens, je faisais tout le temps la fête, j’étais tout le temps au travail, les phases de solitude et donc de retrouvailles avec soi, elles étaient rares et donc assez violentes aussi, mais c’était vraiment pas le pire. Pour moi, le pire de la tristesse, c’est arrivé après.
Agathe : c’est exactement ce que formule l’écrivain et sémiologue Roland Barthes dans son Journal de deuil dans lequel il partage son chagrin suite à la mort de sa mère. Le 14 juin 1978, on peut lire cette phrase écrite sur une plage blanche: “(Huit mois après), le second deuil”. Cela me fait penser à l’expérience de Magda. Au mois de juillet 2019, donc environ 8 mois après la mort de son père, son corps l’arrête dans cette course effrénée. Magda a le sentiment d’étouffer, elle est épuisée et obligée de s’arrêter de travailler pendant plusieurs semaines. C’est là que le vide prend toute sa profondeur.
Magda : plusieurs mois après… Parce qu’il y a le manque en fait qui vient s’ajouter et la compréhension hyper concrète que cette personne ne reviendra pas. Enfin je dis ça “hyper concrète”, c’est faux. Parce qu’il y a encore des moments aujourd’hui où presque deux ans après, où j’oublie, qu’il est mort. Donc, en fait j’ai pas encore du tout intégré la disparition pour toujours, néanmoins ce que j’ai intégré là, c’est que ça fait tellement de temps que je l’ai pas vu.
Le temps qui passe parfois, je crois, empire la grande tristesse qui s’installe. Et je me souviens aussi d’une discussion que j’ai eue avec mon compagnon actuel, qui a également perdu son père, qui m’a dit : “Ça restera toujours, ça sera toujours là.”
Agathe : en l’écoutant, je me disais que l’on est loin des “étapes” préconçues du deuil, loin d’un deuil structuré par des phases précises et ascendantes. Vous les avez peut-être en tête. C’est la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross qui les a formulées dans les années 70. Les voici : tout d’abord, le déni, marqué par un sentiment d’irréalité. Puis, la colère. Ensuite le marchandage, soit la fabrication de scénarios du type : “Et si la personne revenait ?” ou “Voilà ce que je pourrais faire pour qu’elle revienne”. Enfin, vient la dépression, jusqu’à la dernière étape, qu’elle appelle l’acceptation finale.
J’ai interviewé sur skype la psychanalyste et professeure de psychopathologie à l’université de Strasbourg, Marie-Frédérique Bacqué. Elle travaille particulièrement auprès des personnes confrontées à la mort et au deuil. Elle reconnaît le fait qu’il n’y a pas d’étapes figées même si elle parle tout de même d’un processus de deuil. Elle observe d’ailleurs des mouvements psychologiques récurrents chez ses patientes et patients.
Marie-Frédérique Bacqué : d’abord, si je devais décrire le processus du deuil, je décrirai les effets physiques de la perte, c’est-à-dire un : le manque, deux : les tentatives de réduire ce manque par une forme d’hallucination de l’autre, c’est bien décrit par Sigmund Freud, c’est-à-dire que lui - traduit par les français - appelle ça “une hallucination du désir”, c’est-à-dire que je vais reproduire la sensation de bien-être et de sécurité que j’avais lorsque mon proche était avec moi. Et c’est comme ça que pour certains endeuillés, on voit des phénomènes, souvent qui restent cachés mais qui peuvent être révélés à un psychologue : “Je souffre tellement que j’essaie de me remettre en conditions d’avant, quand l’autre était là, pour me faire du bien pendant un petit moment”. Par exemple, une jeune femme me dit : “Il rentrait vers 7h30 le soir et en fait, de 7h à 7h30 je me mets dans une illusion qu’il va rentrer”. Et donc, pendant cette demie-heure que j’arrive à maintenir, j’ai le sentiment qu’il va revenir et donc je retrouve mon état d’avant, mon état de bien être d’avant”.
Et donc au début du deuil les gens vont reprendre les vêtements, les gens vont reprendre les objets.. ils vont s’en entourer de façon à recréer cette illusion de la présence d’autrui.
Agathe : ce premier mouvement, cette illusion que la personne défunte va revenir, se transforme, selon la psychanalyste Marie-Frédérique Bacqué, quand le constat que l’autre ne revient pas s’impose. L’endeuillé prend alors conscience de l’irréversibilité de la mort du proche.
Roland Barthes écrit le 12 février 1978 dans son Journal de deuil : “Neige, beaucoup de neige sur Paris, c’est étrange. Je me dis et j’en souffre : elle ne sera jamais plus là pour le voir, pour que je lui raconte”.
Marie-Frédérique Bacqué : donc, le deuxième temps de cette acceptation de la réalité de la mort va se traduire par un état de tristesse profond parce que l’espoir est définitivement perdu. C’est ce que Freud a appelé “la dépression normale du deuil”, (dépression, ça veut dire baisse de pression). Cela signifie aussi acceptation de l’absence d’espoir. Et donc la dépression du deuil se traduit par un renoncement.
Agathe : Magda m’a raconté comment ces deux mouvements, l’illusion de la présence de l’autre puis, la conscience violente et douloureuse de son absence peuvent s’entrelacer.
Magda : c’était aussi ma mère, ça me faisait énormément de peine. Dans les premiers moments où on réussissait à passer des bons moments, systématiquement, ma mère avait ce réflexe de lui raconter, de vouloir lui raconter. Et pour le coup, dans les premiers temps, c’est hyper dur d’oublier. Parce qu’en fait du coup, tu te souviens quoi, qu’il est plus là. Il y a cette espèce de truc où “paf”, il y a quelque chose comme ça qui vient vraiment s'écrabouiller par terre.
Musique
Agathe : Marie Frédérique Bacqué cite à plusieurs reprises un texte fondateur : Deuil et mélancolie qu’écrit Freud en 1917, dans un contexte de deuil collectif, après la Première Guerre mondiale. Il y formule notamment l’idée de “travail de deuil”. Dans le Vocabulaire de la psychanalyse, paru en 1967, on peut lire une définition de cette expression : “Processus intrapsychique, consécutif à la perte d’un objet d’attachement, et par lequel le sujet réussit progressivement à se détacher de celui-ci.”
Cette idée d’un détachement nécessaire, pour que le deuil se fasse, a largement été critiquée. Ainsi que le mot “travail”, qui impliquerait l’idée d’un effort, sur un temps donné, pour obtenir un résultat final. Alors que ce processus n’est absolument pas figé et plus complexe dans sa progression, comme me le confirme Magda.
Magda : t’as pas la sensation d’avancer vers un point mais de vivre des espèces de boucles, de pics, de retours en arrière, d’avancées, parce qu’au moment où tu te dis : Tiens, là ça va mieux” et paf, il y a quelque chose qui vient s’abattre et, à d’autres moments où tu te dis : “Tiens là je devrais être super triste, et c’est pas ça qui se passe”.
Agathe : pourtant les injonctions sont nombreuses pour que le vivant “fasse son deuil”, selon l’expression consacrée. Pour qu’il ne plonge pas dans un chagrin trop profond qui viendrait désorganiser, voire menacer l’ordre social. En effet, d’un point de vue social, le deuil a tout intérêt à avoir une durée limitée, à être canalisé.
En 1890 est publié l'ouvrage, Le rameau d'or, de l'anthropologue écossais James Frazer. Ce livre, qui rassemble et étudie une centaine de mythes et de religions, est une œuvre fondamentale de la littérature ethnologique mondiale. James Frazer y observe notamment que dans de nombreuses sociétés primitives, des rituels étaient organisés pour pousser les endeuillés à rejoindre la communauté des vivants. Car ces personnes, trop proches trop longtemps du monde des morts, pouvaient représenter un danger pour le groupe social. Le deuil a donc toujours été, et partout, organisé socialement. La psychanalyste Marie-Frédérique Bacqué rappelle que pendant longtemps, en France, ce sont d’ailleurs les discours religieux qui domestiquaient le deuil.
Marie-Frédérique Bacqué : pendant longtemps, ce sont les religions qui ont finalement “prescrit” les différentes étapes du deuil pour obliger littéralement les endeuillés à changer de registre par rapport à leurs morts. On devait ranger, comme on le disait au Moyen-Age, les “pleuroirs”, c’est-à-dire des grands mouchoirs de dentelles avec lesquels on s’essuyait les yeux, on devait ranger ça au bout d’un an ! C’était la prescription sociale. Donc nous sortons à peine de cette période, où c’étaient les religions qui nous disaient ce qu’il fallait faire, ce qu’il fallait penser…
Aujourd’hui, on voit bien que par delà les prescriptions religieuses, il y a des consignes qui peuvent être les consignes du monde du travail. Dans le travail, si vous perdez un parent, vous en avez pour 5 jours. Mais après c’est terminé ! Et les consignes sociales, c’est ce dont se plaignent tous les endeuillés… c’est-à-dire que tout le monde me dit, dans mon entourage : “Tu peux te mettre sur les réseaux sociaux, t’as qu’à aller sur meetic et tu trouveras un nouveau mari !”. Donc ces prescriptions sont des prescriptions sociales.
Agathe : Marie-Frédérique Bacqué constate qu’il est souvent difficile d'accepter et de comprendre la douleur de l’autre dans la durée, que les maladresses sont nombreuses dans les réactions. J’ai demandé à Magda si elle avait pu ressentir cela aussi. Elle m’a rappelé que cette souffrance est une expérience profondément solitaire et parfois difficile à partager avec les autres.
Magda : ce que ça crée par rapport à l’entourage direct, c’est que tu sens et tu le vis, au delà de le sentir, tu l’éprouves, qu’il y a des gens qui ont envie de parler de ça, qui peuvent entendre, qui peuvent accueillir cette épreuve pour l’ami, et d’autres, qui sont pourtant des grands amis, qui sont incapables de ça, parce que c’est trop fort de voir la personne, ton amie qui souffre autant, c’est trop dur le miroir que ça provoque.
Et ce qui m’a beaucoup aidé, quand même, c’est… ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire mais, quand tu perds un parent, tu rentres dans “une communauté”. Et c’est clair, tu rentres dans une communauté de gens qui ont traversé ça. Et moi j’ai reçu immédiatement des conseils et des mots qui m’ont particulièrement portée, supportée, de personnes qui avaient elles-mêmes perdu leurs pères. Y’a une forme de réconfort de parler avec les gens qui ont perdu, parce que “on se sait”.
Agathe :s’il est aussi difficile de réagir, de trouver les mots, d’accompagner l’autre dans cette expérience douloureuse, c’est aussi parce que nous vivons dans une société au sein de laquelle la mort est taboue. Réduite souvent au silence et au déni. Le sociologue Tanguy Châtel, spécialisé dans les questions de fin de vie et de deuil, me l’a confirmé : dans ses recherches, il observe régulièrement ce refoulement de la mort, autant au niveau individuel que politique et cherche à proposer des dispositifs d’accompagnement.
Tanguy Châtel : c'est organique, le deuil, c'est vivant, ce n'est pas mortel, c'est pas mortifère. Personne n'échappe au deuil. Et même si on a “la chance” de ne pas avoir perdu de proches, il y a toujours des deuils qui se tiennent dans notre vie, que ça soit quand on perd la santé, quand on perd son emploi, quand on perd son conjoint, que sais je ? Et nos sociétés ne savent plus quoi faire de la question de la perte. Nous considérons que c'est négatif, que c'est à proscrire, alors que ça fait partie du processus de maturation que de savoir perdre pour trouver ce qui se tient derrière la perte. Donc ça, ça mérite d'être accompagné. Sauf que c'est encore très marginal l’accompagnement du deuil : les professionnels de santé ne savent pas s’y prendre. Les assos d’accompagnement sont très peu nombreuses, pas identifiées dans le paysage. Et moi, c'est ça qui me désole. C’est tellement une expérience naturelle de la vie que je ne comprends pas qu'on ne l'explore pas d'un point de vue social de manière plus profonde. Et quand je vois le retard, presque choquant, qu’à le ministère de la Santé a sur la question du deuil puisqu'il ne la connaît pas, il ne la documente pas, il n'y a pas d'études. On ne veut pas savoir, il n'y a pas de chiffres. Il a fallu qu'on fasse quelques enquêtes pionnières depuis 2016 pour commencer à avoir des premiers chiffres significatifs sur le deuil, alors que le Covid est là pour nous montrer que c'est un sujet qui concerne tout le monde, que c'est un sujet qui doit aussi pouvoir rassembler tout le monde.
Bref, il est grand temps qu'on en fasse un sujet digne de la place qu’il occupe dans l’expérience humaine.
Agathe : Tanguy Chatel rappelle que “ce processus organique”, selon ses mots, est une expérience profonde, dans le temps, que l’on ne doit aucunement taire pour se soumettre à un diktat social désireux de réduire la mort au silence.
Tanguy Châtel :le deuil, c’est toujours intéressant de revenir à l'étymologie du mot deuil. Ça vient de “dolus” en latin, qui veut dire en gros deux choses : la douleur, il ne faut pas nier que le deuil, c'est une séparation, parfois un arrachement, et donc il y a une forme de douleur qu'il faut traverser et pas simplement balayer du revers de la main. Deuil, ça veut aussi dire duel. Il y a la dualité. Le deuil, c'est l'expérience où je ne veux plus vivre, mais je veux encore vivre ; où tu es parti, mais tu es encore un peu là ; où je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais en même temps, j'ai confiance dans la vie. Bref c’est un entre deux.
Une fois qu'on a compris ça, on comprend que le travail du deuil n'est pas quelque chose que je vais faire en me mettant à table, comme je fais mon travail après la classe. Ce n'est pas un travail volontariste, c'est un travail au sens presque latin, où je me laisse travailler par le deuil. Ce n'est pas moi qui travaille le deuil, c'est le deuil qui me travaille, c'est-à-dire qui me transforme.
Agathe : il s’agirait alors de s’émanciper de ce “déni de la mort” pour redonner toute son épaisseur et sa valeur à cette expérience de la perte. Ne pas se débarrasser de ses émotions donc, mais bien les vivre pleinement, sans se plier aux injonctions sociales. Reconnaître que la perte et l’irréparable persistent dans le temps. Et que le deuil ne s’achève jamais réellement. Cette idée est au cœur de l’essai de l’écrivain Philippe Forest et du philosophe Vincent Delecroix, intitulé Le deuil, entre le chagrin et le néant. Contre le travail de deuil, ils revendiquent eux, un droit à la mélancolie, qu’ils définissent comme un attachement dans le présent à ce qui est perdu.
“Je ne souhaite rien d’autre qu’habiter mon chagrin”, écrit Roland Barthes, le 31 juillet 1978 après la disparition de sa mère. Ces mots font écho à ceux que m’a confiés Magda au cours de nos échanges. Nous sommes deux ans après la mort de son père, et pourtant.
Magda : quand je sens que là d’un seul coup, j’ai une vague, que ça arrive encore, j’ai pas envie de balayer, j’ai de l’émotion qui vient, je veux pas la chasser parce que j’ai aussi la sensation que cet espace à l’intérieur de soi, il faut lui donner du temps. C’est comme la petite sépulture, il faut s’en occuper, lui donner de la lumière parfois, faut l’arroser, c’est aussi comme ça que ça se transforme. Enfin moi en tout cas j’aurais pas envie de fuir ça.
Agathe : c’est cette émotion que parvient à mettre en mots l’écrivaine Anne Pauly, dans son très beau livre sorti en 2018 Avant que j’oublie, sur la mort de son père. Elle y explore avec minutie les réalités du deuil : la maison à vider, les souvenirs à trier, le monde à réapprivoiser. En une centaine de pages, elle dissèque avec rigueur et précision la traversée du chagrin, sans chercher à le guérir. Je l’ai rencontrée dans sa maison, un matin d’octobre pluvieux pour lui demander en quoi l'écriture lui avait permis de faire une place de choix à cette petite sépulture dont parle Magda. Pour elle, l’écriture de ce livre a été cathartique.
Anne Pauly : en tout cas cathartique, ou en tout cas de réexploration, on met tout à plat avant que tout ça ne s’efface pour toujours. Ça permet de traverser l’émotion bien sûr. Le point de départ de l’écriture c’est vraiment ça, c’est le vide qui s’ouvre sous tes pieds au moment où ça se produit. C’est pire qu’un étonnement, les bras t’en tombent littéralement. C’est fou la mort, et puis en plus on n’en parle jamais, donc comment pourrais- tu pourrais savoir ? Et finalement, je crois bien que j'ai écrit un livre que j'aurais aimé pouvoir lire à ce moment-là. J'ai écrit un livre un peu utile, finalement, qui m'a été utile à moi, et dont je découvre qu'il est utile à d'autres gens parce qu'on me racontait que les gens… c'est un livre que les gens s’offrent énormément les uns aux autres, en famille particulièrement, et c'est aussi un livre… Je rencontre pas mal mes lecteurs et ils me disent que c'est un livre qui les a aidés à pleurer, par exemple, à verser les larmes qu'il n'avait pas pleurer avant ou à rire d'une situation dont il n'avait pas osé rire jusque là, parce que c'est très solennel, la mort, là, tout d'un coup. Tout ça avec l’Eglise, le protocole, le patriarcat... Bon, on va mettre tout ça dans une boîte, on va agiter, on va voir ce que ça fait au bout du compte. (rires)
Agathe : quand Anne Pauly évoque ici le poids du patriarcat, cela m’a fait penser à l’épisode d'Émotions, réalisé par Antoine Lalanne-Desmet sur les hommes qui ne pleurent pas… ou plutôt qui sont conditionnés à ne pas pleurer, et cela m'a rappelé le personnage de Thibaud à qui il donne la parole sur les larmes impossibles en temps de deuil. Mais ici, avec Anne Pauly, on a autant le droit de rire que de pleurer ! C’est exactement ça que j’ai tant aimé dans ce livre : les scènes absurdes, cocasses qui viennent se cogner au chagrin et aux rituels. C’est tellement vrai !
Ça m'a rappelé ma propre expérience et mon échange absurde avec le thanatopracteur venu “habiller” ma grand-mère pour son enterrement et sa question triviale tellement décalée par rapport à mon chagrin : “Et mademoiselle, on lui met le soutien-gorge sous la chemise ou pas ?”.
Anne Pauly : en fait, dans la réalité, le réel s’exprime dans ces moments-là de manière complètement absurde. Tous les protocoles sont hyper raides, tout dérape en permanence, tout est drôle en fait. Après, c’est ma position dans le monde, j’arrive toujours à voir la rigolade dans les endroits les plus sombres, c’est ce qui permet de rester en vie d’ailleurs. Et c’est ce dont j’ai hérité de ce père-là. Mais j’ai écrit aussi dans ce contraste d’émotions pour que ce ne soit pas trop pénible pour mon lecteur, ni pour moi d’ailleurs. Je me disais : “Là ma fille tu te vautres, c’est pas possible, il faut rigoler un peu…”. Et ça décrit finalement bien les mécanismes de survie que tu mets en place à ce moment-là. Par exemple, la distance que ça procure de voir les choses comme un film. Il y a une scène dans ce livre, où on arrive au cimetière, bientôt le corps va être en terre et entre temps, le corbillard arrive à fond la caisse et manque d’écraser les gens qui sont là. C’est évidemment une manière de mettre à distance.
Agathe : la vie continue, avec ses émotions, profondes et contradictoires. Il ne s’agit pas de s’en débarrasser, mais bien de les traverser et de vivre pleinement avec son deuil sans mettre nos fantômes au placard, pourrait-on dire. La philosophe belge Vinciane Despret a mené ainsi une enquête extrêmement riche sur les relations qu’entretiennent les vivants avec leurs morts tout au long de leur vie. Pour elle, la question du temps souvent posée pour interroger le deuil et sa supposée guérison n’est finalement pas la plus importante. Elle, elle s'intéresse plutôt aux lieux de nos morts. C’est la question centrale de son livre Au bonheur des morts, récits de ceux qui restent. Trouver un lieu ou des lieux pour nos disparus s’inscrit, pour Vinciane Despret, au cœur du processus de deuil.
Vinciane Despret : et la place du mort, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire : où est-ce qu'on va le mettre, où est-ce qu’on va mettre le corps ? Est-ce qu'on le transforme en cendres ? Est-ce qu'on crée une tombe dans un caveau familial ? Est-ce qu'on l'enterre au bord de la mer ? Et puis, une fois qu'on a statué sur la place du corps, en fait, il y a toute une enquête qui va se faire aussi, c’est, il est où ? Il y a des gens qui décident de ne pas faire cette enquête, ceux qui sont morts ne sont pas là, etc. Mais pour les gens pour qui la question laisse plus de doute : où est ce qu'il est ou est ce qu'il voudrait être ? Quelle place je lui donne ? Est-ce que je vis avec lui tous les jours, par exemple ? Ou bien est-ce qu'il y a des lieux de rendez-vous ? J’ai rencontré des gens, par exemple, qui m'ont raconté qu'ils avaient instauré des lieux de rendez-vous avec leur morts, par exemple, ça peut être dans un parc à tel endroit, où ils vont fréquemment, avec le but très clair de passer un moment consacré à des formes de présence ou en tout cas des formes de pensée, des formes de souvenirs, où c'est là que ça se ferait et pas ailleurs. Et donc, c'est là que sera le mort. Ce lieu, il n’est jamais déterminé à l’avance, il va falloir le trouver. Et je pense que tout le travail de ce qu'on appelle le deuil, et qui n'est pas du tout un travail au sens de détachement, c'est plutôt une mise au travail de questionnements, d'un processus d'enquête qui vise à créer des formes de vérité.
Musique
Agathe : le deuil devient donc pour Vinciane Despret le lieu de récits que chacun se raconte en compagnie de ses morts. Intimement et librement. Elle s’oppose à une vision matérialiste de la mort qui voudrait liquider ceux et celles qui sont parti.e.s et défend une porosité entre le monde visible et invisible. C’est une expérience intime qui l’a poussée à écrire ce livre philosophique, Au bonheur des morts : la mort de sa sœur et certaines réactions contre lesquelles justement elle se dresse avec force.
Vinciane Despret : c’est d'abord un coup de colère, très vite après sa mort, parce qu'une psychologue qui avait demandé à mon beau frère : “Qu'est ce que vous avez dit aux enfants à propos de la mort de leur maman?” , et mon beau-frère avait dit : “Bah, moi, je viens d'une famille catholique. On a des ressources dans la culture catholique populaire. Je leur ai dit que leur maman était au ciel et qu'elle veillait sur eux”. Et la psychologue lui avait répondu d'un ton un peu sec : “Mais vous ne pouviez pas dire ça ! Vous deviez dire que vous ne savez pas parce qu’on ne sait pas où sont les morts”.
Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Pourquoi est-ce qu'on vient obliger les gens à prétendre ne pas savoir, alors qu'il y a des réponses, qui ne sont pas de l'ordre du savoir, mais de l'ordre des spéculations ! Et ce sont des hypothèses qui aident à vivre et qui aident à donner du sens.
Agathe : Vinciane Despret s’appuie notamment sur les recherches du psychanalyste Jean Allouch et sur son ouvrage Erotique du deuil, au temps de la mort sèche, paru en 1995. Il y décrit notre rapport à la mort dans l'histoire et le moment de bascule marqué par le positivisme du philosophe français, Auguste Comte.
Vinciane Despret : notre laïcité, notre matérialisme à propos de la présence des morts est une affaire extrêmement récente puisque d’après Jean Allouch, elle commence plus ou moins à la moitié du 19è siècle avec le positivisme d’Auguste Comte, et la mort romantique, c’est-à-dire qui est purement mentale, qui est purement symbolique. Et puis, cette conception va trouver un très bon écho dans le fait de la laïcisation de la société et de l’exclusion progressive de l’église et du clergé hors des sphères et des soins, et des pouvoirs, et de la spiritualité. Et donc les morts, une fois qu’on s’est débarrassés finalement des passeurs religieux, n’ont plus d’autre état que l’état matérialiste. On est dans une culture finalement assez restreinte, historiquement constituée il y a peu de temps, et pourtant on nous demande d'adhérer à ces conceptions comme si elles étaient la seule possibilité d’envisager les relations avec les morts ! Et puis quand on interroge autour de soi, on voit qu’en fait les gens n'adhèrent pas du tout à cette conception ! Mais qu’ils osent pas en parler parce qu’ils ont peur d’avoir l’air bizarres, ou fous, archaïques ou primitifs… Bref, donc ça veut dire que les gens ont des vécus personnels extrêmement riches et intéressants, mais qu’ils sont obligés de les garder pour eux.
Agathe : son livre, s’il consacre des passages à une réflexion théorique, est peuplé de ces expériences faites par des personnes qu’elle a rencontrées au cours de son enquête. Ils font tous preuve d’”inventivité”, selon ses mots, pour parler à leurs morts, par le biais de lettres, de souvenirs, ou même de signes. Vinciane Despret consacre un très beau chapitre aux signes que l’on peut percevoir parfois, si on les cherche dans le réel. Elle les définit comme “un hasard qui nous donne rendez-vous”.
Vinciane Despret : je pense que le fait de perdre quelqu'un rend les gens particulièrement disponibles aux signes. Les signes, c’est souvent avec de l'électricité. C'est souvent avec des animaux qui apparaissent. Ça peut être aussi des phénomènes météorologiques qui coïncident, du style : il ne devrait normalement pas neiger le jour de l'enterrement de votre papa. Et puis, vous êtes à l'enterrement, il se met brutalement à tomber une neige magnifique alors que vous êtes en plein mois de mai. Et... il y a une voiture qui passe avec la musique qu'il préférait. C’est peut-être quelque chose qui est en train de se passer, il y a une convergence d’événements qui fait sens, voilà, c’est comme s’il s’adressait à vous.
Agathe : Vinciane Despret m’a donné un autre exemple. Un merle se pose sur ma fenêtre, puis deux jours plus tard, je vois un autre merle voler dans le ciel. Quelques jours plus tard, j’assiste à un enterrement et le même oiseau se pose sur la tombe de la personne disparue. Et je me rappelle qu’il ou elle adorait les oiseaux. Ces trois expériences distinctes, éloignées temporellement, vont tout à coup faire écho en moi : ce n’est pas un enchantement, mais un récit possible que je me m’adresse.
Vinciane Despret : un signe c’est un événement qui normalement n’est pas connecté avec sa répétition va d’un seul coup être connecté avec cette répétition, c’est ce que j’appelle une contraction. C’est-à-dire que trois événements qui sont séparés dans le temps d’un seul coup vont être mis ensemble. Il y a une opération de tri qui est différente.
Agathe : l’écrivaine Anne Pauly avec qui nous avons parlé de ces moments drôles, un peu absurdes, liés à la mort, partage cette idée d’un dialogue intime avec nos morts, si on choisit bien sûr de le nourrir.
Anne Pauly : je suis à peu près persuadée que les morts sont avec nous. Et puis, c'est une histoire de culture aussi. Par exemple, au Japon, tu sais que dans les villages, on met des fontaines pour que les morts puissent s'abreuver. Donc ça veut dire qu'ils sont parmi nous. Ils ont soif aussi des fois, et ils s'arrêtent pour boire un coup. C'est aussi pour continuer à se raconter une histoire. Parce que ce qu'il y a de terrible dans la mort, c'est que ça s'arrête là, et que c'est invraisemblable pour nous un truc qui s'arrête là, c'est non seulement invraisemblable, mais en plus, c'est intolérable. Donc, multiplier les passerelles, en quelque sorte, et voir des signes partout, c'est une manière de continuer l'histoire, de continuer la conversation, parce que pour continuer à vivre, il faut continuer à se raconter une histoire, se projeter, avoir des projets, et sans ces histoires-là, tu ne peux pas vivre. Donc se fabriquer des signes, en inventer peut-être, ça nous permet de continuer à développer cette narration qui nous permet d'être en vie.
Agathe : continuer l’histoire, c’est justement ce que fait Anne Pauly dans Avant que j’oublie. Six ans se sont écoulés entre la mort de son père et la publication de son livre. Six ans de maturation, mais aussi de mouvements intimes qui permettent à Anne Pauly de mettre en mots ce père “cow boy” ou “colosse”, ce père à la sensibilité cachée, aux élans poétiques restés dans l’ombre de sa vie virile et provinciale. Elle reconstruit le puzzle d’une vie dont elle ne connaissait bien sûr pas toutes les facettes, et dessine le portrait de son père au fil du deuil. Pour finalement “offrir un tombeau” à la vie ordinaire et discrète de cet homme. Dans les mots de la psychanalyste Marie-Frédérique Bacqué, on pourrait appeler cela, le processus d'intériorisation du mort.
Marie-Frédérique Bacqué : c’est-à-dire ce que mon mort m’a apporté, ce qu’il a pu permettre au monde par exemple. Et donc cette recherche des qualités, mais aussi des défauts du mort va permettre son intériorisation. C’est un processus psychologique, et à partir de ce moment- là, ce processus de sublimation va permettre de se réorganiser, de ne plus disparaître avec autrui. Et comme le dit Freud dans une très belle phrase : “La différence entre la dépression et le deuil est la suivante : dans la dépression, c’est le moi qui disparaît avec l’autre, dans le deuil, c’est le monde qui disparaît". Donc après le deuil, le monde est de nouveau possiblement réinvesti.
Musique
Agathe : Magda m’a décrit au fil de nos discussions cet horizon, formulé par la psychanalyste Marie-Frédérique Bacqué comme le processus d’intériorisation du mort.
Magda : après, il y a d’autres choses qui viennent, notamment la capacité de se souvenir de lui avec de la joie, et aussi de l’humour. Mon père était quelqu’un d’hyper drôle. Maintenant c’est possible de penser à lui et de me marrer ou de me dire -vivant telle ou telle situation- que ça le ferait rire. Là je dirais même au niveau familial, parce que c’est venu tout transformer et de façon assez violente, là il y a des choses nouvelles qui arrivent. Alors je parlerai pas du tout de rétablissement, mais il y a un nouvel équilibre qui peu à peu est en train de s’organiser, qu’on apprend. J’allais dire qu’on est tous en train d’apprendre cette nouvelle vie. Et donc parfois avec un renouveau de joie et de possibles. Le deuil c’est un principe de métamorphose, ce que tu découvres c’est que tu peux te transformer et en fait le mort se transforme aussi.
Agathe : ainsi, comme l’explique la psychologue Magali Molinié dans son texte : Soigner les morts pour guérir les vivants, : “Le mort est engagé dans un processus de transformation conjointe avec le vivant”. Si les émotions et les réactions du vivant se métamorphosent comme vient de l’expliquer Magda, le disparu lui aussi endosse une nouvelle enveloppe. Les rêves de Magda sont par exemple le lieu de cette transformation.
Au départ, ce sont les images du corps malade et affaibli de son père qui écrasent les autres. Une fois, c’est son père devenu aveugle qui vient lui rendre visite dans sa chambre alors que pourtant elle insiste sur le fait qu’il a été enterré avec ses lunettes.
Et puis peu à peu, des rêves plus vivants, même joyeux, voient le jour dans lesquels son père existe autrement.
Magda : je me souviens que le premier beau rêve que j’ai fait sur la mort de mon père, c’est que j’ai rêvé de son cercueil, il devenait un monument, hyper vivant. Et dans ce rêve, le cercueil de mon père s’érigeait comme une montagne, j’allais dire, pas du tout comme un truc phallique de gros mâle, mais comme un phénomène complètement naturel. C’est la montagne. Donc il y avait des espèces de gargouilles, qui sortaient. Et là, les animaux reprenaient vie mais restaient accrochés à la montagne, et il y avait des oiseaux comme ça magnifiques. Et je me souviens vraiment de m’être dit : “Ça y est je suis prête”, enfin j’avais hâte en fait de retourner dans des rêves où je pouvais rêver et panser/penser (au deux sens) l’absence et d’y penser autrement.
Agathe : mais au fond, la plus belle manière que Magda a trouvé pour continuer à communiquer avec son père, c’est de créer une pièce de danse pour lui. Magda est artiste et elle signe le spectacle Macchabée, pour une danseuse, Alice, sur le plateau. C’est une danse macabre, un rituel funéraire, comme une manière de prendre soin de son père, de s’adresser à lui. A la fin de son spectacle, elle a façonné une aurore boréale sur la scène, un peu bricolée. Parce que, m’explique Magda, les Inuits pensent que les aurores boréales sont envoyées par les morts, comme des messages pour les vivants.
Magda : c’est aussi comment je prends partout la moindre possibilité, le moindre pont…. pour pouvoir être avec lui et me dire : “Mais là c’est sûr en fait, c’est tellement ouf ce que je suis en train de faire, il peut pas ne pas voir que je lui ai fait une putain d’aurore boréale (rires)!! C’est fort quand même”.
Musique
Agathe : alors au fond, chacun se raconte ses propres récits : en riant ou avec sérieux, en les cachant ou en les partageant… Chacun façonne le deuil à sa façon, souvent sans vouloir mettre un point final aux histoires que l’on murmure à nos disparus. Et si le chagrin peut s’habiter dans la durée, il se métamorphose, petit à petit, au rythme des vivants.
Je finirai avec les mots de Joan Didion, cette écrivaine américaine dont le mari est mort brutalement, et qui a écrit L’année de la pensée magique : “Je me rends compte, en écrivant ces mots, que je ne veux pas atteindre le terme de ce récit. Je ne voulais pas non plus atteindre le terme de l’année. La démence se dissipe, mais aucune clarté ne vient prendre sa place. Je cherche une résolution et n’en trouve aucune.”.
GÉNÉRIQUE DE FIN
Cyrielle : vous venez de lire Émotions, un podcast de Louie Media. Suivez-nous sur Instagram et Twitter @emotionspodcast (émotions, avec un s). Vous y trouverez des lectures intéressantes, sur la compersion ou sur les émotions en général.
Agathe Le Taillandier a réalisé cet épisode sur le deuil. Merci à ses interlocutrices et à ses interlocuteurs de lui avoir accordé de leur temps. Vous retrouvez leurs œuvres et leurs références sur notre site : Louiemedia.com.
J’étais en charge de la production et de l’édition de cet épisode (Cyrielle Bedu). Benoit Daniel s’est occupé de l’enregistrement. Marine Quéméré a fait la réalisation. Jean-Baptiste Aubonnet s’est occupé du mixage et Nicolas de Gélis a composé le générique d’Émotions.
Marion Girard est responsable de production de nos podcasts, Maureen Wilson, responsable éditoriale, Melissa Bounoua est à la direction des productions, et Charlotte Pudlowski est directrice éditoriale.
Émotions, c’est un lundi sur deux, là où vous avez l’habitude d’écouter vos podcasts : iTunes, Google podcast, Soundcloud, Spotify ou Youtube.
Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si ça vous a plu, parlez de l’émission autour de vous !
Si vous aimez Émotions, vous aimerez sûrement nos autres podcasts comme “Travail en cours”, le Book Club, “Entre” ou notre tout dernier podcast “Passages”, un podcast d’histoires vraies qui questionne notre point de vue.
S’il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n’hésitez pas à écrire sur Twitter @apjzpty ou à hello@louimedia.com. A très vite !