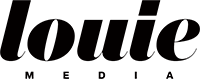Retranscription : Pourquoi pleure-t-on devant les films ?
Brune Bottero : Récemment, j’ai regardé la série Normal People. J’avais lu le livre de Sally Rooney, dont elle est adaptée et j’avais terriblement envie de voir comment l’histoire allait être portée à l’écran, et surtout, comment les personnages allaient être incarnés.
Dans le roman, j’ai été fascinée par la façon dont Sally Rooney écrit ses personnages… Marianne et Connel, les deux héros de l’histoire, sont intelligents, fins, complexes et même parfois contradictoires… mais ils sont surtout extrêmement justes et émouvants.
Contrairement à beaucoup d’adaptations, la série ne m’a pas déçue. Peut-être parce que Sally Rooney l’a co-scénarisée, et qu’elle a veillé à ce qu’on respecte sa vision des choses. Lorsque je la regarde, je retrouve les Marianne et Connel que j’ai lus, subtils, faillibles et infiniment charmants. Lorsqu’ils pleurent, je pleure aussi. Lorsqu’ils se touchent, mon cœur s’accélère. Après chaque épisode visionné, je reste encore de longues minutes avec eux dans ma tête. Parfois, dans la journée, je me dis “qu’en penserait Connel ?” ou “ça plairait à Marianne”.
Quand j’essaie de comprendre ce qui fait que ces deux personnages me touchent particulièrement, j’ai l’impression qu’il s’agit d’une sorte d’alchimie, comme avec les vraies personnes. Et que d’ailleurs, c’est certainement ça qui fait un personnage réussi : qu’il ait l’air d’être réel, si réel qu’on pourrait le rencontrer, le connaître. Être lui.
Ça me fait penser à la façon dont Stephen King parle de l’écriture des personnages, dans son essai Écritures, mémoires d’un métier. Il y explique : “Si je n'écris pas tous les jours, les personnages commencent à se rassir dans mon esprit : ils se mettent à avoir l'air de personnages et non plus de vraies personnes.”
Marianne et Connel n’ont pas l’air d’être des personnages. Ils sont d’ailleurs des “normal people”, des gens normaux. Leur normalité appelle notre empathie, nous fait nous projeter dans l’histoire, nous identifier à eux. Et c’est peut-être ce que nous cherchons toutes et tous, en lisant, en regardant des séries et des films : nous projeter dans le réel, via la fiction ? C’est justement ce qu’interroge la journaliste Manon Heugel dans cet épisode : comment les personnages de fiction nous touchent-il ? Pourquoi nous identifions-nous à elles et eux ? Qu’est-ce qui fait qu’on pleure devant un film ?
Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
Générique
Extrait du générique de Blanche-Neige
Manon Heugel : Quand j’avais quatre ans, ma tante m’a emmenée voir Blanche-Neige, le dessin animé de Disney, dans un cinéma de quartier à Paris. J’étais fascinée. Après ça, c’était simple : j’ai voulu devenir Blanche-Neige. Je rêvais d’avoir des cheveux noirs comme l’ébène alors que j’étais blonde ; je refusais de porter autre chose que des robes à manches ballon. J’ai commencé à appeler les gens de mon entourage “Simplet”, “Grincheux” ou “Atchoum”; comme les sept nains. Une fois, j’ai forcé mes parents à aller frapper à la porte d’un château où j’étais persuadée que Blanche-Neige vivait. Mes caprices sans fin pour avoir une paire de chaussures vernies à noeud ou une jupe jaune ont commencé à inquiéter mes parents.
Ils m’ont emmenée chez un pédopsychiatre pour s’assurer que je ne souffrais pas de trouble de l’identité. Le psy était formel : à mon jeune âge c’était normal, et même tout à fait sain, de s’identifier à un personnage de conte de fées.
On s’est tous déjà identifié à un personnage de film ou de séries. Nous avons tous pleuré devant la mort de la mère de Bambi, et nous continuons tous de pleurer au cinéma. Nous avons tous été accros à une série ou à une BD. Les personnages de Friends ont peuplé nos rêves nocturnes, et on a le sentiment que Joey, Phoebe, Chandler, Monica, Ross ou Rachel sont un peu nos amis, à nous aussi. Harry Potter et sa bande n’existent pas dans la vraie vie, mais les fans aiment se demander s’ils sont plus proches d’Hermione, de Ron, de Rogue ou de Dumbledore.
Pourquoi sommes-nous capables d’aimer passionnément des personnages que nous n’avons jamais rencontrés et que nous ne rencontrerons… jamais ? D’où vient le fait que nous ayons besoin de nous projeter constamment dans la vie d’un personnage fictif ? Pourquoi s’identifie-t-on même à des antihéros, des figures mauvaises, voire monstrueuses ? Pourquoi peut-on pleurer devant Bambi, alors qu’on n’ parfois pas à verser une larme à l’enterrement de sa propre grand-mère ?
Son d’ambiance : Mesdames Messieurs dans quelques instants nous rons en gare de Cannes. Prochaine gare desservie la gare de Cannes.
Manon Heugel : Je vais retrouver Sylvie, l’une de mes meilleures amies. Elle a 34 ans. Elle a vécu un peu partout dans le monde, à Londres, en Finlande, puis aux Etats-Unis, où elle est capitaine d’équipe de football américain. A cause d’un problème de santé, Sylvie vient tout juste de rentrer à Cannes, la ville où elle a grandi, afin de se faire soigner.
Sylvie : There we go. Vas-y je vais te faire découvrir Cannes.
Manon Heugel : Tu m’emmènes où, là ?
Sylvie : On est au Suquet, non ? On est juste à côté, tu vas voir, c’est magnifique. C’est le plus bel endroit de Cannes.
Manon Heugel : Cool.
Sylvie : T’as la vue sur toute la ville. Tu vas kiffer.
Manon Heugel : Le Suquet, c’est le quartier médiéval de Cannes. Il est plein de charme, avec ses petites rues escarpées, ses murs de couleur vive. Sylvie me montre en riant des portes d’entrée minuscules, sur des façades qui rappellent des maisons de poupée. J’étais déjà venue pour le festival, mais je n’avais jamais eu le temps de découvrir les quartiers plus intimes du vieux Cannes. Si j’ai décidé d’aller voir Sylvie pour réaliser cet épisode, c’est parce qu’elle entretient un lien très fort avec les personnages des Soprano. Cette série l’a aidée dans des moments particulièrement difficiles de sa vie :
Sylvie : Ouais je te disais que c’est intéressant de… qu’on enregistre à Cannes et qu’on parle des Soprano parce que toute l’histoire des Soprano, c’est vraiment, en regardant l’intégralité, je me suis rendu compte que c’est… une histoire de trauma transgénérationnel en fait.
C’est toutes ces familles qui se trimballent cette violence de génération en génération. Et moi là je reviens en France et à Cannes notamment pour des raisons de santé, mais aussi pour… pour me soigner l’âme, tu vois… et pour guérir ce trauma transgénérationnel que j’ai par mes deux lignées parentales, maternelle et paternelle. Et c’est un moment très important parce que c’est là où j’ai grandi et… mon enfance, et mon adolescence, et… où beaucoup de ces traumas ont été créés, tu vois. Et en ayant réfléchi… ça fait un moment que je réfléchis sur le sujet, mais les Soprano ont fait remonter pas mal de ces émotions et j’ai réussi à faire des liens, en fait, en regardant ces personnages et à comprendre ce que moi, j’avais enfoui… c’était fort.
Manon Heugel : Les Soprano, c’est une série américaine culte des années 2000. Elle met en scène une famille de mafieux italo-américains, sur la côte Est des Etats-Unis. Le boss, Tony Soprano, souffre de crises d’angoisse et entame une psychothérapie dans le plus grand secret. En réalité, tous les membres de la famille de Tony sont rongés par une souffrance psychique, ce qui entre en conflit avec leur activité de gangster.
Les personnages de fiction et leurs histoires provoquent, chez leur public, des émotions parfois plus intenses que celles de la vie réelle. Sans identification au personnage de fiction, pas d’émotion, et sans émotion, pas de public. C’est l’une des règles d’or de tout apprentissage du scénario en école de cinéma, par exemple. Et cette identification au personnage passe forcément par l’empathie :
Tamara Guénoun : L’empathie c’est “pouvoir sentir avec” l’autre. C’est pas de la compassion, c’est pas de la sympathie, ça serait autre chose.
Manon Heugel : Tamara Guénoun est psychologue clinicienne, maîtresse de conférence à l’université Lyon 2 en psychologie clinique. Elle enseigne aussi la dramathérapie, la thérapie par le jeu théâtral.
Tamara Guénoun : On voit bien comment pour le vivre ensemble, l’empathie est nécessaire, primordiale, dans cette capacité à se mettre à la place de l’autre, pour pouvoir moduler ses actions. L’empathie est à la base de la relation à l’autre, en fait. -
Manon Heugel : C’est socialement indispensable, donc ?
Tamara Guénoun : Socialement, l’empathie est indispensable, oui. Et donc dans le rapport aux personnages de fiction, qu’on soit acteur ou spectateur, on fait tout le temps ce travail-là, se mettre à la place de l’autre. Donc c’est pour ça qu’à mon sens, le personnage de fiction a un potentiel pour nous faire être empathique. C’est pas juste parce qu’on regarde une série ou un film qu’on va développer plus d’empathie, mais il y a quand même là un terreau qui est très fort.
Manon Heugel : Sylvie m’emmène en haut d’une colline, au pied du Musée du Château de la Castre. Là-haut, tout est étrangement calme, les sons de la ville sont étouffés. On a l’impression d’être hors du temps. En contrebas, la baie de Cannes se déploie sous nos yeux avec ses courbes, ses lumières et ses îles : Sainte-Marguerite, Saint-Honorat. Sylvie me dit qu’on y voit souvent des dauphins.
Sylvie : Et voilà, donc la vue sur le port de Cannes. Là c’est le palais des festivals, là. Et là derrière toute la Croisette. Et quand t’habites à Cannes, du coup, tu grandis avec le festival. J’ai imaginé tellement de fois faire la montée des marches, le discours, quand j’étais petite, pour la remise de la palme… Alors je l’ai fait en tant qu’actrice, réal, et je l’ai répété encore et encore tu vois ! (Rires)
Manon Heugel : Mais en fait, t’es tombée amoureuse du cinéma en grandissant ici, non ?
Sylvie : Ouais, carrément. Je sais pas si c’est tout le monde, mais ouais je suis tombée amoureuse du cinéma en étant enfant. Je pense que mon père m’a fait tomber amoureuse du cinéma aussi. Il enregistrait en cassette les films… il m’enregistrait les films qu’il pensait que je kifferais, les dessins animés Batman, les films, tous les Star Wars ! Je suis tombée amoureuse de Star Wars en les regardant avec lui, enregistrés à la télé, tu vois.
Manon Heugel : Comme les Soprano, Sylvie est d’origine italienne. Elle m’avait raconté au téléphone qu’elle s’était plongée corps et âme dans la série avec Sarah, sa femme. Les personnages des Soprano adorent les canoli, une spécialité sicilienne, des crêpes frites fourrées à la crème de ricotta. Sylvie regarde les épisodes en dégustant elle aussi des canoli, peut-être pour se plonger encore plus profondément dans cette série, qui lui rappelle ses racines italiennes.
Sylvie : Là c’est le fameux glacier-pâtissier… où je suis venue - on va passer devant - où je suis venue acheter les canoli. J’étais avec ma mère, Donatella, ce matin. Et on a commencé à parler en italien, il nous a tout expliqué, ils font la ricotta de Sicile régulièrement.
Manon Heugel : Alors, pour cet épisode d’Emotions, Sylvie m’a invitée à partager son rituel : manger des canoli devant les Soprano et faire des ziti, un plat italo-américain qui ressemble en gros à des lasagnes pour cuisiniers flemmards. Sylvie avait envie d’essayer de cuisiner ce plat qui est presqu’une insulte à la gastronomie italienne.
Son d’ambiance : Bruits de cuisine et rires
Sylvie : La cuisson des pâtes en mode McGyver !
Manon Heugel : On fait ce qu’on peut hein.
Sylvie : Ouais donc je te disais, les pâtes, en fait c’est des pâtes au four, avec du fromage. Alors les Américains, ils font pas les trucs à moitié. Du coup y a trois types de fromage différents, il y a de la ricotta, la mozarella et il parmigiano. Ils ont mis les trois, c’est…
Manon Heugel : Tu fais jamais ça en Italie ?
Sylvie : J’ai jamais vu ça, non. (Bruits de cuisine) Bientôt au four, on va le préchauffer. Comme ça on va pouvoir se poser avec un verre de vin et discuter.
Manon Heugel : La cuisine italienne, c’est un truc de puristes. Changez un ingrédient à leurs recettes traditionnelles, et tous les Italiens vous tombent sur le dos en hurlant au sacrilège. Mais justement, Sylvie a appris à aimer cette petite entorse au conservatisme culinaire de son pays natal. Les ziti, c’est un plat d’immigrés italiens aux Etats-Unis, c’est pour ça qu’on en voit tout le temps dans les Soprano. Quand on immigre, on change : Sylvie en sait quelque chose. Et changer, c’est primordial pour Sylvie, parce qu’elle ne veut plus vivre dans le passé. Quand elle avait 10 ou 11 ans, le père de Sylvie, Jamel, s’est donné la mort.
Juste avant le décès de son père, elle avait été séparée de son jeune frère Satia, qui avait 2 ans. Elle ne l’a jamais revu. Et puis, en 2019, Satia s’est suicidé lui aussi. Il avait 23 ans.
Sylvie : Je venais d’arriver aux Etats-Unis, c’était ma première semaine, et on m’appelle. J’allais m’entraîner. Et on m’appelle, et c’est un numéro que je connais pas, je suis en train de conduire et je ne réponds pas. Je reçois un SMS juste avant d’arriver à la salle pour mon entraînement, et je vois que c’est un message : “rappelle, c’est sur ton frère, c’est important.” Et quand je pars de l’entraînement, je rappelle et c’est là qu’on m’apprend la nouvelle.
J’ai compris qu’en fait, on avait tous les deux vécu la même chose, on avait tous les deux vécu cette souffrance abyssale et que tous les deux on s’était sentis abandonnés, et que… J’ai été dévastée de savoir que tout ce que moi j’ai vécu, avec dix ans de plus que lui, je pouvais le lui apporter, mais c’est trop tard.
Manon Heugel : Ce sentiment d’abandon dont Sylvie et son frère ont hérité, son père en souffrait déjà avant eux. Lui aussi avait été abandonné. Elle ne supporte plus d’être inconsciemment guidée par ce traumatisme qui se transmet d’une génération à l’autre dans sa famille. Pour enrayer ce cycle de douleur, pour faire le deuil de ses morts, elle veut réparer ses relations brisées avec les vivants. En particulier avec son frère aîné, Enrico, et avec sa mère, Donatella.
Sylvie : J’étais en colère avec ma mère… je sais pas, y a peut-être des trucs… Elle, je savais qu’elle s’en voulait de la mort de mon père, parce que… Mon père, il s’est suicidé le jour où il est venu me dire au revoir. Et moi, je m’en suis voulu éternellement de pas l’avoir compris, alors que j’avais 10 - 11 ans… Il est venu me dire au revoir et j’ai pas compris que c’était un au revoir, alors qu’il me donnait sa montre, il me donnait ses lunettes de soleil, il m’avait fait promettre de retrouver mon frère. Et ça, à posteriori, une fois que le fait est , je me suis dit : j’aurais du le savoir. Et puis je me suis dit : j’aurais du l’enfermer, tu te dis plein de choses, tu vois. Et ma mère, elle, elle était pas là, elle était en Italie à ce moment-là pour régler des problèmes administratifs.
Essentiellement, je lui en ai voulu d’avoir déconnecté émotionnellement, parce qu’elle avait ses propres démons, et ses propres difficultés personnelles. Après s’être séparée de mon beau-père, elle est tombée dans une dépression abyssale et elle était émotionnellement indisponible. On a eu énormément de problèmes financiers, on a eu les huissiers qui venaient prendre des choses à la maison, il fallait tout cacher, la télé, l’ordinateur, dans cette peur constante qu’on vienne tout nous prendre, tu vois… Cette situation, plus ce que moi j’ai vécu personnellement avec la mort de mon père, et puis de voir ma mère sur le canapé sous antidépresseurs, au fond du trou, à pas pouvoir avancer dans la vie ou faire quoi que ce soit, je pense que c’est quelque chose que j’arrivais pas à exprimer avec elle avant et que j’ai gardé au fond de moi et qui dans la vie de tous les jours se montrait avec beaucoup d’agressivité.
Manon Heugel : Sylvie a grandi avec la fiction. Les films de super-héros, les dessins animés. La fiction lui offrait une bulle dans laquelle elle pouvait être qui elle voulait, dans laquelle le monde pouvait être sauvé, peut-être justement parce qu’elle a eu une enfance difficile. Et parce que Sylvie a grandi avec ce qu’elle appelle aujourd’hui des “partenaires de fiction”, elle a appris à prendre au sérieux les personnages de ses films et séries préférées. Elle sait qu’ils ont quelque-chose à lui enseigner.
Sylvie : Je pense qu’on apprend la vie en regardant des films, tu vois. Je pense qu’on est tous une représentation de la vérité. Je pense qu'il y a pas une vérité absolue. Je pense que chacun la vit a sa propre façon et on est tous des miroirs les uns les autres… à s’apprendre des choses, on est tous des teachers, comme on dit, des professeurs dans la vie pour l'autre. En regardant l’autre… qu’est-ce qui nous énerve chez la personne, qu’est-ce qu’on admire… qui on aimerait être… ou les histoires, tu vois, en écoutant les histoires des personnes, on apprend sur nous ou sur l a personne : qu’est-ce qui les fait vibrer, quels sont les challenges qu’elle vit, et je trouve que c’est la même chose pour les personnages de fiction, que ce soit des personnages de cinéma, de série TV, de roman, et… Et c’est comme ça que j’ai continué à grandir dans la vie, tu vois.
Il y a un personnage dans les Soprano, Paulie, qui a grandi en idôlatrant sa mère. Et il découvre à un moment que sa tante, en fait, est sa vraie mère. Et Paulie, incapable de gérer la situation, d’une colère incroyable, d’une violence, est abominable avec sa mère en la reniant etc. Cette scène, effectivement, toute cette histoire, m’a extrêmement touchée, parce que je vois l’amour maternel infini. C’est un amour inconditionnel et la souffrance que ça a du générer d’avoir son fils qui la renie, comme ça, et qui est extrêmement violent à son égard, c’est une souffrance que je pourrais même pas exprimer, tu vois… Ben là, tu vois, j’ai de l’émotion à en parler. Parce que je me mets à la place de ma mère et ce qu’elle a du ressentir… C’est… Je pense que c’est la pire chose qui peut t’r. Au-delà de perdre ton enfant, tu vois. C’est perdre ton enfant, en fait.
Manon Heugel : Avec Sylvie, on a lancé un épisode des Soprano et on a mangé les ziti.
Son d’ambiance : On entend le générique des Soprano et les bruits de couvert
Sylvie : Quand t’aimes une série, et que tu plonges dans l’univers, je pense que la musique ça génère une émotion qui est associée avec l’univers et les vies des gens que t’es en train de suivre.
Extrait générique des Sopranos
Sylvie : Mmmh ! Là j’ai vraiment l’impression d’être dans les Soprano. Ah, c’est Moltisanti. Et là c’est Adriana.
Manon Heugel : C’est sa femme ?
Sylvie : Ouais. C’est sa girlfriend.
(On entend l’épisode des Soprano en fond)
Manon Heugel : Christopher Moltisanti est le personnage des Soprano avec lequel Sylvie s’identifie le plus. L’univers mafieux de cette série est très brutal, et Moltisanti est peut-être l’un des personnages les plus torturés. Il est héroïnomane, alcoolique, il frappe sa femme, il tue. Je me demandais vraiment comment Sylvie, qui est une personne équilibrée et bienveillante, pouvait se reconnaître en lui.
Romain Compingt : Pour moi la morale, quand on parle de la construction d’un personnage, ne rentre pas en ligne de compte. Parce que si on juge son personnage, on ne pourra jamais être dans sa peau.
Manon Heugel : Romain Compingt est scénariste pour le cinéma. Il a écrit et coécrit plusieurs long-métrages, dont Populaire, qui est sorti en 2012, et récemment En attendant Bojangles, avec Romain Duris et Virginie Efira. Il est aussi le co-auteur de Divines, avec sa réalisatrice Houda Benyamina. Le film a remporté la caméra d’or au festival de Cannes en mai 2016.
Divines, c’est l’histoire de Dounia, une jeune fille qui grandit entre un bidonville et une cité avec son frère qui se travestit dans un bar, et sa mère dépressive et alcoolique. Dounia est prête à tout pour s’en sortir. Rapidement, elle décide de travailler pour Rebecca, une jeune femme qui trafique de la drogue dans les quartiers.
Romain Compingt : Dans Divines, il y a le personnage de Rebecca, qui est joué par Jisca Kalvanda, et qui est, d’un point de vue dramaturgique, dans Divines, le mentor de l’héroïne.
Extrait de Divines : Maïmouna, tu fais une ronde chaque 15 min. Tu regardes par là et par là, pour voir s’il n’y a pas une brigade qui . Les stups, c’est facile de reconnaître, ils sont soit en noir soit en focus bleu, soit en 308… Donc t’ouvres bien tes yeux ! Wesh mon pote ! Ça va ou quoi ? Tranquille, la famille ? Elles, c’est mes petites, elles remplacent Samir.
Romain Compingt : Moi j’avais beaucoup de mal à écrire ce personnage, d’ailleurs je l’appelais toujours “la dealeuse”, ce qui est mal barré, quoi, parce que (rires) si on commence à définir un personnage comme ça c’est un peu court, et j’ai eu plusieurs révélations, avec Houda pendant l’écriture, notamment Houda me disait : “oui, tu dis dealeuse, mais tu pourrais dire aussi que c’est une cheffe d’entreprise.”
Du coup, j’ai pu l’envisager autrement qu’à travers un cliché qui serait celui de quelqu’un qui deale. Mais qu’est-ce que c’est, quelqu’un qui deale ? Ben c’est quelqu’un qui a des stocks, c’est quelqu’un qui doit gérer ses équipes, etc etc. Quand je dis ça, y a aucune morale. C’est pas du tout une glorification de cette activité, mais c’est pas non plus une diabolisation. C’est à dire, juste, en fait, de regarder les choses pour ce qu’elles sont concrètement, en tout cas de se raconter qu’on en a une vision concrète. Donc déjà ça, ça m’a aidé.
Et puis le fait de me dire, ok, en fait cette fille, qui a la vingtaine, elle fait tout ça pour quoi ? Pour partir en Thaïlande, boire des cocktails, voir des beaux gogo dancers, et voilà ! Et ça paraît anecdotique, mais, bon moi j’ai jamais dealé de ma vie, mais en fait, aller boire des cocktails au bord de la plage, ouais quoi ! Et en fait, ça m’a permis de me mettre à sa place.
Manon Heugel : C’est beau, de se dire qu’un film, une série ou un roman peuvent nous rendre plus attentifs aux autres et nous permettre de mieux les comprendre. Les personnages de fiction peuvent aussi nous apprendre à mieux nous connaître.
Quand j’étais toute petite et que j’étais obsédée par Blanche-Neige, ma famille ne comprenait pas pourquoi je cristallisais sur ce personnage. Pour moi, c’était la plus belle princesse de l’univers. Je pleurais de rage devant le miroir en constatant tous les matins que mes cheveux n’étaient pas noirs comme l’ébène, que mes lèvres n’étaient pas rouges comme le sang. Personne ne voyait ce qui, pourtant, sautait aux yeux : ma mère avait les cheveux noirs au carré et portait du rouge à lèvres très rouge. Blanche-Neige, c’était ma mère. À quatre ans, j’étais en plein Oedipe, et je voulais prendre sa place auprès de mon père. Mais qui aurait pu se rendre compte que j’étais animée d’une intention aussi noire ? Parce que mon obsession était fixée sur un personnage de princesse aux allures inoffensives, personne, pas même le psy, n’avait vu ce qu’il se passait. En réalité, les liens qui nous unissent à un personnage de fiction sont mystérieux, profonds, et en apparence inexplicables.
Adulte, je suis devenue comédienne, puis scénariste et réalisatrice. L’obsession pour Blanche-Neige n’avait été que la première étape d’une existence dédiée à créer des personnages fictifs. Créer des personnages, leur donner vie, est une forme de pouvoir extraordinaire. Pour un peu, on se prendrait littéralement pour Dieu.
Écrire un film ou une série, ou même un roman, ça veut dire se glisser dans la peau de personnages de fiction. Tout comme les spectateur.ices se mettent dans la peau des personnages qu’ils regardent. C’est exactement le même mécanisme. C’est quelque-chose qui se passe de manière tout à fait fluide, ce n’est pas une technique en soi, mais ça a lieu. Moi-même, quand j’écris de la fiction, je me surprends souvent à rire ou à pleurer avec mes personnages. Les barrières tombent, je rentre en empathie totale avec eux. Parfois, j’ai eu le sentiment qu’il m’était impossible de sortir de la peau d’un de mes personnages de fiction, une fois ma journée de travail finie.
Emma Barcaroli : “Ils m’ont remise à des drogues d’avant-guerre depuis que je suis entrée à l’hôpital. Forcément, vous savez… Oh c’est léger comme tout, mais il faut que je sois assidue si je veux que ça fonctionne, sinon je ne dors pas !”
Manon Heugel : Cette voix, c’est celle de la comédienne Emma Barcaroli. Elle incarne le personnage de Marilyn Monroe dans un monologue théâtral écrit par sa soeur, Céline Barcaroli. La pièce s’appelle Marilyn Inside et elle a été mise en scène par Grégory Cauvin au Studio Hébertot à Paris en 2021.
Emma Barcaroli : Si je ne dors pas je ne peux pas tourner, je me remets à bégayer… Vous savez que je bégaye ? On m’appelait “mmmm mmm mmm…” à l’école ! C’est drôle parce que c’est ce que j’ai choisi comme initiales. Je ne suis qu’un bégaiement infini. Toute ma vie, j’ai joué à être Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, j’incarne en permanence une imitation de moi-même. Une imitation n’a pas de désir. Elle a une apparence de désir.
Manon Heugel : J’étais intriguée par cette pièce, parce que je suis une immense fan de Marilyn Monroe. En fait, après mon obsession d’enfant pour Blanche-Neige, je me suis identifiée à Marilyn Monroe pendant toute mon adolescence. Marilyn est une véritable icône, tout le monde la connaît, et jouer un tel mythe est un défi inouï pour une actrice. Quand j’ai vu la pièce, j’ai été frappée par le travail d’Emma sur le rôle de Marilyn. Elle n’imitait pas sa voix, ni sa démarche, ni ses mimiques. Et pourtant, au bout d’un moment, j’ai vraiment vu Marilyn Monroe. Une Marilyn unique, la sienne. Comment avait-elle réussi cette prouesse ?
Emma Barcaroli : Quand Céline - qui est ma soeur, l’autrice du texte, m’a dit qu’elle écrivait un monologue sur Marilyn et qu’elle voulait que je le joue, au départ, honnêtement, j’étais extrêmement réfractaire. J’étais pas du tout sûre de dire oui. Elle est tellement identifiée par des générations différentes, et elle raconte tellement de choses, que c’est compliqué. C’était vraiment pas évident pour moi de me dire que j’allais me confronter à ce personnage, finalement - parce que c’est vraiment un personnage. Et en fait le texte pour moi ramène tellement Marilyn à un endroit universel de la femme, d’une vie de femme, d’une parole de femme, d’une parole d’actrice, mais qui peut être n’importe quelle actrice, et puis plus globalement d’une personne, qui pourrait être un homme aussi. Ce qui m’a décidé en fait, c’est de me dire oui en fait ce qui est intéressant c’est d’aller chercher la banalité de cette femme et ce qu’elle a de plus ordinaire dans sa façon de se percevoir, en fait.
Son d’ambiance : Emma au théâtre répétant l’Ecole des maris. Chanson.
Manon Heugel : En ce moment, Emma répète L’école des maris, de Molière. Un nouveau rôle, dans une pièce écrite au XVIIe siècle, bien loin de Marilyn. C’est ça, la vie de comédienne : se glisser à chaque fois dans la peau d’un personnage différent. On peut être La dame aux camélias un soir au théâtre, et, le lendemain, tourner dans un téléfilm et jouer le rôle d’une flic de la BAC. Comment est-il possible, en tant qu’actrice, de renouveler à chaque fois son empathie pour tous ces personnages si différents ?
Emma Barcaroli : On dit souvent qu’il faut aimer son personnage même si c’est le pire des salauds, et c’est vrai que c’est très important, d’avoir une empathie très forte avec le personnage, même si on joue parfois des choses et des rôles qu’on ne comprend pas, auxquels on n’adhère pas, intellectuellement, philosophiquement, idéologiquement. Mais ce qui est intéressant, c’est d’aller chercher l’endroit de la faille, en tous cas l’endroit de la fêlure, l’endroit où l’émotion va devenir universelle et tous les personnages vivent et traversent des choses, qui à un endroit, sont universels.
Manon Heugel : Un certain nombre d’émotions sont partagées par le genre humain tout entier. L’amour, l’amitié, le désir de reconnaissance, l’ambition, l’envie de liberté, le chagrin… Ces sentiments communs à nous toutes et tous, c’est ce qui forme l’universalité. Ce principe, qui dit que chacun de nous peut s’identifier à n’importe quel personnage, est fondamental quand on écrit une histoire. Trouver l’universalité d’un personnage permet de créer une empathie entre les spectateurices et le personnage, même si celui-ci ne nous ressemble pas du tout.
Romain Compingt : La plus belle chose qu’on m’ait dite, c’était à un festival en Corse où Divines était projeté, et y a un monsieur entre 60 et 70 ans qui m’a dit : “Dounia, c’est moi”. Cet homme à la retraite s’était identifié à une jeune fille qui vient d’un quartier populaire et qui a une colère en elle.
Manon Heugel : Dounia, l’héroïne de Divines, est prête à tout pour sortir de la misère. Son but, c’est de gagner de l’argent, beaucoup d’argent, pour pouvoir réaliser ses rêves :
Extrait film “Divines” :
Qu’est ce que tu vas faire dans la vie, toi ? J’aimerais bien savoir.
Bah comme tout le monde : money money money !
Money money money !
Money Money Money !
On est pas à un concert ici, c’est justement ce que je te propose, moi, de faire de la “money” comme tu dis !
Ah ouais ? Parce que toi t’en as vu beaucoup des millionnaires qui ont fait BEP accueil ?
Il y a des gens très bien qui le font !
Bah c’est pas des millionnaires. Comme vous, vous êtes pas une millionnaire.
Mais ce que tu comprends pas, c’est que j’essaye de vous aider moi !
Mais nous aider ? À être les larbins de la société, c’est ça ?
(...)
J’ai pas envie de mendier, j’ai de la fierté moi !
Je veux plus te voir, tu sors de ma classe putain !
La vie de ma mère, la vie de ma mère, un jour je me ferais plus de thunes que t’en as jamais vu dans toute ta vie ! Toute ta vie, t’en auras jamais rêvé ! Tu sais quoi plus jamais je retourne dans ton lycée de merde-là ! Tu vas voir ! (Bruit de porte qui claque)
Manon Heugel : J’ai demandé à Romain Compingt pourquoi, en tant que scénariste, il était si important de créer des personnages avec lesquels les spectateurices peuvent s’identifier.
Romain Compingt : Parce que le personnage, c’est le vaisseau qui va nous permettre d’entrer dans une histoire, de s’intéresser à l’histoire, de s’investir dans cette histoire. Moi je fais partie de ces dramaturges qui pensent que l’histoire part du personnage. C’est parce que le personnage fait un choix, parce que le personnage fait une erreur, souhaite quelque chose, que l’histoire peut avoir lieu.
Manon Heugel : Dans Divines, Dounia rencontre Djigui, un jeune danseur qui travaille, le jour, comme gardien de supermarché. La sensualité et la poésie de Djigui troublent profondément Dounia. Mais l’amour n’est pas vraiment compatible avec le trafic dangereux dans lequel Dounia s’est engagée. En s’impliquant dans le trafic de drogue organisé par Rebecca, la jeune fille a mis le doigt dans un engrenage de violence. Elle risque d’y entraîner tous ceux qu’elle aime.
Tamara Guénoun : En fait, venir au théâtre, c’est un acte politique dans le sens où on se réunit tous autour d’une œuvre qu’on regarde, et interprétée par des comédiens qui se font porte-paroles. Et je pense qu’il se passe quelque chose de similaire au cinéma, où on se connecte à une histoire qui a du sens pour notre individualité, pour nous, dans notre vie personnelle, mais qui a du sens aussi par rapport à la collectivité dans laquelle on évolue.
Romain Compingt : Moi personnellement, ce qui m’a amené à l’écriture pour l’image, c’était justement cette volonté de partager, de provoquer des émotions. Je crois qu’on ne peut se poser des questions sociétales, intimes, qu’en passant d’abord par l’émotion.
Manon Heugel : Pour moi, Romain Compingt et Tamara Guénoun ont raison. Le cinéma, les films, les séries peuvent changer le monde, parce que les spectateurs, qui se retrouvent en empathie avec des personnages très loin d’eux-mêmes, peuvent apprendre à regarder la société sous un autre angle.
En 2020, Romain Compingt était invité à un festival de cinéma queer. Le terme ”queer” définit les personnes ayant une identité différente de la norme sexuelle ou de genre. Et c’est là que Romain a pris conscience de l’importance de représenter toute la diversité sociale à l’écran.
Romain Compingt : Donc je suis à Genève. Je suis invité au festival Nobody’s perfect, qui est un festival de cinéma queer. Et donc c’est une table ronde pour parler des injonctions de la fiction, des injonctions de mon métier de scénariste. Est-ce qu’on force ma plume pour soutenir tel ou tel propos, telle ou telle vision du monde… C’est très intéressant, parce que moi, ce que je défends sur scène, c’est l’universalité. C’est-à-dire, en disant effectivement, moi jusqu’à présent j’ai travaillé sur des histoires, des idées qu’on m’a amenées, des arènes qu’on m’a amenées, qui souvent, la plupart du temps sont hétéro-normées. Moi je suis homosexuel, mais ça ne me pose pas de problème, parce que je crois que l’amour est universel, que le désir est universel, que les obstacles qui se mettent sur le chemin de tout un chacun sont universels. Et j’y crois dur comme fer, et c’est vraiment je crois une composante essentielle de mon travail.
Et tout en parlant, je me rends compte qu’en fait, moi je me mets dans les chaussures des autres - je vais parler de ma petite lucarne, c’est à dire, moi je raconte des histoires d’amour entre un homme et une femme. Et mon vécu personnel fait que moi, j’ai vécu des histoires d’amour avec d’autres hommes. Et donc je me rends compte, tout en parlant, qu’effectivement, ce que je dis, j’y crois. Et que c’est même essentiel d’y croire, sinon je n’écrirais pas. Mais que finalement, j’ai toujours fait ce travail dans ce sens-là. C’est-à-dire en disant : je vais trouver l’universalité avec une représentation qui, soit disant, représente la majorité. Je vais quand même pas faire trop de bruit, je vais pas trop déranger, je vais, moi, me mettre dans la peau de l’autre, qui n’est pas moi. Et en fait, je pense aujourd’hui - donc deux ans plus tard, et puis c’est vraiment la révélation que j’ai eu sur cette scène, ça paraît idiot mais c’est vrai que c’est une question que je m’étais jamais posée. De me dire : oui mais en fait je peux tout à fait écrire un personnage queer, un personnage homosexuel, un personnage qui par certains abords me ressemblerait plus, et être tout aussi universel ! Et en fait c’est vrai qu’on m’a rarement proposé ces sujets-là. Donc c’est à moi de les amener.
Manon Heugel : Ce que raconte Romain Compingt ouvre la question absolument cruciale de la représentation. Aujourd’hui, on sait que les femmes, les personnes LGBTQI+, les personnes racisées ou en situation de handicap sont sous-représentées dans les films et les séries. Permettre une représentation de la grande diversité de notre société française est un enjeu politique. Si l’on voyait plus de Noirs, de sourds, ou de femmes de plus de cinquante ans dans de vrais rôles sur nos écrans, notre perception du monde serait modifiée. On pourrait, par exemple, imaginer qu’il est possible dans la vraie vie d’élire une présidente de la République, de tomber amoureux d’une personne en fauteuil roulant, ou de devenir ami avec quelqu’un qui vient d’une classe sociale aux antipodes de la nôtre. C’est sans doute pour cette raison que la question de la représentation continue de rencontrer autant de résistances. Changer les représentations, c’est bousculer le statu quo social.
Grâce au pouvoir des émotions, l’art narratif a donc une dimension politique indéniable. Mais cela va plus loin encore. J’irais jusqu’à dire qu’il y a quelque chose de métaphysique dans la fiction. Pendant mon apprentissage des techniques de scénario à l’école de cinéma, un terme revenait sans cesse, un beau mot, un mot grec : catharsis. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, le penseur grec Aristote déclarait que le but d’une histoire est de déclencher un défoulement profond chez le spectateur ou chez l’auditeur. En purifiant l’âme de ses passions les plus noires, la catharsis ferait de nous des êtres meilleurs.
Tamara Guénoun : Ce qu’il se passe quand on pleure devant un film, entre autres choses il y a de la catharsis. On se sent connecté à l’histoire de ce personnage et ça connecte en nous à des parts un peu souffrantes, ou émotionnées, qui vont pouvoir, là, s’exprimer, et qu’on s’autorise à exprimer parce qu’on est un peu à distance de soi aussi, on pleure pour quelque chose de plus grand.
Sylvie : Je vais te raconter en fait, le moment où le déclic s’est passé.
Manon Heugel : Après une longue conversation, Sylvie accepte finalement de me raconter pourquoi elle se sent si connectée au personnage pourtant très brutal qu’est Moltisanti dans les Soprano. Dans une scène qui a profondément choqué Sylvie, Moltisanti commet des violences conjugales sur la personne de sa petite amie Adriana. C’est le visionnage de cette séquence qui lui rappelle une scène de son propre passé.
Sylvie : Je me suis souvenue que… quand j’étais enfant, et que j’étais dans une souffrance absolue, je venais de perdre mon père, et j’étais dans une impuissance face à cette situation, je peux rien y faire tu vois, moi j’avais 10-11 ans…
Et ma chienne, Shanti, avec qui j’ai grandi toute ma vie, elle a été avec moi depuis que j’étais enfant, c’était ma meilleure amie, elle me suivait partout, c’était mon ombre, on a fait les 400 coups ensemble et c’était… ma deuxième mère, elle prenait soin de moi… Elle avait un amour inconditionnel pour moi. Et je sais que dans des moments… de violence quand j’étais enfant je me suis souvenue, à ce moment-là… dans cette scène, quand je l’ai regardée, que… à un moment, j’ai tapé ma chienne. Alors que… que je l’aimais, c’était ma meilleure amie à l’époque.
C’est le moment où j’ai fait le lien, je pense que c’est la première fois que j’ai compris qu’on avait quelque chose en commun. Que cette souffrance, qu’on arrivait pas à maîtriser, ben elle te faisait faire des choses que tu ne désirais pas, jamais je me serais sentie capable de faire ça tu vois. Et je me suis sentie coupable toute ma vie. Je me suis jamais pardonnée. J’en ai jamais parlé.
Ce soir-là, quand on a regardé l’épisode… la première personne à qui j’en ai parlé de toute ma vie, c’était à ma femme à la suite de cette scène. Je suis allée pleurer dans la salle de bains… Et je l’ai dit. Je suis revenue et j’ai dit à ma femme : tu vois, ce qu’il vient de se passer, je pensais pas que je pourrais le comprendre. Et je lui ai raconté. Et là c’est la deuxième fois que j’en parle à qui que ce soit.
Manon Heugel : Le fait de souffrir ne justifiera jamais le fait d'être violent envers autrui. D'ailleurs, quand Sylvie fait ce lien entre son histoire et celle de Moltisanti, elle ne justifie évidemment pas les violences conjugales et ne dit pas que la violence est la seule réponse possible à la souffrance. Dans la série, Moltisanti est un adulte qui fait le choix d’exprimer sa souffrance par la violence, au lieu de s’en libérer et d’en guérir par des pratiques comme une psychothérapie. Même si Sylvie a associé les deux situations, la différence est qu’elle était une enfant.
Romain Compingt : Je crois que quand quelqu’un formule quelque chose qu’on a peur d’entendre, quand quelqu’un vit quelque chose qu’on a peur de vivre, à l’inverse quand quelqu’un vit quelque chose qu’on désire absolument vivre, il y a quelque chose qui se crée en nous chez le spectateur et en amont chez l’auteur aussi, parce qu’en fait on vit la même expérience en avance quoi, quand on écrit on est à la fois spectateur et à la fois le personnage… Et voilà quand un personnage dépasse ses limites, quand un personnage est poussé à bout, il y a quelque chose, chez soi, le spectateur, qui se relâche, en fait.
Et après, le spectateur est porteur lui-même de sa propre réponse, mais au moins, il n’a pas été seul face à lui-même, face à ses angoisses, à ses espoirs etc. Il y a eu une projection sur l’écran qui permet au spectateur de ne plus être seul avec ces questions, en fait.
Sylvie : De découvrir ce personnage de Moltisanti m’a fait voir plusieurs choses, plusieurs de mes souffrances. Parce qu’en fait, en plus, non seulement il a un père qu’il a perdu quand il était enfant, et il a cette mère qui était alcoolique, qui n’a pas été là émotionnellement pour le soutenir dans sa vie, tu vois, et j’ai compris qu’en fait j’ai vécu la même chose que lui. Et qu’on avait la même colère, que j’avais jamais analysée. C’est la première fois. Je viens de me faire les six saisons des Soprano en quelques mois, et c’est la première fois de ma vie que j’ai enfin réussi à analyser ma colère.
Manon Heugel : Sylvie est pourtant quelqu’un qui réfléchit énormément sur elle-même. Comment est-il possible qu’une série ait un effet thérapeutique plus puissant que n’importe quel autre biais sur une spectatrice comme elle ? Serait-ce parce que justement, ce n’est pas une analyse, une thérapie directe, mais un jeu ?
C’est en fait la distance avec le réel qui nous permet de nous identifier à des personnages. C’est parce qu’il y a un fossé entre la vraie vie et la fiction, qu’on peut se permettre de pleurer devant le dessin animé Bambi, où un petit faon perd sa mère, abattue par des chasseurs. Alors que dans la vie, on a parfois du mal à manifester nos émotions quand un événement nous touche directement, comme par exemple à l’enterrement de notre propre grand-mère ?
Tamara Guénoun : Bambi, je sais que c’est pas moi, et en même temps, ça vient parler de la mort d’un parent, le lien filial… je peux pleurer parce que c’est moi et pas moi. Ce détour, cette médiatisation par le personnage, fait qu’on peut lâcher prise plus facilement. Alors que pleurer à la mort de sa grand-mère, y a peut-être des choses beaucoup plus torturées qui vont nous rejaillir en plein, de notre rapport à notre père, notre difficulté à se connecter à nos émotions au quotidien qui fait que voilà, l’émotion elle viendra pas.
Mais je dirais, par rapport à la mort de sa grand-mère, on peut ne pas pleurer à l’enterrement, pas pleurer pendant des années, et puis pleurer dix ans plus tard parce que tout d’un coup on retrouve une amulette ou quelque chose qui lui avait appartenu et qu’on avait oublié. En fait, la psyché, elle suit des détours et des tournants qui sont complexes. Freud parlait d’après-coup, dans le cas de traumatismes. Un événement ne va pas être traumatique en soi, même s’il a une portée traumatogène très forte, mais, des années plus tard, un micro-événement va nous rappeler l’événement traumatogène et là, va ouvrir les vannes, en quelque sorte. Qui va créer le traumatisme, ou créer le choc qui va faire que l’émotion se libère.
Avec le personnage de fiction, il y a de ça aussi. C’est à-dire, le personnage de fiction, il va venir parler de sa grand-mère sans que ce soit tout à fait sa grand-mère, ou il va nous rappeler l’événement sans que ce soit directement l’événement, ou saisir l’événement par un symbole qui va permettre que l’émotion s’exprime plus facilement. Quand les choses sont trop frontales, la psyché est parfois sidérée, et elle a du mal à s’exprimer et il y a besoin aussi de biais pour qu’elle puisse libérer l’émotion ou dans le cas de thérapie, se transformer, ou en tout cas de dépasser l’événement traumatique.
Manon Heugel : En discutant avec la psychologue Tamara Guénoun, je m’interroge sur les bienfaits des œuvres de fiction… Est-ce qu’on ne pourrait pas envisager que la fiction, que les personnages de fiction, peuvent nous guérir ?
Quand tout se passe bien dans un film, quand Batman sauve le monde ou que Blanche-Neige épouse le prince, okay, alors je veux bien croire que les spectateurs ressortent plus heureux, et qu’ils se disent qu’eux aussi, ils pourront sauver leur petit monde et épouser la personne qu’ils aiment. Mais voir un film tragique, qui se termine mal , comment est-ce que cela pourrait guérir, par exemple ? Est-ce que voir un personnage qu’on adore sombrer dans la folie, comme celui de Camille dans En attendant Bojangles, est vraiment un soulagement ?
Ce film, adapté du roman d’Olivier Bourdeaut, est écrit par Romain Compingt et réalisé par Régis Roinsard. Son héroïne, Camille, ne supporte pas la banalité du réel. Dans le film, le personnage de Camille est interprété par la talentueuse Virginie Efira. Camille est à mon avis l’un des personnages féminins les plus magnétiques et les plus complexes du cinéma français. Elle est fantasque, brillante et drôle. Elle rend la vie quotidienne extraordinaire.
Extrait de En attendant Bojangles : “Marions-nous tout de suite ou nous allons oublier !”
“Ça me prend parfois quand je suis au summum du bonheur (rires) je passe à l’extrême inverse sans crier garde. (rires) (cris)”
Romain Compingt : Le fait, notamment, que cette histoire se termine mal permet à l’émotion de jaillir. Dans l’idéal, je veux dire, quand on aime ce film et quand on aime les personnages, on est dévasté par le départ de cette femme. On a tellement aimé cette femme. Mais c’est justement parce qu’elle s’en va qu’on peut se rendre compte à quel point on l’a aimée, par exemple. Et c’est justement parce que son destin est tragique qu’on peut se poser la question de comment faire pour survivre au sien. Et donc, parfois, je crois qu’en racontant le pire, on crée une volonté de meilleure chez le spectateur. Ça peut être une manière d’expliquer la catharsis.
Manon Heugel : C’est une psychanalyse, en fait, le cinéma !
Romain Compingt : D’une certaine manière, oui (rires). Pour moi le cinéma c’est quelque chose qui rend le quotidien spectaculaire. Et donc oui, c’est une psychanalyse, mais une psychanalyse avec des belles robes de soirée, et des gens qui s’aiment, et des gens qui se déchirent… et où finalement, on sort quand même intact de la salle, quoi.
Manon Heugel : Intact. C’est le mot-clef : nous sommes intacts, malgré l’émotion d’un film qui nous bouleverse. Et alors, intacts, nous pouvons nous transformer après cette expérience. Comme Sylvie, qui, en regardant les Soprano, a réalisé qu’elle avait un problème d’addiction lorsqu’elle était adolescente. Après cette prise de conscience par le biais d’un personnage fictif, elle a réussi à se pardonner à elle-même et à trouver la force de changer le cours de sa vie.
Sylvie : Grâce à Moltisanti, je viens de comprendre pour la première fois ce que moi, j’ai vécu quand j’étais ado, quand j’ai noyé mes émotions, toute cette souffrance, dans l’alcool ou la drogue. J’ai enfin compris ce que j’avais vécu, ce que je n’avais jamais analysé, que c’était un besoin de noyer les émotions parce que c’était trop dur à vivre, en fait. Et je pense que maintenant, à l’âge que j’ai - je pense qu’il a le même âge, hein, à peu près - c’est qu’au lieu de continuer à répéter ce schéma, à vouloir noyer les émotions, j’ai décidé de les affronter. La seule façon de vaincre une peur, c’est de l’affronter. La seule façon de faire disparaître une souffrance, c’est de la comprendre. Et du coup, de la regarder. Et en la regardant, en la comprenant… elle s’en va.
Manon Heugel : Peut-être que Sylvie ne guérira pas simplement parce qu’elle a regardé les Soprano. Mais ce qui est certain, c’est que Christopher Moltisanti, en devenant le miroir de Sylvie, lui a permis d’apprendre à s’aimer elle-même. Je lui ai demandé ce qu’elle ressentait aujourd’hui pour ce personnage.
Sylvie : J’ai juste envie de le serrer dans mes bras et de lui dire : mec, c’est cool, ça va. Ça va le faire, moi j’te kiffe, tu vois ! Merci. j’ai envie de lui dire merci. Comme j’ai envie de dire à tous les gens qui m’ont apporté dans la vie, tu vois, qui m’ont aidée à être la personne que je suis aujourd’hui, qui m’ont aidée à m’en sortir, à avancer, et à construire, et à créer. Et j’ai envie de lui dire merci.
Manon Heugel : Le lendemain de cette nuit passée à parler des Soprano et de sa famille, Sylvie et moi sommes allées marcher sur la plage de Cannes.
Son d’ambiance : Pas dans le sable, on s’approche de la mer, bruit des vagues
Sylvie : Ouais, un de mes meilleurs souvenirs, avec mon père, ici à Cannes, on venait de voir Batman et Robin au cinéma, et on était ici à la plage. Mon père était posé en train de lire sur la serviette, et moi j’ai passé des heures à jouer dans les vagues, j’ai refait tout le film dans les vagues. Une bulle spatio-temporelle, où je refaisais le film. Je refaisais Batman. J’étais le héros qui sauvait le monde, quoi.
Manon Heugel : Tu le vois ton père, quand t’es ici à Cannes ?
Sylvie : Ouais grave. Je réalise pas trop encore. Ouais. Ouais ça va être quelque chose je crois. Ouais je le revois. Avec ses lunettes de soleil. Je pense que c’était un père aimant, tu vois, il avait ses… C’était un rêveur. C’était un rêveur, le monde était trop dur pour lui. Et pour mon frère… mon frère aussi. Et moi, je rêve d’en faire un monde meilleur pour leur prouver que c’était possible, tu vois. Et pour que les gens… qui galèrent, et qui souffrent comme eux puissent se sentir mieux, tu vois. Qu’on puisse tous avoir un rêve… qu’on puisse tous avoir un monde qui nous rende heureux, tu vois. Faut arrêter de souffrir comme ça.
Manon Heugel : Pleurer devant les films, c’est le signe de notre empathie. Pleurer devant les films prouve que nous savons aimer, regretter, pardonner, et comprendre l’autre. Pour moi, c’est la preuve que la fiction, et partant de là le cinéma, le théâtre, le roman, la série, sont indispensables. Que les métiers d’artistes - les scénaristes, les comédiens et comédiennes, les réalisateur.ice.s - sont nécessaires pour faire ressentir le monde. Nous essayons de tendre au public un miroir dans lequel il peut contempler sa propre humanité. Quand je vois le chemin que Sylvie a parcouru grâce à une série, je suis fière d’avoir choisi de raconter des histoires, d’écrire et de réaliser des films. Je n’ai pas la prétention de croire que les films peuvent sauver le monde. Mais j’ai la prétention de croire qu’ils sont essentiels.
Générique
Brune Bottero : Vous venez d’écouter Émotions.
Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Manon Heugel. Elle vous faisait entendre les témoignages de Emma Barcaroli et de Sylvie, et les explications de Romain Compingt et Tamara Guénoun. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site.
Camille Bichler était en charge de la supervision éditoriale de cet épisode, accompagnée de Capucine Rouault. Charles De Cillia en a fait la réalisation et Benoît Daniel s’est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c’est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d’Émotions.
Si cet épisode vous a plu et que vous vous intéressez à la construction de personnages de fiction, je vous recommande l’écoute de En écriture, une série de podcast développée par Louie Média, dans laquelle des scénaristes, écrivaines, compositeurs, nous dévoilent leurs processus d’écriture.
Émotions est un podcast de Louie Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounoua directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale.
Émotions, c’est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts : Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou Spotify.
Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n’hésitez pas à nous écrire à hello@louiemedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons.
Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts : Travail (en cours), Passages, Injustices, Fracas, Une Autre Histoire, ENTRE ou Le Book Club.
Bonne écoute, et à bientôt.