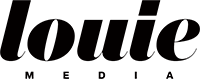Retranscription : Tamara Al Saadi
Générique
Agathe Le Taillandier : L'hiver dernier, je suis allée voir une pièce de théâtre. Sur le plateau, le personnage de Yasmine découvre qu'elle ne sait plus lire. Pour comprendre cette rupture brutale, elle va devoir se confronter à son double. La Yasmine née à Bagdad, celle qui a dû fuir l'Irak enfant à cause de la guerre et s'installer en France avec sa famille. Il y a alors deux Yasmine en scène, deux comédiennes, pantalon à rayures verticales, tresses nouées sur le côté, elles se ressemblent peut-être un peu, mais elles se font face, s'affrontent. Tu es empechante, tu es un obstacle ambulant, crie celle qui s'est assimilée à la France, loin de sa langue maternelle et de ses souvenirs. Alors que son double, la Yasmine irakienne, l'interpelle pour qu'elle n'oublie pas complètement d'où elle vient.
Ce spectacle, intitulé Place, est signé par la metteuse en scène Tamara Al Saadi. C'est l'histoire d'une quête intime pour ne jamais devenir étranger ou étrangère à soi-même. La jeune femme d'origine irakienne, arrivée en France à l'âge de 5 ans, s'empare de ces questions autobiographiques dans son travail théâtral. Grâce au roman du jour, elle a pu replonger dans les odeurs de son pays et renouer avec ses origines.
Son prochain spectacle, Brûlé.e.s, interroge les mécanismes de la stigmatisation et de la violence symbolique. Il est présenté au CENTQUATRE-PARIS, dans le cadre du festival Les singulier.e.s, qui met à l'honneur des créations transdisciplinaires et dont le Book Club est partenaire. Théâtre, danse, musique, arts visuels et cirque se mêlent autour d'un thème commun: le portrait et l'autoportrait. Et pour cette nouvelle édition, le programme prend une couleur plus que jamais féminine. Vos épisodes du Book Club donnent la parole à des créatrices programmées au festival Les Singulier.e.s. Aujourd'hui, donc, l'artiste Tamara Al Saadi.
Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le club.
Générique
Tamara Al Saadi : Le Petit chose d'Alphonse Daudet. Je l'avais lu en Première. Et ce livre, je ne suis pas vraiment capable de vous dire de quoi il parlait maintenant à part de la trajectoire un peu ratée d'un personnage, mais je me rappelle qu'il m'avait mis tellement hors de moi en le lisant. Je ne supportais tellement pas le choix du personnage principal, que ça m'a fait monter une espèce de crise nerveuse, de rage en lisant et je l'ai jeté à travers ma chambre et sans faire exprès il est passé par la fenêtre. Bon, une relation un peu passionnelle avec, ma première relation avec un livre qui m'a marqué, un peu passionnelle.
Il est 17 heures 36 et juste avant de commencer cet enregistrement, j'étais assise sur mon lit adossée contre le mur et je pensais à ma mère. Alors, mon appartement est un deux pièces assez calme dans une petite courette. J'y vis seule et actuellement, pendant que je vous parle, j'ai la sensation que les voisins qui habitent au-dessus de chez moi sont en train de s'embrouiller ou de jouer à un jeu. Peut-être qu'ils sont en train de s'embrouiller en jouant à un jeu. Je ne sais pas exactement. Là, tout de suite, je suis dans ma chambre et dans ma chambre comme dans la pièce à vivre à côté, il y a une grande bibliothèque. J'ai notamment choisi cet appartement pour ça parce que quand je suis venu le visiter, cet appartement, j'étais avec un ami et il m'a fait une remarque qui m'a bien plu, m'a dit "Oh, il y a des bibliothèques naturelles et ça m'a fait rigoler cette expression de "bibliothèque naturelle". Comme si, tout d'un coup, des bibliothèques pouvaient pousser naturellement dans les espaces. En fait, ça voulait dire qu'il y avait des murs, il y avait des encastrés dans les murs et dans lesquels on pouvait mettre des étagères. Et ça, ça s'appelle des bibliothèques naturelles. Et j'ai trouvé ça très joli.
C'est bizarre. Je crois que mon amour des livres est d'abord passé par leur odeur. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais j'aime beaucoup l'odeur des vieux livres et ma sœur, quand j'étais petite, m'avait emmené pour la première fois à la bibliothèque municipale. Elle lisait beaucoup. Elle avait un amour de la lecture et elle m'avait fait une petite carte d'abonné pour enfant. Et elle m'emmenait parfois choisir des livres. Et la première fois que j'y suis allée, j'étais très impressionnée et j'aimais beaucoup l'odeur des livres. Mais, je me suis pas mise à lire beaucoup immédiatement, malgré le fait que mon père me mettait beaucoup de pression sur ça. C'est drôle. C'est quelqu'un avec qui je ne parlais vraiment pas beaucoup. On n'avait pas du tout beaucoup de communication. Il me parlait très peu, il me faisait peur, mais parfois, il me disait "Est ce que tu as lu des livres cette semaine?" Et quand je lui disais non, il me criait dessus en me disant qu'à mon âge, peu importe l'âge que j'avais, il lisait au moins trois ou quatre par semaine. Il avait commencé à faire ça très tôt. À partir du moment où j'ai appris à lire, j'ai appris à lire en français. Lui ne lisait pas en français, il lisait en arabe, il pouvait lire aussi en anglais ou en russe, mais on ne lisait pas la même langue, mais peu importe. Il fallait que je lise. Il se fichait un peu de quoi. Il me disait juste combien il était très attentif à la quantité. Et je crois que ça m'a un peu bloqué d'être terrorisée par le fait de devoir lire, d'avoir une espèce d'œil de Moscou sur moi. Et puis, j'ai grandi, autour de l'adolescence, il a juste arrêté de me parler. Il ne me parlait plus finalement. Peut-être qu'il était rassuré par le fait que j'avais de bonnes notes à l'école. Je ne sais pas vraiment, mais c'est précisément à l'adolescence que j'ai commencé à lire vraiment. Je me souviens qu'en fait encore une fois, c'est l'odeur des livres qui m'a amenée vers la lecture. C'est bizarre cette espèce de fétichisme autour des odeurs, mais en fait, je me promenais à Saint-Michel, dans le Quartier latin, avec une amie à moi. J'avais 16 ans. Et on est passé devant le magasin Boulinier, boulevard Saint-Michel, où il y avait des livres de seconde main, et on a acheté plusieurs livres et je crois les avoir achetés pour leur odeur en fait pour cette odeur de vieux livres J'ai acheté, je me souviens, Moi, Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée, Stupeur et tremblements et Le Baron perché. Je les ai lus dans cet ordre là et je les ai comme avalés. Je les ai lus de façon très compulsive et une fois que j'en avais lu un, puis deux, puis trois. Tout d'un coup, c'est comme si j'étais tombée dedans et j'ai plus pu m'arrêter tout d'un coup c'était devenu très addictif. J'ai été soudainement saisi par le besoin et la nécessité d'écrire, d'écrire, de lire (rires). Pardon, je me rends compte de mon lapsus.
Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Dispersés, écrit par une autrice irakienne qui a été longtemps journaliste et qui s'est mise à écrire des romans qui s'appelle Inaam Kachachi. Ce roman a été traduit de l'arabe irakien par François Zabbal. C'est un roman, mais je pense que c'est un roman, je crois avoir compris d'inspiration autobiographique, disons. En tout cas, je crois que les personnages, et notamment le personnage principal qui est décrit, qui s'appelle Wardiya et qui est une femme qui existe dans l'entourage de la romancière et donc l'histoire commence par, on comprend que on suit une femme d'un certain âge qui s'appelle Wardiya, qui habite à Paris, fraîchement, qui habite récemment à Paris, qui appartient à une minorité, à la minorité chrétienne irakienne, qui est donc, entre guillemets, réfugiée, même si elle n'aime pas ce mot depuis peu de temps. Et donc, on est propulsé dans la vie de Wardiya qui, en fait, on comprend que c'est une gynécologue de renom qui a été une des premières gynécologue à, dans les années 50, à ouvrir une maternité dans une ville irakienne qui s'appelle Diwaniya, alors qu'elle vient de Mossoul. Elle est envoyée dans cette ville où elle pense qu'elle va dépérir et finalement, elle y passe vingt ans dans une ville plus conservatrice, à dominance surtout chiite. Il n'y a pas de femme médecin à l'époque et tout d'un coup, elle, elle commence à prendre des initiatives, à rencontrer l'hôpital, les habitants de cette ville et à y être très bien accueillie et à prendre de très grandes initiatives, particulièrement pour une femme. Et on suit la vie de ce médecin pionnier depuis les années 50.
C'est un aller-retour entre son expérience de réfugiée alors qu'elle a à peu près 80 ans en France et les souvenirs qu'elle a de l'Irak, de sa traversée, de sa vie, quoi, dans son rapport à la médecine et à cette ville. Puis elle se marie. Elle part à Bagdad. Elle a trois enfants. Ses enfants quittent l'Irak à cause des évènements et des opportunités, des événements successifs que vit l'Irak, partent entre Dubaï, Haïti, le Canada. Et puis, à partir de 2003, le chaos est sans précédent et elle se retrouve à devoir, donc vraiment contre son gré, à quitter l'Irak et donc le pays où elle peut se rendre et qui l'accueille c'est la France. Et à Paris, elle est notamment accueillie par sa nièce, sa nièce qui nous décrit cette femme de près, de loin et donc cette nièce a un fils qui s'appelle Iskandar. Il s'avère que c'est sa tante qui a mis au monde son fils. Et en fait, un lien se tisse aussi entre cette vieille dame, Wardiya et Iskandar, qui commence un peu à rencontrer l'Irak. Et ce garçon, comme en réponse à la diaspora irakienne qui grossit et qui est forcée à la dispersion des Irakiens, répond à une espèce de drôle de demande et crée un cimetière virtuel pour les Irakiens pour qu'ils puissent enterrer leurs morts. Voilà la question de l'exil, des racines et du déracinement sont questionnées. Il y a des trajectoires féminines, une cellule familiale éclatée, l'histoire de Wardiya et de du rapport à ses enfants qui lui manquent. On a l'impression d'être écartelé partout dans le monde, donc c'est de ça dont parle ce livre.
Alors, ce livre m'a été offert par ma grande sœur pour mes 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34 et je n'ai pu lire ce livre qu' en fait, au dernier confinement. Donc, je n'avais pas encore 34 ans, j'en avais 33. Et quand j'ouvre les premières pages, ma sœur m'a écrit un mot, un mot écrit en arabe. Elle a écrit : "À ma petite sœur chérie, Tania, Paris 2016". Alors, c'est important pour moi qu'elle ait écrit en arabe parce que moi je ne sais pas lire l'arabe. Je l’apprends tonnant ballant et je l'oublie, j'y reviens enfin j'ai un vrai blocage avec ça, avec le fait de lire et d'apprendre des choses sur l'Irak, je me rends compte qu'à chaque fois que je m'y mets, je n'y arrive pas, c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai essayé de lire des livres historiques, des romans, regarder même des documentaires, c'est difficile, ça me coûte. Et je ne sais pas pourquoi, alors que je suis de nature assez curieuse et que je fais ça pour plein d'autres choses, pour plein d'autres thèmes. Mais concernant l'Irak, je n'y arrive pas. Alors j'ai eu, je sais pourtant, et je suis né à Bagdad. Je suis arrivé en France autour de mes 5 ans. Ma langue maternelle est donc l'irakien. Mais quelque chose bloque et j'ai essayé de comprendre quoi et comment. Et c'est notamment le sujet de ma pièce Place, qui a été présentée récemment. En fait, ce livre est très important parce que là, de là, ma sœur veut m'initier de façon assez douce à la littérature irakienne et m'offre ce livre. Et puis, je commence à lire quelques pages comme ça, et puis en fait ben j'arrive pas, j'abandonne. Fallait-il une pandémie mondiale qui me fasse rester chez moi pour que je me confronte à ce livre, que je le regarde et que je me dise "vas-y, recommence, dépasse les premières pages" et j'ai réussi quoi, j'ai réussi à le lire en entier. Et heureusement, heureusement. Parce que clairement, il y a eu un avant et un après pour moi.
En quoi ce livre a été fondamental ? Bon, moi, je suis en mal de mes racines. Je suis retournée pour la première fois à Bagdad en 2016. Je cherche un peu l'Irak sans la trouver. Je passe mon temps à ça. Même si le fait d'aller à Bagdad avait été formidable pour moi et de retrouver ma maison d'enfance, il y a quelque chose, j'ai une carence d'irakité. C'est-à-dire que je suis vraiment tombée dans les rouages de l'assimilation. Très jeune, on m'a fait sentir que le fait d'être arabe était un problème, à germer en moi, une espèce de graine de la honte où il fallait vraiment effacer mon arabité le plus vite possible. Je pose le mot assimilation, le mot intégration, c'est à dire que je pense que l'intégration, c'est une rencontre, ces deux cultures qui se rencontrent, des langues qui se rencontrent, qui se mutualisent. Je viens avec une culture, une langue. Je m'intègre à un lieu qui m'accueille, je le rencontre, je l'apprends et je deviens plus riche parce que je parle plusieurs langues, que je comprends plusieurs sociétés, que je connais, plusieurs cultures. L'assimilation, je dirais que c'est une forme de colonisation culturelle, de l'intime. C'est comme une culture qui en interdit une autre, qui veut, qui se veut totale. Et malheureusement, ma rencontre avec la France s'est faite par l'assimilation. Donc, je pense qu' une constellation d'événements depuis mon enfance, entre la cellule familiale, l'école, les différents espaces sociaux m'ont vraiment fait intégrer qu'il fallait que je tue cette arabité et je me suis rendu compte très tard de ce qui s'était passé. De toute forme de processus de violence symbolique, on finit par retourner le racisme contre soi. On n'a plus besoin de nous faire sentir que c'est une mauvaise chose d'être étranger. On l'alimente tout seul. Ça, j'ai réussi à le déconstruire très tard. Autour de mes 28 ans, j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait. C'est pour ça que j'ai écrit Place. Mais mine de rien, en fait, les ravages sont faits. Il y a quelque chose qui est mort et il y a un chemin que je ne sais plus faire et je ressens toujours un manque, un manque de moi. Le fait de lire ce livre a été absolument primordial parce que, encore une fois, la littérature a été salvatrice. En fait, je reconnaissais et je ressentais beaucoup de choses. C'est comme si je comprenais l'écriture d’Inaam Kachachi de dedans. C'est comme si une partie de mon identité. Ça m'a reconnecté avec des saveurs, des odeurs, même des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Le fait de reconnaître des mots du dialecte irakien qui n'existent qu'en irakien, c'est comme si je voyais les espaces, même des espaces où je ne suis pas allée, des villes où je ne suis jamais allé en Irak. Je voyais très intimement et très clairement de quoi il s'agissait. Par la littérature, par son écriture. Cette femme m'a rendu mon pays d'origine et en fait, la clé, elle était là. C'est à dire que c'était forcément la littérature, la littérature donne accès, un endroit à des cultures qui est très, très intime et très, très profond et très subtile. Et tout d'un coup, elle a ouvert la porte à ça. Pour moi.
“Dans Dispersés, un élément récurrent vient ponctuer le récit : l'importance du passeport pour le peuple irakien et Anagrammes caché raconte combien l'objet passeport est vital pour les Irakiens, car il en va de leur vie. Ils sont porteurs de liberté autant que d'identité. Au vu de votre histoire et de votre connaissance de l'Irak, comment comprenez-vous cela?” Oh oui, je le comprends très bien. Je me rappelle à quel point notre passeport était l'élément le plus important de nos vies. Quand on arrivait en France, ma mère vérifiait tout le temps où étaient nos passeports, ce fameux passeport vert. Moi j'étais mineur. Ma photo d'identité était dans le passeport de ma mère. Donc, j'avais le même passeport qu'elle, quoi. Et cet objet était très, très important. Et puis, ça a été pour moi. Après, c'est devenu vraiment un objet de malheur parce que ce passeport irakien a été un frein pour beaucoup de choses. C'est effrayant quand on arrive avec un passeport irakien dans n'importe quelle douane, on sait qu'on va passer un sale quart d'heure. C'est une expression parce que c'est un quart d'heure qu'on passe mais vraiment plusieurs heures. Moi, je suis arrivé en France vers cinq ans, mais j'ai obtenu ma nationalité française autour de mes 23, 24 ans et entre ces moments là, j'ai renouvelé ma carte de séjour et en fait, ce passeport et cette identité irakienne m'était renvoyée en plein visage en permanence, comme si j'étais sur un siège éjectable. Je revenais à la préfecture de police, au service étranger pour renouveler ma carte de séjour. Je n'étais pas sûre qu'elle soit renouvelée. Et puis, on me ramenait à ce passeport. Ce qui était quand même assez ironique, c'est que je ne savais même pas lire ce qu'avait écrit à l'intérieur de ce passeport, étant donné que je ne savais lire que le français. Voilà, donc, c'était un rapport. J'ai une grosse histoire avec ce passeport. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'étais petite, je voyais les grands, mon grand frère, ma grande sœur, mes parents, parler du fait qu'il fallait accéder à la nationalité française pour qu'on soit libre, libre de nos mouvements, libres de voter, libres de plein de choses. Moi, j'étais petite et je ne comprenais pas ce qui était drôle. C'est moi qui avais le moins de souvenirs de l'Irak et je leur disais "Mais pourquoi voulez-vous la nationalité française? Pourquoi avez- vous avez un passeport français? Moi, je veux garder mon passeport irakien" et je me rappelle de mon frère et ma sœur qui rigolaient et qui me disaient "Tu verras, quand tu grandiras, tu comprendras à quel point ce passeport tu n'en veux pas". Mon entretien de naturalisation, c'est drôle ce mot naturalisation. On m'a demandé "Est-ce que vous voulez retourner en Irak?" “Non”. "Est ce que vous avez des amis avec qui vous parlez? Irakien?" “Non”. "Quel est votre lien avec l'Irak?" “Non, il n'y en a pas”. Il fallait que j'affirme mon renoncement pour prouver mon envie d'être française. Alors que je n'ai pas envie d'être française. Je suis Française.
Générique de fin
Agathe Le Taillandier : Vous venez d'écouter Tamara Al Saadi à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Salah. Elle vous recommande Dispersés de Inaam Kachachi, paru chez Gallimard et traduit par François Zabbal.
Tamara Al Saadi est comédienne, auteure et metteuse en scène. Son dernier spectacle, Brûlé.e.s, est présenté au CENTQUATRE-PARIS, dans le cadre du festival Les singuliers singulières.
Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du club. Elle a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Haubané a réalisé le mixage. La musique a été créée par Antoine Graugnard et Mélodie Lauret. Ce podcast est une création Louis Media, rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditorial. Marion Girard, responsable de production. Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounoua, directrice des productions.
Cet épisode est en partenariat avec le festival Les Singulier.e.s, qui a lieu au CENTQUATRE-PARIS.
À très vite.