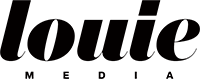Thibaut Jamin, bénévole en première ligne
/ILLUSTRATION : BRICE LAURENT
Lorsqu’une catastrophe survient, certains ressentent de la tristesse, de l’incompréhension ou de l’empathie. Pour d’autres, c’est un mélange bouillonnant d’émotions qui enclenche chez eux une volonté d’agir. Mais par où commencer? Démuni.e.s par leur manque d’expérience, plusieurs se sentent inutiles face à leur incapacité à secourir les victimes. C’est justement ce sentiment qu’a vécu Thibaut Jamin lors des attentats de 2015 à Paris et qui l’a poussé à s’engager auprès de la Croix-Rouge française: « Je me suis senti particulièrement touché du fait de mon métier, parce qu’il s’est passé des choses dans les salles de concert et moi à l’époque j’étais régisseur dans les salles de spectacles aussi. Ça a été le moment pour moi un peu de me poser les questions sur ce que j’avais envie de faire de plus que mon métier et peut-être que je pouvais apporter mon aide dans certains domaines ». (2’03) Pour combler son sentiment de frustration et de colère, il décide, à ce moment-là de suivre une formation de premiers soins.
Depuis maintenant trois ans, d’incendies en accidents, Thibaut Jamin accompagne les troupes médicales en arborant son manteau rouge et blanc, symbole de la Croix-Rouge française. Cet équipier secouriste - qui porte secours aux personnes blessées - est aussi responsable des missions de secours à l’unité locale du 9e arrondissement de Paris. Pendant le Covid-19, il n'a pas hésité une seconde à continuer de s’engager, et à aider. « Le jour où j’ai appris le confinement, j’ai voulu tout de suite référencer tout ce que je pouvais référencer, me préparer. J’ai relavé mon uniforme, j’étais prêt à partir tout de suite, mais c’est pas le bon réflexe, c’est pas comme ça que ça se passe, il faut que ça s’organise (…) sinon on risque de créer un suraccident, c’est-à-dire envoyer des bénévoles sans consignes suffisamment précises, et potentiellement créer encore plus de victimes ». (6’24)
Le weekend du 4 et 5 avril, Thibaut Jamin a participé à une opération assez inédite. Appelée « Chardon 7 », cette mission avait pour but de déplacer des victimes stables du Covid-19 dans un train médicalisé depuis Paris vers la Bretagne. « Le principe, c’est de mettre des patients en réanimation dans des trains, et de les emmener dans des hôpitaux de France, qui sont moins touchés par le Covid-19. C’est une activité qui avait été pensée suite aux attentats de 2015 pour évacuer un grand nombre de victimes dans des hôpitaux qui auraient des places disponibles […] Quand le train part, mon rôle comme les autres secouristes, c’était de faire le lien entre le rez-de-chaussée qui était devenu un hôpital de réanimation complet avec des médecins, du matériel de réanimation (…) et puis les étages du train qui étaient des zones de vie avec des pharmacies complètes comme dans un hôpital, avec des points logistiques, des réserves d’oxygène, des batteries de secours ». (8’20)
Aujourd’hui, il.elle.s sont près de 9 000 intervenants secouristes auprès de la Croix-Rouge française à partager cette même vocation et à venir quotidiennement en aide aux personnes touchées par des catastrophes.
Clichés est podcast co-produit par La Croix-Rouge française et Louie Media. Il est présenté par Sophie Bacquer. Nicolas Vair a fait la réalisation et le mixage de cet épisode. Marine Quéméré en a composé la musique.
Si vous êtes étudiant.e, salarié.e ou bénévole à La Croix Rouge française et que vous voulez raconter votre histoire autour de votre engagement, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à clichespodcast@gmail.com