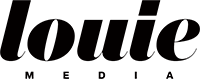Vivons-nous vraiment dans une société visuelle?
/Au début, on était un peu comme ça :
On entrait dans les années 2010, on devenait accro au son, aux histoires, à ces bulles dans lesquelles on s’immergeait le soir en rentrant du bureau, en faisant nos courses, voguant entre le rayon soupe et le rayon chocolat, le casque sur les oreilles. On devenait accro à ces moments, dilués entre le lundi matin et le dimanche soir, entre le pliage de chaussettes, le ménage, les séances de sport. Pour un peu, on se serait mises au coloriage, rien que pour avoir de nouvelles occasions d’écoutes. On se shootait aux podcasts dans un monde qui ne jurait que par l’image. Nous-mêmes, quand nos écouteurs étaient rangés, c’était que nous regardions des séries par dizaines. Nous étions inscrites à Instagram, à Facebook, Snapchat.
En France, dans ces années-là, le temps des adultes passé devant un écran était en train d’exploser; il arriverait bientôt à 4h40 par jour. Nous savions que nous vivions dans un monde d’abord visuel. Visuel jusqu’à la nausée, selon l’écrivain britannique Will Self, quiexpliquait en 2015 sur le site de la BBC que notre culture «n’a pas simplement privilégié le visuel, mais mis la valeur de la vision bien au-dessus de celle de tous les autres sens». On se disait: est-ce qu’on n’a rien compris au monde dans lequel on vit?
«Jeter le trouble sur la définition visuelle de la modernité»
Quand Her est sorti en 2013 aux États-Unis, ce film dystopique de Spike Jonze dans lequel les hommes et les femmes tombent amoureux de voix, et dans lequel le futur se présente davantage sous forme d’omniprésence du son que d’omniprésence de l’image, on s’est demandé: et s’il avait raison? Et si les podcasts n’étaient pas une anomalie mais la preuve que nous vivons dans un monde en réalité sonore autant que visuel, le premier seulement masqué par la prééminence du second.
Et puis on est tombées sur ce livre passionnant de Jonathan Sterne, professeur d'histoire culturelle des théories de la communication à l'université McGill à Montréal: Une histoire de la modernité sonore, paru en 2003 aux Etats-Unis. Sterne estime que l’on considère à tort que l’entrée dans la modernité est seulement associée aux transformations de notre culture visuelle :
«En certaines occasions, des formes modernes d’audition ont préfiguré des formes modernes de vision. Pendant et après les Lumières, l’audition se transforme en objet de contemplation. Elle est mesurée, objectivée, isolée et simulée. Les techniques d’écoute mises au point par des médecins et des télégraphistes deviennent des caractéristiques fondamentales de la médecine scientifique et des formes primitives de la bureaucratie moderne. Le son se mue en marchandise susceptible d’être achetée et vendue. Ces faits ébranlent le lieu commun selon lequel la science et la rationalité modernes sont nées de la pensée et de la culture visuelles. (...) Prendre au sérieux le rôle du son et de l’audition dans la vie moderne revient à jeter le trouble sur la définition visuelle de la modernité.»
Pour Sterne, on ne peut envisager la modernité sans les technologies sonores (comme le téléphone) qui ont pleinement participé aux révolutions culturelles du XXe siècle. «Les changements intervenus dans le son, l’ouïe et l’écoute accompagnent des mutations considérables dans les paysages sociaux et culturels au cours des trois derniers siècles», écrit-il en expliquant que les avancées technologiques qui ont permis la reproduction du son (comme le phonographe) sont celles qui ont d’abord bouleversé notre rapport au temps et à l’espace.
«Révolution perceptive»
Citant les travaux de l’historien Stephen Kern (auteur de La Culture du temps et de l’espace), il explique comment la reproduction sonore peut être envisagée une «“base matérielle” des modifications sensorielles de la spatialité et de la temporalité au tournant du XXe siècle, avant qu’elle n’insuffle une “révolution perceptive” au cours des années suivantes. Les technologies sont réputées avoir amplifié et étendu spatialement et temporellement, le son et l’audition.» Citant aussi Claude S. Fisher, auteur d’une histoire sociale du téléphone, America Calling: il rappelle qu’aux yeux de certains chercheurs «la téléphonie a modifié les conditions de la vie quotidienne, qu’avec “cet emblème choc de la modernité” qu’est l’enregistrement sonore, tout a soudainement changé; que la radio constitue la plus importante invention électronique du XXe siècle, transformant nos habitudes de perception tout en brouillant les frontières entre le privé et le public, entre le monde des affaires et la politique».
Même si Jonathan Sterne refuse de déifier le pouvoir de transformation des technologies, ses écrits portent à penser que l’on vit bien dans une société sonore (en même temps que dans une société visuelle). En comprenant ça, on s’est senties moins seules.
Et le constat de Jonathan Sterne ne cesse de gagner en pertinence. La même année que Her, Serial (podcast d’enquête policière racontée en 12 épisodes haletants) allait dépasser le score d’audience d’une saison de Game of Thrones. Le podcast comme média s’apprêtait à exploser : en 2017, les auditeurs réguliers de podcasts aux Etats-Unis en écoutent 5h07 par semaine. Et tandis que, dans notre entourage, les ados s’envoyaient de plus en plus, en même temps que des photos par paquets, des sons via whatsapp (plutôt que de s’écrire), notre consommation de musique ne cessait de croître : le boom musical amorcé dans les années 1970 grâce aux chaînes hifi et aux baladeurs se poursuivant, nous n’avons jamais écouté autant de musique.
Même les Gafa misent sur le son. (Les Gafa = les gens qui disposent de plus de données sur vous et moi que n’importe quel sociologue averti). Les assistants connectés sont désormais posés sur les commodes ou les cheminées entre nos cadres photos et nos télés. Plus de 30 millions de smartspeakers (Amazon Echo, Google Home, Alexa) ont été vendus en 2017, et fin 2018, quand Apple aura sorti son Homepod, plus de 56 millions d’appareils auront été vendus dans le monde. 70% des propriétaires de ces objets disent écouter plus de son chez eux depuis qu’ils en ont achetés.
Demander des podcasts dès le réveil à votre enceinte connectée sera donc bientôt une évidence. Aspirer à ces bulles anti-frénésie, loin du zapping, chercher ces moments de lenteur loin des écrans, laver votre regard, récupérer votre corps en vous levant, marchant, un casque sur les oreilles: tout cela sera sans doute une nouvelle norme. Si vous vous sentiez aussi un peu Bob l’éponge, c’est bientôt fini. On vous laisse aller mettre votre casque pour écouter nos conseils à suivre. Et quitter cet écran pour vous concentrer sur vos oreilles.