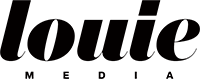Retranscription - Donner aux salariés un pouvoir de décision aussi grand qu’aux actionnaires
Camille Maestracci : Ça fait un peu plus d'un an que Travail (en cours) existe. Le premier épisode a été diffusé la première semaine du premier confinement dans ces circonstances très particulières. On a dû produire ce podcast à distance, faire nos interviews souvent par visioconférences, s'enregistrer sous nos couettes ou dans nos placards plutôt qu'en studio. Mais en février cette année, Louise Hemmerlé, la personne qui s'occupe de la production de Travail (en cours) chez Louie, a pu aller à Bruxelles pour faire une interview en chair et en os avec Isabelle Ferreras, une sociologue belge spécialiste du travail et qui milite pour la démocratisation du travail et une interview en vrai de vive voix.
Ça n'a quand même rien à voir. Cette interview, c'était dans le cadre du Festival de podcasts de Bruxelles pour un enregistrement d'un épisode de Travail (en cours) en live. On est très heureuses que ce moment d'échange arrive enfin jusque dans vos oreilles. Quant à moi, je vais m'absenter quelques temps de la présentation de Travail (en cours) et ce sera à Louise Hemmerlé que vous allez entendre dans cet épisode que vous retrouverez à partir de la semaine prochaine. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail (en cours).
Louise Hemmerlé : J’ai grandi dans une famille où il y avait peu de hiérarchies entre les enfants et les adultes. Nos opinions et mes soeurs et moi avaient de la valeur et on avait de la place pour les exprimer. Et puis, mes parents ne font pas partie des couples qui cachent à tout prix leurs désaccords face à leurs enfants pour asseoir leur autorité parentale. Ils laissaient plein de brèches ouvertes et on ne se gênait pas pour s'y engouffrer à trois, mes soeurs et moi, et exprimer ce qu'on pensait nous aussi.
Et puis quand j'avais 12 ans, mes parents nous ont dit qu'on avait la possibilité de déménager à l'étranger. Ils ne nous ont pas annoncé que ça y est, c'était acté, ont déménageait. Ils nous ont demandé ce qu'on en pensait et vraiment je sentais qu'aucune décision définitive n'avait été prise. Et du haut de mes 12 ans et mes sœurs de leur 10 et 5 ans, on a eu notre mot à dire sur ce changement important dans notre vie. J'ai beaucoup de gratitude envers mes parents pour ça.
En contrepartie, ils se sont retrouvés avec trois filles qui les challengeaient pour tout, tout le temps. À l'école, puis dans mes études supérieures, j'ai emporté ça avec moi. Je ne me sentais jamais inférieure à mes professeurs et toujours parfaitement libres de dire ce que je pensais. Et puis, j'ai signé mon premier contrat de travail pour la première fois de ma vie j'étais la subordonnée de quelqu'un. Et tout d'un coup, alors que je pensais qu'on m'avait quand même recruté pour ma formation, mes compétences, ma personnalité… mes idées n'étaient absolument plus prises en compte.
Il n'y avait même pas d'espace pour que je les exprime. Je devais exécuter.
La conséquence ça a été une perte de sens, un sentiment de frustration, voire d'injustice assez fort. Pour ce nouvel épisode de travail en cours, Isabelle Ferreras a expliqué pourquoi il y a une telle tension entre la culture démocratique de nos sociétés, que ce soit dans nos institutions, dans nos écoles, dans nos familles et la manière dont les entreprises capitalistes sont gouvernées. Isabelle Ferreras est sociologue, spécialiste du travail, maître de recherche du Fonds national de la recherche scientifique belge et professeur à l'Université de Louvain.
Elle est aussi directrice de la classe, technologie et société de l'Académie royale de Belgique et chercheuse associée senior au Labor and Worklife programm de l'Université de Harvard. Elle a développé une théorie politique de l'entreprise qui permettrait de réconcilier entreprises et gouvernements démocratiques. Et cette théorie s'accompagne d'une proposition pour opérer cette transition. Elle appelle ça le bicamérisme économique. J'ai pu l'interroger dans le cadre du Festival de pacage de Bruxelles, le 27 février.
Isabelle Ferreras dans le cadre de votre phd, vous avez réalisé une enquête ethnographique auprès des caissiers et des caissière de supermarché en Belgique et vous avez constaté que les travailleurs, quel que soit leur rôle, ne sont pas seulement animés par leur salaire, mais aussi par une aspiration à la justice. Est ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là?
Isabelle Ferreras : Bien sûr. En fait, ce que j'entends par là, c'est le fait que, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à travailler sur les caissière de supermarché, sur le rapport au travail parce que je voulais comprendre justement quel était le rapport au travail dans nos sociétés et que les caissières semblent un très bon exemple de personnes qui, à priori, développeraient un rapport au travail qu'on peut appeler instrumental, c'est à dire qu'elles vont en fait, allez juste travailler pour le salaire que cette prestation va leur fournir.
Et j'ai dû constater effectivement par mes enquêtes, que c'était faux de faire cette hypothèse. Bien sûr, ces personnes ont besoin d'un salaire, mais en fait, elles vont au travail pour un tas d'autres raisons. Et ces autres raisons, on peut les qualifier d’expressives. C'est à dire, c’est tout ce qui a à voir avec la construction du sens dans nos vies, de qui nous sommes, de notre identité, du rôle que nous avons par rapport à autrui, de notre sentiment d'utilité.
Et finalement, il faut constater en fait que dans l'expérience du travail, nous mobilisons nos conceptions sur la justice. Qu'est ce qui est juste? Qu'est ce qui est injuste? Et ça m'a amené effectivement à développer ce que j'appelle une théorie politique du travail, c'est à dire l'idée que, au fond, l'expérience du travail, c'est l'expérience politique par excellence, parce que ça nous permet de mobiliser nos conceptions sur la justice.
Louise Hemmerlé : Qu’est ce qui nourrit notre envie de peser sur la justice ou en tout cas de peser sur les décisions qui sont prises dans le cadre du travail?
Isabelle Ferreras : En fait, je dirais la réponse la plus simple et la plus fondamentale, c'est l'idée que c'est le fait que nous sommes des êtres humains, tout simplement. Comme Camus le disait toute vie humaine est imprégnée en fait de sens. Le fait d'être un humain, c'est peut se définir par l'idée même que nous construisons du sens sur tout et n'importe quoi. Mais cette aspiration à construire du sens, effectivement, est au cœur de l'humanité et donc, évidemment, le travail ne va pas y échapper.
Louise Hemmerlé : Est ce que vous avez des exemples concrets où vous avez vu cette demande de justice se manifester dans le cadre de travail?
Isabelle Ferreras : Bien sûr. En fait, on en a plein. Ce qui est intéressant quand même, c'est de prendre du recul par rapport à la manière dont notre modèle économique, en fait, justement, perçoit le travail. Parce que notre modèle économique est vraiment fondé sur l'idée que le travail, le rapport du travailleur à son travail va être un rapport instrumental. Et donc, il y a deux institutions là qui vont contraindre si vous voulez le travailleur, c'est à la fois le marché et ce qu'on appelle le marché du travail et l’entreprise.
Et en fait, on a un modèle économique qui prend le travailleur pour une marchandise. Or, effectivement, si on fait des enquêtes sociologiques aussi simplement, on est un être humain soi même. On se rend bien compte que l'être humain n'est pas une marchandise, au sens où il va développer tout ce rapport expressif au travail. Alors je peux prendre, par exemple, un exemple qui avait été très médiatisé en Belgique en 2018, où les caissières de Lidl avaient fait grève.
Et ce n'était pas du tout pour demander des augmentations de salaire. C'était pour avoir la possibilité de peser sur les moments où elles avaient en fait la possibilité d'aller aux toilettes. Pourquoi ça peut paraître évidemment tout à fait anecdotique. Mais en fait, c'est évidemment fondamental parce que ça révélait que le type d'organisation du travail dans lequel elles sont mises les rendait incapables de peser sur quelque chose qui est dès lors d'un besoin fondamental. Et donc, elles s'en sentait déshumanisées.
Ça, c'est pour ce qu'on pourrait appeler des fonctions qui sont considérées comme subalternes depuis avec la crise du Covid, on a vu combien, en fait, les caissières ne sont pas du tout des fonctions accessoires de notre société, mais elles sont en fait des fonctions qui nous permet d'être résilient à toutes et à tous dans la société. Mais au même moment, c'était au printemps 2018. Vous aviez un autre fait très médiatisé. Google était animé par toute une controverse interne parce que les ingénieurs de Google s'étaient rendus compte qu'il était en train de développer un programme qui s'appelle Maiden Project pour le Pentagone, qui était un programme de développement de drones sans décision humaine.
Donc, en fait, ce qu'il était en train de faire, il s'en rendre compte, c'était de l'intelligence artificielle qui allait permettre au Pentagone de mener des programmes d'assassinats ou bombardements, donc à petite ou grande échelle, sans que la décision humaine ne soit plus impliquée. Et là, les ingénieurs de Google, dans une lettre qui est tout à fait emblématique de ce témoignage des conceptions sur la justice qui sont dans l'expérience du travail, ont dit Google is not in the business of war.
Donc, il révélait que eux, ils travaillent pas chez Google pour promouvoir un business de la guerre. Ce n'est pas pour ça qu'ils y sont. En faisant ça, ils révélaient évidemment qu'ils avaient, eux, une vision positive, alors là c’est positionné négativement, mais qu'ils avaient une vision sur quels étaient les finalités de l'entreprise. Et en fait, on en a comme ça des exemples tout le temps. Si vous regardez au conflit du travail, il révèle toujours il y a des enjeux purement économiques ou financiers, des revendications salariales.
Mais ces enjeux, souvent en fait, révèlent des conceptions sur ce qui est juste la dignité du travail, ce qui porte sur les finalités de l'entreprise et les travailleurs. En fait, ce n'est pas étonnant. Enfin, on devrait, on ne devrait même pas avoir la discussion, en quelque sorte. C'est un peu fou qu'on doive tenir cette discussion et qu'on doive s'étonner de voir faire l'argument que les travailleurs ont une vision, évidemment, sur les finalités qu'ils servent.
Louise Hemmerlé : Alors, justement, pourquoi est ce que la tension entre ce besoin de justice démocratique des travailleurs et la gouvernance des entreprises aujourd’hui, pourquoi cette tension est elle si forte en ce moment?
Isabelle Ferreras : Je dirais d'abord, il y a une raison si vous voulez une raison de très long terme qui a à voir avec l'histoire la confrontation entre la démocratie et le capitalisme. Et puis, il y a une raison qui est plus conjoncturelle, qui a à voir avec la montée en puissance de l'économie de services. Si je peux répondre sur les deux points.
Premier point. En fait, nous sommes organisés avec un équilibre très particulier dans nos sociétés. Nous avons d'un côté le champ que nous avons identifié comme le champ des pratiques politiques qui est organisé en référence à l'idéal démocratique.
Et dans ce champ là, nous nous reconnaissons les uns les autres comme des égaux. Il y a une autre offre, si vous voulez, sur la manière d'organiser nos rapports les uns avec les autres, c'est le capitalisme. Le capitalisme en fait, c'est aussi un régime de gouvernement. On entend souvent parler du capitalisme comme si c’était un système économique si vous voulez. Mais en fait, c'est un autre régime de gouvernement. C'est une seconde proposition quant à la manière d'organiser les droits politiques et c'est une proposition concurrente à la proposition de la démocratie.
La proposition du capitalisme, c'est de réserver les droits politiques, c'est à dire les droits de gouverner à ceux qui apportent du capital, et nous vivons depuis plus de deux siècles dans, et c'est ce que les scientifiques américains Josh Cohen et Joe Rogers appellent les démocraties capitalistes. En fait, nous vivons dans cette combinaison très particulière qui a réservé. Si vous voulez le régime de gouvernement démocratique à l'espace politique et le régime de gouvernement capitaliste à l'espace économique. C'est une pure convention, évidemment.
Et cette convention, en fait, elle est en train, à mon sens, de craquer parce que l'idéal démocratique est un idéal qui ne se contient pas, c'est à dire un idéal qui est profondément subversif. Et vous le voyez évidemment quand vous regardez l'histoire longue de la démocratie, si vous regardez même pas si lointain que ça mais le XIXè siècle. Le XIXè siècle dans un pays comme la Belgique, et bien, nous avions un suffrage censitaire masculin.
Aujourd'hui, aux yeux des citoyens belges, ce serait une ineptie d'appeler ça la démocratie. Et pourtant, voilà, c’était la conception à ce moment là de ce qui était la bonne manière de reconnaître, de qui on allait reconnaître comme les égaux politique qui allait pouvoir peser sur le gouvernement commun.
Eh bien, aujourd'hui, c'est cet équilibre entre capitalisme et démocratie. Effectivement, devient difficilement tenable parce que nous avons des citoyens qui ont un niveau d'éducation élevé comme jamais. Nous avons des femmes qui ont le droit de vote en Belgique seulement depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale.
Il n'y a pas si longtemps que ça, ma propre mère, par exemple, a été élevée par une femme qui, quand elle est née, s’est envisagée pas comme un égale politique. Ma grand mère, quant elle est née, n'avait pas le droit de vote. Moi, j'ai été élevée par une mère qui s'envisager comme un égale politique. Et je peux vous dire que si vous rencontrez mes filles, alors là, c'est clair. Et donc là, il y a une avancée véritablement de la culture démocratique qui est en train.
Et votre témoignage pour ouvrir ce podcast je pense, en était une très vive illustration qui est en train de questionner fondamentalement si vous voulez questionner ce qui avait été la manière, le compromis, si vous voulez, entre capitalisme et démocratie. Et pour ça, je parle d'une contradiction. Et aujourd'hui, cette contradiction est en fait en plus, si vous voulez, aggravé par l'expérience même des travailleurs. C'est à dire que quand vous êtes dans une économie de services aujourd'hui plus de 80% dans un pays comme la France, comme la Belgique, 80% des travailleurs en général sont occupés dans les services.
Et qu'est ce que l'industrie des services? Les services, c'est une manière d'être mis au travail très particulière. La meilleure manière de définir le service, c'est une définition qui vient de l'économiste français Jean Gadrey, c'est transformer l'état du bénéficiaire pour transformer l'état du bénéficiaire que vous lui apportiez un soin, une formation, un service de quelque nature que ce soit. Eh bien, vous devez vous mettre à sa place. Vous devez en faites vous mettre dans sa manière de comprendre le monde, de voir les problèmes pour les résoudre, sinon, le client ne va pas être satisfait.
Vous n'avez pas du tout résoudre le problème comme il avait l'intention que vous fassiez. Et ça veut dire que vous rentrez dans un monde où les gens qui sont au travail, eh bien si ils sont au service de quelqu'un ou s'ils preste un service, il y a deux manières de faire.
Soit il s'envisage comme un servant, OK ? Et on peut imaginer qu'on pourrait rebasculer dans une économie où il y a des servants. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot service, c'est Servitium, c'est l'esclavage. Mais je pense qu'il faut justement envisager. L'autre possibilité, c'est que être au service de quelqu'un ne veut pas dire abandonner son statut de citoyen.
Et c'est ce que j'ai appris, évidemment, au contact des caissières, de leurs observations, de comment elles envisageaient le fait d'être au service des clients. Mais pour ça, ça demande de transformer évidemment nos manières de mettre les gens au travail puisque, comme vous l'a dit ils sont subordonnés et si il y a un contrat de travail, son subordonné de rang inférieur et ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'être des citoyens au travail.
MUSIQUE
Louise Hemmerlé : Alors, vous proposez justement de considérer les travailleurs comme des investisseurs en travail, tout comme on considère les actionnaires comme des apporteurs de capitaux. On pourrait considérer que l'investissement des travailleurs est tout simplement compensé par le salaire. Pourquoi est ce que ça ne suffit pas, selon vous?
Isabelle Ferreras : Ben, ça ne suffit pas du tout parce qu'évidemment, on a bien compris que justement, le salaire, c'est une compensation dans le cadre d'une relation de subordination. Or, ce que toute cette contradiction entre capitalisme et démocratie met si vous voulez en jeu, c'est justement le fait que je pense qu'il faut reconnaître, comme vous l'avez dit, que les travailleurs sont des investisseurs en travail. Et pourquoi j'utilise ces termes ? Parce qu'en fait, je voudrais qu'on comprenne que le terme d'investissement devrait justement être reconnu de manière prioritaire aux travailleurs avant ce qu'on appelle les investisseurs aujourd'hui dans notre société.
Quand on parle d'investisseurs, on entend on doit même pas faire un dessin. Les gens pensent à ceux qui apportent du capital et je pense qu'il serait qu'il est descriptivement, beaucoup plus adéquat de parler d’apporteurs de capitaux, parce que c'est ça que font les gens. Si vous voulez apport du capital, il apporte quelque chose qui est extérieur à eux mêmes. C'est une épargne. C'est une richesse privée qu'ils apportent à une aventure économique. Que font les travailleurs?
Ils investissent leur personne, ils s'investissent en personne, personnellement et ils s’investissent, et on l'a vu évidemment dans cette pandémie, corps et santé et jusque âme on pourrait dire, puisque tout le problème du burn out, par exemple, est relié à cela. Pourquoi? Parce que les gens, pour prester un service, doivent effectivement s'impliquer complètement. Et quand on s'implique complètement, on met sa santé en jeu, sa santé physique, sa santé mentale et donc l'investissement en travail, c'est cette partie de l'aventure économique si vous voulez, qui n'est pas reconnue dans un régime capitaliste, puisqu'un régime capitaliste va attacher le droit de gouverner cette aventure à ceux qui apportent du capital, alors qu'il faut quand même bien bien prendre conscience, cet apport en capital, en fait, bénéficie de ce qu'on appelle la responsabilité limitée, c'est à dire que quelqu'un qui apporte du capital au travers d'un achat d'actions, par exemple pour une entreprise. Le risque qu'il court, le seul risque qu'il court, j'aimerais dire que finalement, ils perdent la somme qu'il a injecté dans l'aventure économique.
Ce que court comme risque le travailleur qui aujourd'hui est dans un hôpital, est éboueur, est coursier au service de clients. C'est le risque jusqu'à la perte de sa propre vie, parce que il pourrait mourir du Covid ou de tout autre d'un accident de travail, il met vraiment sa vie sur la ligne. Pour cet investissement là, il n'y a pas de responsabilité limitée. Donc, si vous voulez le minimum qu'il faut et donc là, c'est ce que j'essaye de faire c'est de la description sociologique, c'est de comprendre ce à quoi on a a faire et donc ça doit nous amener je pense effectivement à reconnaître que un service, une entreprise, c'est toujours évidemment un apport de capital. Dans une économie capitaliste, il y a du capital, mais c'est toujours aussi un investissement en travail et c'est investissement au travail est ce que j'appelle la partie constituante qui est totalement niée, oubliée aujourd'hui dans l'architecture institutionnelle de nos sociétés et de l'entreprise en particulier.
Parce que ce qui existe, c'est la société anonyme. Elle, elle est, c'est une. C'est une structure juridique bien identifiée, mais en fait, l'entreprise et si c'était un concept sociologique, ça n'a aucune existence en droit tel quel et c'est tout le problème. Il faut, il faut avancer dans notre compréhension de ce qu'est cette réalité.
Louise Hemmerlé : Alors, justement, pour reconnaître cet investissement au travail et pour dépasser la contradiction entre capitalisme et démocratie, vous proposez de mettre en place un bicamérisme économique dans les entreprises. Est ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agirait exactement?
Isabelle Ferreras : En fait, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut donc partir du fait que cette partie constituante que sont les investisseurs en travail sont aujourd'hui totalement en dehors si vous voulez du design institutionnel de l'entreprise et que il faut constater que c'est un gros problème. C'est un gros problème. Pour des raisons de justice, mais aussi d'efficacité. Et ce qu'il faut saisir là, c'est qu'en fait l'entreprise, elle est mieux comprise comme étant une entité politique. Une entreprise, c'est bien sûr une organisation économique et souvent, on pense que ça suffit de dire ça.
Mais en fait, je défends cette thèse que l'entreprise est une entité politique, c'est à dire que l'entreprise est une manière de mettre au prix. Si vous voulez des investisseurs en travail et des apporteurs de capitaux dans des rapports de pouvoir. Et la structuration du pouvoir que nous avons développée dans nos sociétés occidentales. C'est une structuration du pouvoir qui va donner tout pouvoir, justement, à ceux qui apportent du capital. Et bien, si vous prenez très sérieusement en considération le fait que cette partie constituante oubliée que sont les travailleurs, attendent de pouvoir peser sur les décisions qui concernent leur propre travail, attendent de pouvoir peser sur leur vie au travail.
Et bien, vous vous retrouvez dans une situation historique qui est tout à fait semblable à la situation qu'ont connue des entités politiques qui étaient aux mains d'une petite minorité de possédants dans l'histoire et qui a en fait amorcé l'histoire de la démocratie. Les entités politiques qu'étaient par exemple Rome au 5è siècle avant Jésus-Christ, où seuls les patriciens possédaient le pouvoir de gouverner Rome.
Et bien, ça ressemble étrangement à, mettons, Facebook, par exemple, où seuls ceux qui ont des actions ont le pouvoir de gouverner Facebook. Le compromis qui a été trouvé à Rome au cinquième siècle avant Jésus-Christ, c'est effectivement, ce n'était pas un compromis en au sens où ça a été un choc pour les patriciens. Ça a été l'obligation pour les patriciens de devoir reconnaître que la partie constituante qu'ils avaient complètement oubliée, qu'était la plèbe, en fait, était fondamentale à l'existence même de cette entité politique.
Et la plèbe, c'était quoi? C'étaient les marchands, c'était l'armée. C'étaient tous ceux qui faisaient vivre Rome. C'étaient ces travailleurs essentiels si vous voulez d'aujourd'hui. Et on peut donc comprendre la situation politique dans laquelle se trouvent les entreprises capitalistes aujourd'hui comme relevant de cette situation qu'ont connue un exemple beaucoup plus moderne. C'est l'exemple de l'Angleterre avec la Chambre des Lords, la Chambre des lords, c'était quoi? C'était la représentation des propriétaires des parts des terres de l'Angleterre.
Et effectivement, un conseil d'administration, c'est une chambre qui représente ceux qui ont une part de Facebook, Volkswagen que sais-je. Eh bien, la question qui est devant nous, c'est effectivement nous demander tiens, ce comments : l’investissement en travail, cette partie constituante qui a été ignorée jusqu'à présent de la structure de l'architecture de pouvoir de l'entreprise. Eh bien, Est il raisonnable de continuer à la nier? Et je pense que ce n'est pas raisonnable du point de vue du projet démocratique, c’est clairement une négation de l'idéal démocratique qui est un projet dynamique et un l'idéal démocratique.
C'est pas quelque chose qui, un jour, on sera très content de notre système et on s’arrêter, non. C'est un projet qui va rester toujours une forme d'interrogation de la manière dont les sociétés s'organisent et où elles doivent chercher les moyens chaque fois, d'approfondir la traduction dans la réalité de cet idéal. Et aujourd'hui, l'entreprise est confrontée à ce problème.
Louise Hemmerlé : Et alors, comment fonctionnerait le système de bicamérisme économique que vous proposez? Quelle forme ça prendrait ?
Isabelle Ferreras : Ça peut prendre une série de formes. Disons que pour donner tout de suite une idée claire, l'idée, c'est que dans des pays, ça tombe bien, on parle français francophone, comme la France et la Belgique. On a déjà l'intuition dans la réalité, dans le droit d'une seconde chambre. C'est ce que l'on appelle en Belgique un conseil d'entreprise, en France, un comité économique et social qui s'appelait avant Comité d'entreprise, qui ont été institués à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour traduire cette idée de citoyenneté au travail.
Traduire l'idée qu'en fait, le travailleur devait pas seulement être un citoyen dans la cité, mais citoyen dans l'entreprise. C'est les termes de la loi Auroux de 1982 en France qui institue les comités d'entreprise. Qu'est ce que l'idée du comité d'entreprise? C'est l'idée que, au niveau même de l'entreprise, les travailleurs doivent recevoir le droit de pouvoir choisir des représentants qui vont rencontrer le management. Le top management de l'entreprise pour parler des grands sujets qui concernent l'entreprise, des grands sujets, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en fait, ce que ça a traduit, c'est concrètement se mettre d'accord sur des enjeux d'horaires. Toucher à tous les enjeux de sécurité santé au travail. Des enjeux absolument fondamentaux que l'on a bien vu, d'ailleurs, très fondamentaux dans la crise du Covid. Là où ça a bien fonctionné, dans les entreprises où les travailleurs sont retournés au travail dans les conditions sanitaires tout à fait fiables. C'est là où ces comités ont été très actifs.
Mais ce n'est pas du tout une instance qui est dotée des mêmes pouvoirs que les conseils d'administration. Les conseils d'administration, ce sont ceux qui ont en main. Si vous voulez le gouvernement de l'entreprise, au sens où ils pèsent sur les finalités de l'entreprise, qui va devenir le CIO, qui va être choisi pour diriger l'entreprise? Quelle est la stratégie de l'entreprise? Qu'est ce qu'elle va développer comme production? Qu'est ce qu'on va faire des profits? Toutes ces questions là, évidemment, elles sont réservées aux mains de ce conseil d'administration.
L'idée, c'est de reconnaître que le conseil d'entreprise, c'est l'embryon de cette seconde chambre de représentation des investisseurs en travail et qui doit être doté, à mon sens, des mêmes prérogatives qu'un conseil d'administration. Et donc, la proposition, c'est de fonctionner avec un gouvernement à double majorité. Si vous voulez pour l'entreprise ou il va pas seulement falloir trouver une majorité dans le conseil d'administration pour que le CIO puisse avancer dans sa stratégie, mais qu'il faut valider aussi toutes ses décisions à la majorité du conseil d'entreprise qui représente les travailleurs.
Louise Hemmerlé : Et alors dans le conseil d’entreprise, concrètement, comment sont choisis les représentants des travailleurs?
Isabelle Ferreras : Je pense qu'il faut s'appuyer sur ce que l'histoire a déjà produit et les luttes sociales ont produit. C'est à dire que dans des pays comme les nôtres, il y a des élections sociales qui sont instituées tous les quatre ans et où les travailleurs vont élire leurs représentants, qui se présentent sur des listes déposées par les organisations syndicales reconnues. Et donc, on a déjà si vous voulez, tout ça est en place en fait, dans nos pays, il suffirait simplement de décider de donner plus d'attributions à ces conseils et ces conseils évidemment, quand j'entends ces conseils, c'est la partie de la délégation du personnel dans ces conseils, c'est évidemment pas le top management.
Pour que le top management, justement, rencontre ces conseils, on peut aussi imaginer d'autres formules de traduction de ce principe. L'enjeu, pour moi, c'est le principe philosophique. Si vous voulez ça, on peut se demander si ça peut s'appliquer à toutes les entreprises, par exemple.
Louise Hemmerlé : Justement, est ce que vous pensez que cela s'appliquerait tant aux petites entreprises qu'aux grandes multinationales?
Isabelle Ferreras : Eh bien, je pense que le principe philosophique, effectivement, il tient de la petite taille à la grande taille. Ensuite, la question de la traduction institutionnelle du principe. Je pense que ce design institutionnel, il doit évidemment être adapté et il faut rentrer dans une perspective de pluralisme des formes institutionnelles adaptées à la réalité, de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité, etc.
Mais le principe philosophique, c'est celui ci que nous avons réaffirmé dans le manifeste travail dont on parlera certainement, c'est que les travailleurs doitvent pouvoir à la majorité valider les principes de gouvernement de l'entreprise.
Et ce principe là, si vous êtes dans des petites tailles, par exemple. Moi, j'ai des discussions passionnantes avec des start-upper, comme on dit, qui, eux, sont très intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux, trois. Ils développent une idée pour monter en puissance dans leurs projets, il faut attirer du capital. Et dès qu'arrive un fonds d'investissement, que souhaite faire ce fonds? Ce fonds, souvent, souhaite en fait prendre du pouvoir, évidemment.
Or, ceux qui sont porteurs d'une idée, ils ont envie de continuer à pouvoir avoir cette faculté de collectivement valider les décisions. On peut le voir comme un droit de veto collectif de la part des investisseurs en travail et donc on est vraiment dans une société qui est capitaliste, au sens aussi de comment la culture a été, si vous voulez, dépendante de la compréhension de l'économie dans les termes capitalistes. Et donc, on pense toujours que l'entrepreneur est bien, il faut qu'ils traduisent son génie, si vous voulez dans des parts d'actions dans la société et qu'on va le valoriser de manière capitalistique.
Or, l'entrepreneur, c'est l'investisseur en travail par excellence. Lui, il développe un projet souvent. C'est d'ailleurs pas du tout une personne seule. C'est un petit groupe de gens qui développent un projet. Et collectivement, effectivement, il faut s'assurer qu'ils puissent continuer à avoir cette faculté de collectivement peser sur le gouvernement de l'entreprise et donc valider les décisions. Mais alors, évidemment, c’est pas deux grandes chambres qu'on peut imaginer pour une start up, bien sûr.
Donc, ce principe philosophique, il doit trouver des expressions différentes en fonction des tailles.
MUSIQUE
Louise Hemmerlé : Face à ce principe de décision collective, certains vous opposent le fait que votre modèle équivaudrait à une expropriation des apporteurs de capitaux qui, du coup, perdraient leur pouvoir décisionnel sur l'entreprise. Qu'est ce que vous répondez à ça?
Isabelle Ferreras : Je réponds que je pense qu'il faut bien réfléchir ici, mais ça n'a rien à voir avec une expropriation.
Si vous regardez l'histoire de la démocratie, c'est justement une histoire qui a relâché le rapport entre propriété et droits politiques. Et évidemment que la proposition du bicamérisme économique est une proposition qui essaye de traduire cela concrètement dans le cas des entreprises.
Est ce que c'est une expropriation? Pas du tout, je ne propose pas de nationaliser aujourd'hui toutes les entreprises en expropriant les porteurs d'actions et en leur disant donnez tout ça à l'Etat, aux travailleurs qui vont gérer ces entreprises sans contrepartie.
Pas du tout. Et en ça, c'est un compromis. C'est un compromis qui reconnaît qu'il y a une propriété du capital, mais qui en même temps limite si vous voulez. La faculté de jouissance a d'autres priorités et c'est une situation qui est vraiment typique de l'avancée ou du besoin d'avancées démocratiques. Et je peux prendre un exemple qui est très parlant.
Si on a le temps que je prenne un exemple, c'est justement l'exemple de la chasse en Angleterre au XIXème siècle qui est un débat très vif quand les environnementalistes ont vraiment essayé de mettre en avant le principe du besoin de respecter le rythme naturel si vous voulez de renouvellement des espèces en dix ans, eh bien il faut éviter qu'on chasse à n'importe quel moment pour ne pas chasser les petits ou pour ne pas tuer les femelles qui portent un petit et là, les Lords, propriétaires de leurs terres, ont dit "Mais vous rigolez, tout ça, c'est chez nous. C'est une horrible expropriation que vous envisagez. Puisque ce sont nos terres, nous faisons ce que nous voulons. » Ils ont perdu à la fois, ils ont évidemment conservé la propriété de leurs terres, mais on a contraint cette jouissance au fait évidemment, respecter un calendrier de la chasse.
Et ici, on est dans cette même perspective. La propriété, ce n'est pas quelque chose comme vous dont vous jouissez seul et juste pour vous, même quand votre propriété est en train d'avoir des conséquences sur autrui. Au point même qu'en fait, vous vous rendez peut être même plus compte que votre propriété n'a de la valeur que parce qu'il y a tout cet investissement en travail qui se joue en interaction avec votre propriété, Il est tout à fait normal que la société démocratique développe des nouveaux droits pour que cette propriété soit ré encastrer si vous voulez, dans des principes conformes au projet démocratique.
Louise Hemmerlé : Pour revenir sur votre modèle. Pour bien le comprendre, il faut comprendre la différence entre le fait d'impliquer les travailleurs dans la gestion de l'entreprise et le fait de les impliquer dans le gouvernement de l'entreprise. Est ce que vous pouvez expliquer cette différence?
Isabelle Ferreras : Oui, tout à fait. Ce que j'essaye de tenir là avec cette spécification, c'est le fait que aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui développent toute une série de dispositifs participatifs de leurs travailleurs, qui sont des manières d'impliquer les travailleurs dans la gestion.
Et la gestion c'est quoi? C'est en fait l'ensemble des décisions qui portent sur les moyens. Et je distingue ça du gouvernement, de l'entreprise parce que le gouvernement de l'entreprise, c'est l'ensemble des décisions qui portent sur les fins, les finalités et ce qu'on voit c'est énormément d'innovation managériale en fait dans la gestion pour impliquer les travailleurs, mais très peu d'innovation encore sur la faculté des travailleurs d'être impliqués dans le gouvernement.
Louise Hemmerlé : Mais ça ressemble à quoi le fait d'impliquer les travailleurs dans la gestion?
Isabelle Ferreras : Eh bien, par exemple, vous avez certainement entendu parler des entreprises libérées. C'est un mouvement qui a maintenant une bonne dizaine d'années et qui est bien connu en France, en Belgique aussi.
Finalement, elles sont libérées de quoi les entreprises? Elles sont libérées du management, mais elles sont pas du tout libérées de l'actionnaire. Et évidemment, quel dispositif plus merveilleux pour un actionnaire que finalement, de pouvoir se dire et bien évidemment, les travailleurs dans cette entreprise sont c'est eux qui connaissent le mieux le business.
On a évidemment besoin qu'ils soient motivés à fond. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans une économie de services, c'est absolument impératif si vous voulez que le travail soit bien fait, que les travailleurs soient hyper motivés et puissent avoir en fait une marge de manœuvre sur les décisions qu'ils vont mettre, même en œuvre.
Mais c'est d'un confort magnifique puisque vous allez vous garantir que le service, la production va être la plus ajustée possible en laissant cette marge de manœuvre sur la gestion.
Mais vous gardez en main le gouvernement et la question de, par exemple, qu'est ce qu'on va faire avec les profits? Ou bien quelles vont être les grandes décisions sur la stratégie commerciale de l'entreprise? Ça en tant qu’actionnaire, vous gardez cela bien en main et donc oui, aujourd’hui on a vu apparaître cet cette, ces pratiques qui sont pour moi une réponse à ce que j'appelle la critique politique du travail que portent les travailleurs, c'est à dire à tente de peser sur les conditions d'organisation et les finalités de leur travail.
Mais c'est une manière de récupérer cette critique pour pouvoir, si vous voulez la cantonner aux enjeux de gestion.
Louise Hemmerlé : Est ce que vous pouvez juste rappeler ce que sont les entreprises libérées, la manière dont elles fonctionnent?
Isabelle Ferreras : Oui. Les entreprises libérées, ce sont des entreprises qui s'inspirent d'un livre important qui a été publié par Corny et Gates. Qui sont, Azza Gates Il est professeur dans une école d'une grande école de commerce business en France et qui s'appelle Liberté Incorporated.
L'idée, c'est que justement, les entreprises doivent être un véhicule de déploiement de la liberté. Donc, vous voyez, il y a une réflexion derrière qui porte sur vraiment cette place de l'entreprise dans la société.
Mais cette réflexion, elle est très libérale, je dirais, parce qu'elle est, elle porte sur une conception très réductrice de la liberté, au sens individuel et au sens aussi très, très limitée, puisque c'est une liberté qui va peser sur les moyens de gestion et pas sur les finalités.
Il y a un très beau livre que je peux conseiller à vos auditeurs s'ils sont intéressés à réfléchir à ça. D'abord, il faut lire Corny et Gates. Mais il faut aussi lire en parallèle le livre de Yohann Chapoutot qui est historien du nazisme qui a publié en 2020 Libre d'obéir chez Gallimard, qui êtes une recension en fait, de combien le management sur lequel s'est appuyé le Troisième Reich est un management qui est imprégné de ce même type de propositions, c'est à dire un management qui a laissé énormément de marge de manœuvre à ces travailleurs parce que quand vous annexez comme ça, tout d'un coup, un pays vous vous annexez l’Autriche, en fait, vous ne savez pas faire du planning. Tout peut pas être décidé depuis le l'Etat-Major.
Donc vous devez laisser une liberté énorme d'exécution, mais vous garder en main. Évidemment, les finalités et les finalités du projet nazi n'étaient pas quelque chose qui allait se discuter à n'importe quel échelon. Et donc, c'est très intéressant de voir que le principe même de mobiliser en fait le meilleur des travailleurs dans un périmètre très limité.
Ce n'est pas du tout un principe nouveau. Ça nous montre le travail de Chapoutot et vous pouvez remonter comme ça dans l'histoire. Parce qu'en fait, le capitalisme, dans son histoire managériale, a toujours eu conscience de l'importance de mobiliser les travailleurs dans les dispositifs de gestion.
Louise Hemmerlé : Pour rester sur l'Allemagne en 1951, le Bundestag a imposé aux entreprises du secteur du charbon et de l'acier de mettre en place justement un conseil de surveillance paritaire entre actionnaires et travailleurs.
En quoi le contexte historique a joué dans l'apparition de cette institution de gouvernement paritaire de l'entreprise?
Isabelle Ferreras : Tout à fait. C'est très précieux que vous parliez de la co-détermination allemande parce que il y a certains points communs avec le bicamérisme économique et en même temps, il y a une grande différence.
Le point commun, c'est que ce que l'Allemagne a fait au sortir de la guerre, c'est de reconnaître la partie constituante que représentent les travailleurs et de dire ça suffit pas à peser sur les enjeux de gestion, ça suffit pas. Il faut mettre les travailleurs, leurs représentants au niveau du gouvernement, de l’entreprise. Donc toute notre discussion, là, ça existe dans certains pays. l'Allemagne est le pays qui a développé le plus fortement.
Des membres du conseil d'administration sont des représentants des travailleurs, comme vous l'avez dit. Pourquoi ça s'est fait en Allemagne? C'est très intéressant parce qu'évidemment, c'est un contexte historique très particulier. D'abord, c'est les alliés qui ont imposé ça à l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'on allait mettre les syndicats, les représentants des travailleurs dans les conseils immigration.
Ils allaient en fait mettre des bâtons dans les roues chez les industriels allemands et les empêcher de reprendre. Si vous voulez de la vigueur économique, c'était d'abord vraiment une mesure punitive. Ensuite, il y avait aussi la conscience que le communisme étant si puissant au juste, aux portes évidemment, ou dans la moitié même de l'Allemagne il fallait donner des gages à ces organisations syndicales. Et donc, si on pouvait faire d'une pierre deux coups, c'était absolument un plan magnifique.
Ce qu'il faut voir, c'est que ce plan là n'a pas du tout évidemment, ne s'est pas tourné comme l'avait imaginé les Alliés. C'est surtout les Britanniques qui ont été vraiment à la manœuvre ici. Ça n'a pas tourné comme ils avaient espéré parce que c'est ce qui a permis aux Allemands de développer le tissu industriel qui a fait l'envie de l'Europe.
Parce qu'en fait, qu'est ce que qu'est ce que ça a permis si vous voulez mettre les travailleurs le représentant au niveau des gouvernements d'entreprise?
Ça a permis d'ancrer le capital dans ces investissements, c'est à dire que. Il est beaucoup plus difficile, effectivement, de sortir comme on veut de ces investissements quand on est dans des entreprises où il y a des compromis à trouver avec les représentants des travailleurs.
Et donc. L'histoire montre aussi et il y a un apprentissage très important qui est à faire là. C'est que ce n'est pas une folie si vous voulez un peu romantique comme ça, de se dire tiens, on va transformer le gouvernement des entreprises.
Non, c'est une démonstration que fait l’Allemagne du sérieux et de l'intérêt d'impliquer les travailleurs et leurs représentants dans le gouvernement des entreprises.
Mais si je peux préciser, parce que je disais, il y a en même temps une différence importante avec le bicamérisme économique, c'est évidemment que le modèle allemand, c'est un modèle, qui est monocaméral où on a 50/50. Et où, en plus, le président du conseil, il est choisi par le banc des actionnaires.
Et donc, il y a toujours une majorité du côté des apporteurs de capitaux. Avec le président, et ça, évidemment, c'est une tout autre proposition que la proposition issue de l'histoire bicamérale qui, elle, est une formule à double majorité où les 50. Si vous voulez de la détermination allemande, il faut réussir à en convaincre 25 plus 1. C'est à dire, il faut une majorité au sein de ce collège de votants là pour emporter la décision, donc c'est une contrainte beaucoup plus forte et ça donne évidemment aux travailleurs la garantie que leur manière de voir le projet de l'entreprise va être pris sérieusement en considération.
Alors que le modèle allemand, certaines traditions syndicales ont considéré que c'était une sorte de piège de participes sur le modèle participation piège à cons., si vous me passer l’expression.
MUSIQUE
Louise Hemmerlé : En mai 2020, vous avez publié une tribune qui prône justement la démocratisation du travail. Et elle a été signée par plus de 3000 chercheuses et chercheurs et en octobre. Un livre qui a été publié aux Éditions du Seuil. Le manifeste Travail démocratiser, dépolluer, démarchandiser sous votre direction et celle de Julie Batilaana et de Dominique Méda. En quoi est ce que vous diriez que le contexte actuel, que ce soit la pandémie du coronavirus ou la crise écologique, a amplifié votre réflexion selon laquelle les travailleurs ne doivent pas être réduits à des marchandises et qu'il est nécessaire de démocratiser le travail?
Isabelle Ferreras : Alors, il y a tellement de choses qui se sont passées ici dans cette pandémie qui ne font que renforcer, si vous voulez cette compréhension, donc, pour n'en citer que quelques dimensions.
D'abord, il est évident que si nos sociétés ont tenu, si nous avons pu aller même nous alimenter dans les villes et donc faire nos courses au supermarché, c'est parce qu'il y a des travailleurs qui ont bravé leur peur pour aller travailler. Il y a des gens qu'ils ont conduits dans les bus.
Tout ça, c'est cet investissement en travail colossal qui a été produit par quantité de personnes qui ont été au service des autres humains et donc envisager de continuer à fonctionner dans une société qui ne prendrait pas acte du fait que les travailleurs ne sont pas des marchandises. Mais sont ces investisseurs en travail qui ont toute légitimité à peser sur les finalités de leur travail.
C'est une sorte de folie, surtout que nous savons que cette crise du Covid, c'est cette crise qui, par rapport à la crise du dérèglement climatique, qui arrive et qui est déjà là.
C'était un petit épisode. Il faut nous préparer à être beaucoup plus résilient et nous savons que les organisations résilientes, ce sont celles qui prendront vraiment leurs travailleurs au sérieux et qui vont les reconnaître comme des citoyens dans l'aventure politique, économique, si vous voulez, et donc aujourd'hui, je pense que nos convictions de ces trois chercheurs. Vous l’avez dit et depuis lors, il y a plusieurs milliers d'autres chercheurs qui ont signé ce manifeste travail ne sont que renforcé parce qu'il nous faut des démarchant, disait le travail.
Effectivement, c'est à dire sortir d'une perspective où le travail est cette marchandise gouvernée par un marché du travail, non c'est pour cela que nous plaidons pour une garantie d'emploi pour tous.
Le travail ne peut pas être soumis à un despotisme dans l'entreprise et donc il faut faire des travailleurs, des citoyens au travail, avancer le périmètre de la démocratie. Effectivement, jusque dans l'entreprise et parce que ça va nous permettre aussi de nous affronter à ce problème de nécessité de prendre soin de la planète.
Et là, je peux, si je peux expliquer ici, le lien qui est absolument crucial, c'est qu'il faut comprendre que tant que nous gardons des entreprises qui sont aux mains de ceux qui apportent du capital, on a un design institutionnel si vous voulez, qui produit un résultat qui est recherché par ce design, c'est à dire un qui produit le résultat que ces entreprises ne vont que se préoccuper du retour sur investissement de ceux qui ont importé du capital.
C'est fait pour ça. Donc, il faut changer le design. Il faut changer l'architecture de pouvoir parce qu'aujourd'hui, les ingénieurs nous disent que septante trois, 73% de la consommation d'énergie mondiale pourraient être économisée si nous mettions en place des ajustements de nos processus productifs et ces ajustements des processus productifs. Les ingénieurs disent que ce sont tous des ajustements qui ne présuppose pas de nouvelles avancées technologiques. Nous possédons la technologie nécessaire. Simplement c’est le Labor Intensive, si ça va demander beaucoup plus de travail humain.
Et que faisons nous? Nous laissons donc l'architecture de pouvoir de l'entreprise aux mains de ceux qui ne vont évidemment pas vouloir embaucher plus de travailleurs, mais préféreront évidemment, surtout dans une époque de coûts énergétiques faibles et bien, continuer à consommer de l'énergie et en même temps, nous laissons le travail dans les mains d'un marché du travail plutôt que de créer les postes d'emploi nécessaires pour faire face à la prise de soin de la planète. Là, nous faisons fausse route dans la manière dont notre design institutionnel est pensé, si nous voulons nous mettre en capacité de faire face à ce dérèglement climatique.
Louise Hemmerlé : Je vous propose que les quelques questions de nos auditeurs qui nous ont écrit. La première, c'est ce que vous pensez qu'il est possible de sortir de notre système de travail actuel et instaurer un système où les individus ne seraient pas en reste à cent pour cent dans ce travail. Ou faut il au contraire trouver un moyen de leur donner envie de s'investir et co-construire leur lieu de travail?
Isabelle Ferreras : Cette question soulève un enjeu important où souvent j'entends que je suis un peu mal comprise et tous ceux et celles qui travaillent sur le travail, d’ailleurs. Souvent on croit que parce qu'on travaille sur le travail, on pense qu'il faudrait qu'on ait des sortes de travaillistes fous qui pensons que la vie, c'est travailler, donc à la fois. Je suis très marxiste, au sens où la pensée de Marx sur le travail m'inspire beaucoup, c'est à dire sa pensée, sa philosophie du travail, la compréhension que le travail, c'est en fait l'expérience de l’humain.
Si vous voulez que dans le travail, j'exprime ma plus profonde existence, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est ma manière de comprendre le travail, l'expérience du travail que je suis pour une emprise totale du travail dans la vie sociale et au contraire. Effectivement, je pense qu'il faut réduire l'emprise du travail dans la vie sociale, qu'il faut par exemple réduire le temps de travail. Evidemment, c'est un des programmes fondamentaux pour réduire la marchandisation du travail.
C'est évidemment de passer par la réduction du temps que nous consacrons au travail pour pouvoir mieux le partager en particulier. Donc, oui, il faut réduire l'emprise du travail, donc l'investissement doit pouvoir être important. Je dirais ne certainement jamais total et certainement que les humains doivent pouvoir avoir une capacité à s'investir dans toutes les sphères de la vie. Comme Dominique Médat, avec qui nous signons le manifeste travail, l'a beaucoup mis en évidence.
Louise Hemmerlé : Une autre question, c’est y a-t-il pas une différence entre motiver les travailleurs et les travailleuses et faire en sorte d'augmenter leur rentabilité? Je pense que là, ça fait référence aux techniques de management dont vous avez parlé qui, justement, cherche à tout prix à motiver les travailleurs pour devenir encore plus productifs, mais qui cherche à les motiver en les impliquant uniquement dans la gestion de l'entreprise?
Isabelle Ferreras : Absolument. Oui et en soi, de nouveau aussi, on comprend que le travail, c'est un enjeu de citoyenneté. Alors on comprend que le travail, ça ne peut pas être un enjeu d'instrumentalisation et donc la motivation même l'idée qu'on ne chercherait à motiver, ça doit faire l'objet d'une vraie réflexion. On est pas en train ici d'imaginer des techniques managériales pour en fait, mieux motiver les gens pour produire une rentabilité pour autrui.
Non, la réflexion à laquelle je me place est de justement reconnaître que la personne est légitime pour peser sur ce à quoi elle va se consacrer et comment et à quel rythme.
Et il y a certainement des exigences de rentabilité qui sont complètement déplacées et tout ça doit faire partie du périmètre sur lequel la personne va pouvoir se positionner.
Louise Hemmerlé : Et dans un monde où règnent les burn out. Est ce que vous en désormais? Est ce que ce n'est pas dangereux d'impliquer encore davantage les travailleurs dans j’imagine du coup également le gouvernement de l'entreprise?
Isabelle Ferreras : Alors, je pense. Moi, mon analyse du burn out, c'est justement qu'il y a une tension énorme entre ce que vivent les gens, leurs attentes au travail. Quand vous regardez qui tombe en burn out, c'est souvent des gens qui sont extrêmement perfectionnistes, très impliqués dans leur travail, dans les finalités qu'ils servent et qui se trouvent un jour dans une situation où ils n'en peuvent plus de vivre, dans cette cette tension entre leur propre vision de ce que doit être un service bien rendu à un travail bien fait.
Et puis les contraintes organisationnelles qui leur pèsent dessus et sur lequel ils n'ont pas la possibilité de peser.
Et donc, justement, le burn out. C'est vraiment le témoignage du fait que, quand on implique les gens dans leur travail, mais sans leur donner du pouvoir de peser sur les conditions, mais vous m'avez entendu les conditions politiques de leur travail, alors c'est évidemment un marché de dupes et c'est hyper dangereux. Je suis tout à fait d'accord. Je signe des deux mains.
L'enjeu, c'est justement de ne pas. Plutôt que de basculer dans « oui, mais alors, si le travail est si dangereux, arrêtons tout et abandonnons le travail », ce qui est parfois un réflexe dans une pensée même qui se veut progressiste en disant « on va réduire le plus possible le travail et finalement, n'y pensons pas au travail. C'est tellement horrible. C'est le lieu de l'aliénation. Et occupons nous de tout ce qui peut se faire en dehors du travail. » Bon, très bien. Je n'ai pas de jugement sur tout ce qui peut se faire en dehors du travail, mais je pense que c'est absolument impératif et une responsabilité et des intellectuels et des partis politiques de gauche et des syndicats d'avoir une réflexion positive, constructive sur le travail pour se demander à quelles conditions le travail peut être une expérience d'émancipation qui va rencontrer cette attente de justice démocratique aussi dans le cadre du travail.
Louise Hemmerlé : Merci beaucoup, Isabelle Ferreras
Isabelle Ferreras : Merci beaucoup à vous, Louise.
Camille Maestracci : Vous venez d'écouter un épisode de travail en cours qui a été enregistré en direct sur la scène du Bruxelles Podcast Festival. Louise Hemmerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique de Jean Thévenin et le mix a été faite par Olivier Bodin, Marion Girard et responsable de production, et Maureen Willson, responsable éditorial. Mélissa Bounoua est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud.
Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Emotions le club Injustices. Passage à bientôt.