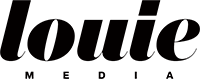Retranscription - Culpabilité: y a-t-il une bonne dose avec laquelle on peut vivre ?
Adèle Salmon : Il y a un an et demi, j’ai perdu ma grand-mère. Elle avait 92 ans, moi 33, et tout à coup, elle n’était plus là. Bien sûr, je m’attendais à son décès, j’ai même tenté de m’y préparer. Je redoutais tellement ce moment que j’avais enregistré tout un tas de souvenirs avec elle, pour capturer sa voix et la garder jalousement avec moi. Pendant plus de 30 ans, on a beaucoup discuté avec Claudine, c’était son prénom... On discutait de tout et de rien, et puis parfois, de choses plus graves. Ensemble, on parlait de ses souvenirs de petite fille au Mans pendant l’Occupation, des tablettes de chocolat dont elle était privée, et de sa mère, qu’elle qualifiait de « soupe au lait »…
Pendant tous nos entretiens, je ne l’ai vue pleurer que deux fois, lorsqu’elle évoquait son père, mort en déportation en Allemagne, en octobre 1944. Il avait été dénoncé pour ses activités de résistant. Claudine avait alors 16 ans.
J’avais très rarement accès aux émotions de ma grand-mère, qui gardait beaucoup de choses pour elle…Et puis un jour de juillet 2019, elle a craqué…Elle était en train de me parler du moment où son père avait été mobilisé une première fois en 1938…A l’époque, Hitler avait décidé d’annexer les Sudètes, une région de Tchécoslovaquie. Cette nouvelle conquête territoriale était en fait une provocation de plus envers la France et le Royaume-Uni...En tant que capitaine de réserve, le père de Claudine avait été prévenu dans la nuit. Il devait partir rejoindre le front le lendemain au petit matin…
Claudine : Moi je m’étais pas réveillée, je devais avoir 9-10 ans, et je dormais, tout le monde était..tout le monde…Yvonne était réveillée, parce que c’était mon père qui allait partir, il avait son ordre de départ et tout...Et quand même, il a voulu me dire au revoir…(voix qui tremblote)…et on s’est mis à pleurer (pleure). (Soupire) Je le vois encore dans son uniforme (rire/pleurs) ...on était réveillés comme ça, et il me dit : « je m’en vais tu sais »…Et on s’est mis à pleurer tous les deux.
Adèle : « Ah bah voila ! » (rire des deux).
Adèle : Face à elle, je suis bouleversée par cette tristesse qui surgit encore, 81 ans après les faits…Sans en avoir conscience, comme si je suivais sa chorégraphie à elle, je passe du rire aux larmes...
Ce jour-là, j’ai réalisé que grâce à l’expression de ses émotions, ma grand-mère me donnait un accès à sa mémoire. Une bribe de ce passé lointain que je ne connaîtrai jamais. En réécoutant nos échanges, je me suis demandée ce qu’il se passait précisément entre elle et moi, à ce moment-là…Si je ressentais aussi fort sa tristesse, qu’elle se transformait chez moi en colère, était-ce parce que je prenais cette histoire trop à cœur ? Peut-être que j’étais trop sensible, et que cela s’expliquait par l’amour que je portais à Claudine. Ou bien est-ce que vraiment, les émotions de nos parents ou de nos grands-parents ont ce pouvoir incroyable de nous transporter dans le temps, au point de nous faire ressentir des événements que nous n’avons pas vécus directement ?
J’ai voulu savoir comment les émotions se transmettent entre les générations. Pour mieux comprendre cette chaîne de transmission émotionnelle, je me suis intéressée au traumatisme personnel mais aussi collectif… Celui qui laisse des traces indélébiles, des trous béants et des mémoires souvent blessées... Comment vivre en ayant subi un choc traumatique ? Et lorsque l’on devient parent à son tour, comment parler de notre histoire à son enfant, sans lui transmettre le traumatisme qui va avec ?
Je suis allée à Toulouse pour rencontrer Jeanne. Son histoire se compose de traumatismes incommensurables, et je me dis que son témoignage pourrait m’éclairer. Elle m’a accueillie chez elle, un samedi matin...
(Sonnerie interphone)
Jeanne : Oui ?
Adèle : Oui c’est Adèle
Jeanne : Oui c’est au 7ème ? A tout de suite !
Adèle : Jeanne a 43 ans. Elle est infirmière.Elle est née à Kigali, la capitale du Rwanda, en 1977.
Jeanne : Je suis née dans une famille de cinq enfants. J'étais la dernière de la famille, j'avais un grand frère et trois sœurs. Nous avons grandi à Kigali dans un climat familial très doux, c’était gai, les parents étaient commerçants. Ils avaient un petit commerce à Kicukiro, un quartier à Kigali. Moi j'étais contente d'être la dernière parce qu'il y avait toujours un peu d'animation à la maison parce que évidemment les sœurs sont bienveillantes avec la petite dernière…
C’était vraiment une enfance joyeuse et la seule chose que les parents demandaient, c'était de bien travailler à l’école. Ça, je sais que depuis que je suis petite, c'était « On s'occupe du reste. Mais vous travaillez bien à l'école ». Ça c’était pas négociable.
Adèle : Jeanne entre à l’école primaire à l’âge de 7 ans…Le jour de la rentrée, son maître d’école demande à ses élèves de se ranger en fonction de leur appartenance à l’ethnie hutu ou l’ethnie tutsi. Ce sont les deux principaux groupes ethniques du pays. A l’époque, Jeanne n’a jamais entendu ces mots, elle ne sait pas où aller, alors elle reste assise.
Jeanne : Il vient me voir, il me dit « Tu sais pas? », je dis non, je ne sais pas. Et il me dit : « Quand tu arrives chez toi, pose la question à tes parents, et le lendemain, tu rapportes la réponse ». Très bien. J'arrive à la maison le soir et la première chose que...je pose la question à ma mère : il faut que je sache si je suis hutu ou tutsi. Et en fait là déjà, dans l'attitude de ma mère, je comprends qu'il y a quelque chose d'assez bizarre, mais je n'arrive pas à savoir quoi parce que je vois que cette question n'est pas naturelle. Je vois dans son regard qu'il y a quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi elle change d’attitude.
Elle me dit comme ça, sur le bout des lèvres : « s’il te repose la question, tu lui dis que tu ne sais pas ». Alors là, je me dis « y’a quelque chose ». Je ne vois pas pourquoi moi je dois dire que je ne sais pas qui je suis, alors que tous les autres se sont levés spontanément en disant « Je suis hutu »...Y avait rien de mal à le dire et pourquoi, moi, je dois le cacher donc je comprends que moi je dois cacher quelque chose.
Donc bon, je l’écoute, je dis à l’instituteur « non je sais pas », il relève pas. Rapidement, je comprends quand même que je suis tutsi et je me dis : C’est injuste. C'est injuste, je grandis du coup avec ce sentiment d'injustice où je vais devoir camoufler qui je suis, évoluer dans une ambiance où voilà, si à chaque fois que je peux éviter de dire qui je suis, il faudra que je le fasse et effectivement, je comprends de moi même que le climat à l'extérieur de la maison, dans le pays, est hostile aux Tutsis donc spontanément, je ne vais pas chercher à me dévoiler si c'est pas utile.
Adèle : Dans les années 90, Jeanne a une dizaine d’années. Le pouvoir en place, composé de Hutus, discrimine de plus en plus la communauté Tutsi, qu’il considère comme inférieure, fourbe et dangereuse pour le pays. Depuis les années 60, de nombreux massacres de masse ont déjà été perpétrés contre les Tutsis par les Hutus. A tel point que des milliers d’exilés Tutsis ont fui dans les pays alentours…Le Front Patriotique Rwandais, le FPR, lutte depuis des années pour les réintégrer au Rwanda…C’est dans ce contexte de guerre civile que grandit Jeanne. Sa mère est rackettée dans la rue, son père est emprisonné sans raison pendant une semaine et un camarade de classe la traite de « serpent qu’il va faire rentrer dans son trou ». Malgré ce déferlement de haine, Jeanne ne se sent pas dévalorisée :
Jeanne : je me sens pas moins bien qu’eux, mon estime à moi même n’est pas touchée mais parce que j'ai été élevée aussi par des parents qui nous ont toujours valorisés. Ils nous ont donné une estime de soi en nous-mêmes, qui fait que peut importe ce que l’autre peut nous dire, nous traiter de cancrelat, nous rabaisser, peu importe cette injustice que j’ai accumulée, qu’ils ont accumulée, que je voyais dans leurs yeux…au fond,on savait qu’il y avait ce qu’on nous disait, ce qu’on voulait qu’on soit, et ce que nous étions vraiment, c’est-à-dire qu’on est des êtres humains à part égale et que nul, en face, ne peut déterminer qui tu es.
Adèle : En avril 1994, Jeanne est élève en internat dans une école, loin de chez ses parents. Elle a 16 ans et rentre au domicile familial pour passer les vacances de Pâques. Le soir du 6 avril, elle et sa famille apprennent que l’avion du président hutu Habyarimana a été abattu... Ils savent que les Tutsis vont être accusés de cet attentat et que dès lors, leur vie est en danger.
Quand Jeanne me raconte que son père, qui montait la garde devant leur maison, est tué d’une balle dans la tête, sa voix se casse. On leur dit que dans tout le pays, des barricades sont élevées et des listes de Tutsis à abattre sont constituées.
Avec ses frères et sœurs et sa mère, elle se réfugie dans une maison en construction, à côté du domicile familial. Mais au moment de fuir, Jeanne est séparée des membres de sa famille. Le jour, elle reste enfermée dans des cachettes, chez des voisines ou dans la nature. La nuit, elle tente de trouver d’autres abris. C’est le début d’une longue traque.
Pour échapper à la mort, Jeanne erre seule ou avec des jeunes de son âge, qu’elle croise sur la route…
Jeanne : Y’a pas de but en fait… je cherche à me cacher mais deux secondes après je me dit « Mais ça sert à rien en fait ? À quoi bon? À quoi bon, on va tous mourir ! » Enfin, c'était évident qu'on allait tous mourir et que le pays était quadrillé. Le quartier était gardé et quadrillé à 500 mètres près. Ça se jouait à 500 mètres près à chaque fois. On pouvait pas aller ailleurs.
Adèle : Jeanne réussit à rejoindre l’école technique de l’ETO, à Kigali, connue pour être gardée par les casques bleus, encore présents au Rwanda en avril 1994 pour assurer le maintien de la paix.Elle parvient à y rejoindre sa famille. Le 11 avril, une foule de 2000 personnes se cache dans cette école. Au départ, ces Tutsis étaient venus chercher la protection des casques bleus. Mais vers 13h, Jeanne réalise que ces derniers quittent l’école, ayant reçu l’ordre de partir, les abandonnant aux mains des miliciens hutus et des militaires rwandais. Avec d’autres Tutsis, Jeanne s’interpose et tente d’arrêter leurs camions en vain. Mais l'école n’est plus protégée...Les miliciens et militaires rwandais, qui encerclent l’école depuis des jours, y pénètrent sans obstacle. Ils regroupent les personnes présentes, les amènent à l'abri des regards et les attaquent…C’est là que les membres de la famille de Jeanne sont massacrés.
Jeanne : Je voyais que c’était une telle violence, comment mon cerveau ne pouvait pas accepter. J'ai fermé effectivement les yeux la plupart du temps, dès qu'ils ont commencé par exemple à jeter des grenades, j’ai gardé toute la journée les yeux fermés. Mais aussi, parce que c'était leur façon de faire la morte, tout simplement, ça a commencé par ça. Je ne regardais pas. Je suis restée allongée à plat ventre, les yeux fermés. Mais vraiment à attendre la mort mais je ne voulais pas avoir d’autres images traumatisantes. Je voulais pas, je voulais pas parce que c'était trop atroce. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas que dans cette foule je puisse voir ma mère. Je ne voulais pas voir ma sœur. Je ne voulais pas voir mes cousins, cousines, oncles...mes voisins et les amis de mes parents parce que tout mon monde était là, à cette école…Tous les gens que je connaissais étaient là et je ne voulais pas les voir comme ça. On est coupés des émotions, on n'a pas d’émotions, on ressent plus rien, on est comme des robots.
Adèle : Face à une telle violence, je me demande comment expliquer cette absence d’émotions.
Pour comprendre ce qui s’est joué dans l’esprit de Jeanne dans ces moments de violence inouïe, je me suis rendue au cabinet de Régine Waintrater, à Paris. Elle est psychanalyste, thérapeute familiale, et autrice du livre Sortir du génocide, témoigner pour réapprendre à vivre, paru en 2003. Pour elle, cette impossibilité de ressentir des émotions porte un nom…
Régine Waintrater : Ça s’appelle le gel psychique et c’est obligatoire pour survivre, c’est à dire que si la personne soumise à des violences extrêmes, ça peut être un viol aussi, un trauma, des violences comme dans le génocide..., ressentait les choses comme elle les ressent normalement, elle imploserait de l’intérieur ou elle deviendrait folle. Or là, tout son être est tendu vers la survie…Qu’est-ce qu’elle doit faire ? Comment elle doit courir ? Comment elle doit échapper ? Donc il y a ce qu’on appelle un clivage de survie. C’est à dire que toutes les émotions normales qu’on peut éprouver quand on voit une scène difficile, sont gelées, mais vraiment gelées, pour la survie psychique, parce que les émotions affaibliraient la personne, elle s’effondrerait donc il y a une espèce de gel absolu des émotions, ce qu’on appelle dans mon métier un clivage de survie pour ne pas imploser de l’intérieur...
On ne pense pas, on ne pense qu’une seconde à l’avance pour savoir ce que l’on doit faire, mais c’est tout : on ne pense ni à l’avant, ni à l’après, on ne pense pas à ses proches, on ne pense à rien de ce qui constitue notre monde affectif parce que sinon, on en meurt de l’intérieur. Or, si on ne survit pas psychiquement, on ne survit pas physiquement.
Adèle : Jeanne survit à la tuerie de l’école technique. Elle tente de s’éloigner du lieu du massacre, se cache dans un champ, mais elle est rattrapée par les miliciens quelques heures plus tard. Cette fois, ils mutilent Jeanne aux chevilles. Car dans l’imaginaire raciste des Hutus, basé sur des critères physiques et biologiques, les Tutsis seraient trop élancés et trop grands, par rapport à la taille moyenne des Hutus. Ce jour-là, Jeanne a les talons d’Achille sectionnés et reste encore des heures, inanimée.
Le lendemain matin, le 13 avril, elle est réveillée par des voix…Elle ouvre les yeux et s’aperçoit que des soldats du Front Patriotique Rwandais, composés d’exilés Tutsis, sont à son chevet. Elle est mise en lieu sûr dans un hôtel de Kigali. Gravement blessée et traumatisée, elle est prise en charge par une ONG. Le 4 juin 1994, elle est évacuée en France et s’installe quelques semaines plus tard à Toulouse.
Jeanne intègre alors une famille d’accueil près d’Albi. Elle poursuit ses études, apprend le français et se fait de nouveaux amis. C’est seulement quelques mois après qu’elle repense à ce qui lui est arrivé...Ses émotions, qui avaient été anéanties par son traumatisme, commencent alors à ressurgir...
Jeanne : J'arrive en France et je ressens de la révolte. Je pense que je commence à ressentir ce qui me révoltait au Rwanda enfin ce sentiment là revient, de révolte contre les injustices, mais quand je suis bien installée dans ma vie française, que je maîtrise les codes. Et c'est là où je me dis : c’était un crime contre l'humanité, j'avais vraiment pas envie de garder ça… Les gens doivent savoir ce qui s'est passé au Rwanda tellement…J’avais cette conscience en disant : c’est un crime contre l'humanité. On vient de rayer des gens de la surface de la Terre, innocents. Vous devez savoir et là, je savais déjà que plus jamais je me tairai plus. Le résultat, c'est que toutes ces années, on est resté au Rwanda à courber l'échine, à se taire, à tout accepter. Ça s'est terminé comme ça. Maintenant, je parlerai pour tous ces gens qui ont pas pu parler pendant des années avant, même après. Je parlerai , les gens ils sauront.
Adèle : Depuis son arrivée en France, Jeanne tente de se construire une nouvelle vie. Mais comme pour la plupart des rescapés de génocide, ses souvenirs traumatiques se rappellent à elle, parfois dans des situations qui semblent anodines.
Jeanne : Quelqu'un va me dire sa date de naissance et je vais me dire « ah bah tiens, il a le même âge que mon père. Voyons comment , est-ce qu'il serait comme mon père ? Alors que physiquement, ce n'est pas le même ! Et là du coup, je vais commencer à y penser. C’est des moments heureux, je sais pas, je vais passer, je vais faire mes courses, je passe devant la mairie , y’a un mariage et je vais voir tout ce monde et je vais me dire « C'est quand même incroyable, d’avoir autant de monde comme famille ! » (rire) C’est en permanence en fait…. tout le temps. 27 ans après, mes souvenirs sont restés intacts, je pense. Il y a des choses autour qui sont floues, mais j'ai une photographie exacte de ce que j'ai fait heure par heure du moment où j'ai quitté mon domicile du 6 avril jusqu'à ce que le FPR me sauve, par exemple, je peux dire heure par heure où j’étais, quel temps il faisait. Et ça, je pense que c'est une photographie et j’ai l’impression que ça ne bougera pas. J’ai l’impression que 27 ans après, c'est toujours la même.
Adèle : Selon la psychanalyste et thérapeute familiale Régine Waintrater, si les images mentales de Jeanne sont aussi précises encore aujourd’hui, c’est parce qu’il s’agit de souvenirs que notre mémoire ne peut pas transformer.
Régine Waintrater : Contrairement au mécanisme normal de la mémoire, qui est que nous avons des souvenirs puis nous les oublions ou nous les refoulons, nous les mettons dans un coin et qu’ils ressurgissent transformés...Les souvenirs traumatiques ne se transforment pas, ils restent là, alors soigneusement mis de côté dans l’antre de la mémoire , mais en même temps, quand ils ressurgissent, ils ressurgissent intacts, vivaces, avec la même lumière, les souvenirs traumatiques restent là comme si ça c’était passé hier !
Adèle : Au fil des années, Jeanne garde un lien très fort avec sa famille d’accueil. Une fois adulte, elle réalise que la maternité n’est ni une priorité, ni une évidence. Elle m’explique qu’elle a d’abord pris le temps d’être bien dans sa vie, d’aimer son métier, d’être heureuse en amour...
Aujourd’hui, Jeanne est la maman de deux petits garçons, âgés de 5 et 2 ans. J’ai voulu savoir ce qu’elle redoutait le plus dans la parentalité.
Jeanne : J'ai un peu éloigné le moment où je pouvais devenir mère parce que je suis devenue mère à 38 ans pour mon premier, mais parce que je me disais Mon Dieu, mais euh…Je me disais peut-être qu’il y aura des moments où je serai impuissante…Est ce qu'il y aura un autre moment aussi fou où un jour, je serai dans la situation de mes parents ou de ces familles, que j’ai vus, où on est totalement impuissant par rapport à son petit être et qui demande qui cherche juste le regard de son père ou de sa mère, qui cherche de l'aide et la protection et les yeux des parents qui sont si….(soupir), Je n'ai pas de mot, je ne sais pas les mots pour décrire des parents qui sont impuissants par rapport à l’aide à leurs enfants. Je me suis dit : j'en serais pas capable. C'est peut-être pas la peine de mettre au monde les enfants, si on ne peut pas vraiment assurer une protection certaine à tout moment. Et puis finalement, après, ça n'a pas été quelque chose non plus de obsédant. Et je laissais la vie faire et du coup, la vie, elle est ce qu'elle est, elle est belle aussi, enfin elle est belle.
Adèle : D’elle-même, Jeanne m’explique qu’elle s’est laissée portée par la vie, mais à travers ses mots, j’aperçois aussi toute la difficulté de mettre au monde un enfant après un génocide…En soi, d’après le projet génocidaire, la génération d’après n’aurait pas dû voir le jour….puisqu’aucun parent n’aurait dû survivre…Chaque survivant du génocide apparaît comme une anomalie, comme s’il y avait eu un bug dans la matrice meurtrière. C’est ce que me décrypte Régine Waintrater.
Régine Waintrater : Un génocide, c’est un projet d’éradication d’un groupe entier donc c’est un groupe qui vise l’extinction totale d’un groupe, c’est pas qu’on massacre les personnes qui sont là, et pas de chance pour elles, c’est qu’on massacre trois générations, celle du dessus, celle actuelle et celle qui est venue, et celle à venir puisqu’on massacre les femmes.
Avoir un enfant après un génocide, c’est une victoire, c’est une victoire sur le projet d’extinction, sur le projet d’éradication des génocidaires. Alors, refaire une famille, bien sûr que c’est se réinsérer dans la vie, et beaucoup l’ont fait avec coeur, succès, mais là encore, on ne peut pas ne pas imaginer que ce soit pas aussi un rappel aussi de ceux qui ne sont plus là. Donc, bien sûr que devenir parent, c’est rempli de toutes les craintes, de tous les traumatismes qu’on a vécus.
Adèle : Quand son fils est né il y 5 ans, Jeanne décide de ne pas trop intellectualiser la transmission de son histoire…D’abord parce qu’elle l’estime bien trop jeune pour comprendre son passé, et aussi parce qu’elle veille à ne pas lui faire porter ce poids. Alors, je lui ai demandé si pour elle, en tant que mère, une autre transmission ne pouvait pas s’opérer, à son insu...
Jeanne : Mon fils aîné qui a 5 ans et demi voit que j'ai des cicatrices au niveau des chevilles mais il ne m'a jamais posé la question. Or, une fois je discutais, j'étais au téléphone avec avec une journaliste, elle me posait des questions sur le génocide, sur mon vécu... Et donc, je parle effectivement que j'ai des cicatrices au niveau des chevilles. Et je vois mon fils aîné qui était pas loin et qui regarde mes chevilles. Et tout en jouant, en escaladant, en faisant tout autre chose, je n'avais pas l'impression qu’il suivait vraiment la conversation. Mais en fait, j'ai vu qu’il écoutait. Il ne m'a pas posé de question. Il a continué à jouer, à jouer avec ces petites voitures et je pense que ça aussi, c'est du non-verbal. Et je pense que les enfants grandissent avec ça et je mettrai les mots et j’attends aussi qu’il me pose des questions…Je ne vais pas arriver en me disant « j'ai vu que ». Mais voilà, c'est ça que j'appelle du non-verbal. Et je pense, tout ça fait que l’enfant grandit dans tout cela et je me dis je serai là pour donner des explications que je pourrais, mais c'est c'est cette histoire là qui aura de toute façon. Mon histoire c'est pas son histoire, mais quand même, il a perdu ses grand-parents, une partie de sa famille et c'est aussi un peu son histoire. Maintenant, j’essaie voilà, il n’y a pas...j’ai pas de recette encore (rire). On verra bien. On verra dans 30 ans.
En fait, je pense que le meilleur cadeau que je peux, je peux leur offrir, c'est laisser vivre…les laisser vivre. Qu’ils aient la vie la plus normale possible. Que ça ne soit pas non plus une espèce de chape de plomb qui, qui est là en permanence. Mais parce que moi, dans ma vie, c'est pas pas non plus ça. C'est que je suis profondément vivante, que je suis joyeuse et que, paradoxalement, j'ai gardé ma joie de vivre d’avant le génocide. Et j’espère que eux ils seront comme tout le monde en fait.
Adèle : Jeanne a fait le choix de parler de son histoire à ses fils, à la hauteur de ce qu’ils sont en mesure de comprendre à leur jeune âge et de respecter leur rythme.
D’après Régine Waintrater, quelle que soit la nature de la transmission du parent à l’enfant, le parent transmet. Même s’il ne pose pas de mots sur ce qu’il a vécu, il va donner à son enfant des informations sur son passé, par ses paroles, ses émotions ou les traces qu’il porte sur son corps. L’enfant intègre peu à peu ces morceaux d’histoire, il fait avec ce à quoi il a accès, ce qui est visible pour lui...
Mais qu’en est-il de ce qui est justement invisible ? Disposons-nous de ces informations avant même d’en être conscient ? Est-ce qu’avant notre conception et la rencontre avec nos parents, notre propre corps aurait hérité de leurs traumatismes ?
Je me suis souvenue d’une étude très sérieuse que j’avais lue dans la revue scientifique « Nature Genetics ». En 2013, des chercheurs américains de l’université d’Atlanta s’étaient demandé si un choc traumatique pouvait se transmettre sur plusieurs générations, par l’intermédiaire de nos gènes. Pour le savoir, ils avaient procédé à plusieurs expériences sur des souris mâles…Les chercheurs ont d’abord exposé ces souris à une odeur agréable, connue pour ne pas être crainte par ces animaux. Dans le même temps, ils leur ont donné un léger choc électrique, de façon à ce que les souris associent cette odeur à un état de stress, à une punition, et à une appréhension de cette punition… Ils ont ensuite réalisé que suite à cette exposition, le fonctionnement de certains gènes présents dans le cerveau des souris, avaient été modifiés. Leur code génétique était resté intact, mais leurs gènes fonctionnaient de façon différente et présentaient ce que l’on appelle « des marques épigénétiques »….J’ai voulu en savoir plus et j’ai demandé à Ariane Giacobino, médecin en génétique aux Hôpitaux Universitaires de Genève, de venir m’éclairer…
Ariane Giacobino : L’épigénétique, c'est un domaine qui considère les changements d'expression des gènes, c'est-à-dire de la manière dont ils fonctionnent ou de l'intensité avec laquelle ils fonctionnent, sans qu'il y ait de changement du code génétique, donc des lettres qui composent notre code génétique. L’épigénétique, on pourrait la comparer à l'interprétation d'une partition musicale par un orchestre. La partition avec les notes inscrites, ça serait le code génétique qui lui même est fixe et les modifications épigénétiques, c’est l'intensité avec laquelle chacun de nos 22 000 gènes, qui pourraient être chacun un instrument, va fonctionner avec des relations qui sont indépendantes les unes des autres. On pourrait avoir la trompette qui va fort et le piano qui va doucement. Donc, tout ça peut jouer de manière différente notre code génétique et changer au fil du temps.
Adèle : Les chercheurs américains ont ensuite utilisé des souris femelles, qui elles, n’avaient jamais subi de choc électrique. Ils ont procédé à des fécondations in vitro, avec les spermatozoïdes des mâles conditionnés à la peur. Ils ont ensuite étudié les souriceaux, issus de ces conceptions.
Ariane Giacobino : Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'ils se sont rendu compte en soumettant à cette odeur ces petits mâles, que les souriceaux qui n'avaient jamais reçu le choc électrique étaient extrêmement craintifs et beaucoup plus que les autres, quand ils sentaient cette odeur pourtant agréable. Alors, ce qui est très joli dans cette étude que je trouve admirable, c'est qu'ils ont pu écarter l'hypothèse de l'éducation ou de l'environnement des parents qui auraient quelque part transmis par leur comportement quelque chose aux souriceaux. Et c'est vraiment la preuve qu'un facteur de stress ambiant, un facteur qui, pour moi est plus psychologique, peut avoir un impact biologique qui est directement mesurable. Donc aussi, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a passé à travers les générations et qui a été tout à fait démontré.
Adèle : Ce que je retiens de cette étude, c’est que les chercheurs ont obtenu des résultats similaires pour les souriceaux de la seconde génération, mais aussi de la troisième…Si trois générations de souriceaux présentent le même type de marques épigénétiques, est-ce qu’il pourrait en être de même pour les humains ?
Dans le cadre de catastrophes collectives ou de génocide, certaines études ont été menées. En 2014, Ariane Giacobino a participé à une expérience inédite, proposée par des confrères rwandais. Il s’agissait d’étudier l’impact du génocide sur les femmes tutsis du Rwanda, ainsi que sur leurs enfants, qui étaient au moment du drame, in utero, c’est-à-dire, dans le ventre de leur mère. Ce groupe de personnes a été comparé à un autre groupe de femmes tutsies, non exposées au génocide, puisque résidant dans les pays alentour.
Ariane Giacobino : Les collègues au Rwanda ont recruté des femmes, 25 femmes exposées directement aux traumatismes, des femmes tutsi, et par comparaison, 25 femmes aussi Tutsi, mais qui n'avaient pas été exposées aux traumatismes, mais qui avaient le même mode de vie que leurs congénères exposées. Dans les 2 groupes, ces 25 femmes étaient enceintes au deuxième ou troisième trimestre au moment des événements au moment des évènements donc on a eu au total 50 femmes et 50 descendants c’est-à-dire enfants qui avaient au moment des analyses une vingtaine d’années, qui avaient au moment des évènements été exposés in utero et puis dont on avait le matériel génétique et le cortisol salivaire donc 50 et 50.
Adèle : Le rôle d’Ariane Giacobino dans cette étude, c’est d’analyser deux gènes en particulier, qui sécrètent tous les deux de la cortisol, l’hormone du stress, qui est responsable de l’état d’alerte ou du rythme cardiaque. Dans le même temps, l’épigénéticienne va prélever la salive des enfants de ces femmes tutsis. Les résultats sont édifiants : on retrouve les mêmes marques épigénétiques sur les mères traumatisées que sur leurs enfants...En revanche, les femmes et leurs enfants non exposés ne présentent pas de telles marques.
Ariane Giacobino : Cette étude, elle montre que déjà, avant la naissance, en fait, les fœtus sont vulnérables ou sont impactés par le stress de leur mère et ce qu'elles sont en train de vivre, même si c'est un choc émotionnel finalement, ce n'est pas une alimentation, ce n'est pas quelque chose de physique ou de toxiques, ou plutôt c'est quelque chose de mentalement toxique et qui va impacter leur fœtus. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des individus, dans plein de situations différentes qui peuvent, au moment de la naissance avoir déjà une vulnérabilité biologique qui les rendra plus fragiles par rapport à de nouveaux événements ou des stress ultérieurs. Et c'est comme ça aussi maintenant qu'on revisite d'une certaine manière un certain nombre de troubles anxieux, dépressifs ou de problèmes neuropsychiatriques en se disant mais finalement, peut être même qu'en naissant, on n'est pas égaux devant un même stress ou un même facteur psychologique qui peut nous impacter, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres.
Adèle : Les résultats de ces études me questionnent, et surtout, m'inquiètent un peu : on serait donc juste des entités pré-destinées par nos gènes, comme enchaînées à un déterminisme biologique qui nous échapperait...
Ariane Giacobino a insisté sur le fait que les marques épigénétiques, étaient par définition réversibles…C’est à dire que ce n’est par parce qu’on constate leur présence chez un individu, qu’elles vont forcément être la source de manifestations de maladies ou de troubles. D’après elle, d’autres facteurs peuvent venir atténuer cet héritage, comme un suivi psychologique. C’est d’ailleurs ce qui fait dire à Régine Waintrater que l’épigénétique et la psychanalyse peuvent même se compléter.
Régine Waintrater : Quand il y a eu des stress, ou des migrations, ou des tortures, il peut y avoir des taux d’anxiété qui ne sont pas seulement comme on l’expliquait, nous les psychanalystes, « bah évidemment si le père est anxieux et la mère est anxieuse, si y’a des cauchemars la nuit, bah vous comprenez bien que l’enfant…» oui, certes ! Y’a de ça. Mais vraisemblablement les médecins ou les généticiens ont trouvé des modifications, par exemple des histoires de famine et d’obésité, des gens qui auraient souffert de la famine à une ou deux générations d’avant, et les enfants qui deviennent obèses… Pour nous, c’est très intéressant, parce que ça ne vient pas du tout dire : « remballez vos divans, les psychanalystes », ça veut dire « dialoguez ». La psychanalyse peut étonner des épigénéticiens par certaines constatations après c’est expliqué…Et l’épigénétique peut nous faire penser des choses fabuleuses donc les deux sont complémentaires…
Adèle : Si je comprends bien, dans la transmission, les gènes ne font pas tout… Jusqu’à présent, j’ai vu qu’il était possible de recevoir un traumatisme de nos parents par le récit qu’on nous en fait, ou par les gènes dont on hérite. Mais je me suis demandée ce que ça faisait, concrètement, d’être élevé par une mère ou un père qui avait connu un tel choc...
C’est le cas de Danièle Laufèr, qui a grandi auprès d’une mère juive allemande, et survivante de la Shoah. Je la rencontre chez elle à Paris, pour qu’elle m’explique comment elle a vécu, et comment elle vit aujourd’hui, avec cet héritage.
Danièle Laufer : Voila, je vais vous présenter ma mère..la voilà…je vais vous montrer la photo que j’ai dans mon portefeuille.
Adèle : Ah oui, effectivement on voit bien sa mèche.
Danièle Laufer : Oui elle avait une mèche blanche, c’est marrant…Là elle est très souriante.
Adèle : Très jolie.
Danièle Laufer : Et ça c’est ma mère et moi quand j’étais bébé
Adèle : Née à Casablanca au Maroc en 1951, Danièle grandit avec ses parents et une petite sœur, dans un climat familial un peu étrange.
Danièle Laufer : Ma mère était une femme d’une très très grande élégance, toujours impeccablement coiffée, impeccablement maquillée, elle avait des escarpins, chaussures à talons hauts assortis à ses sacs. C’était très important pour elle, elle passait son temps à se regarder dans la glace, à ajuster ses tailleurs, elle maîtrisait son image. Ma mère était une femme assez rigide, assez maniaque, pas très chaleureuse. J’avais toujours l’impression que je disais ce qu’il fallait pas dire, que je faisais ce qu’il fallait pas faire , je me sentais toujours un peu sous surveillance. Il y avait une espèce de grande vigilance, j’étais jamais très très détendue en fait chez moi, je crois.
Adèle : Dès son enfance, Danièle est confrontée au manque d’attention de sa mère envers elle. Cela se traduit par exemple par des moments où tout à coup, sa mère part dans ses pensées, et son esprit s'échappe…
Danièle Laufer : Elle parlait toute seule, elle avait des moments où elle parlait toute seule, des moments où elle disparaissait complètement, c’est-à-dire qu’on était devant elle et tout à coup, et tout à coup son regard…On avait l’impression qu'il y a avait un mur de verre qui était tombé entre elle et nous, je dis nous parce que ma soeur a exactement le même souvenir, son esprit s’évadait, on avait l’impression qu’on était plus là, qu’on existait plus, et qu’on était devenues transparentes. Donc on s’en allait, on la laissait jusqu’à ce qu’elle nous rappelle.
Je me souviens qu’elle s’enfermait dans cette pièce qu’elle avait fait aménager en dressing enfin dans laquelle il y avait des placard avec des serviettes, les draps, ses affaires etc. Elle fermait la porte et elle parlait toute seule, elle parlait et on entendait son ton qui...( bruits d’onomatopée), on collait l’oreille contre la porte, pour essayer de comprendre.. « mais enfin, je ne suis pas celle que vous croyez »...ben oui ça nous faisait rire mais c’était sans doute un rire un peu nerveux, c’était...Mais les enfants ne remarquent pas ce qu’il y a d’anormal car voilà c’était notre mère, elle était comme ça, pour nous c’était pas tellement anormal, c’était drôle parce que c’était bizarre quoi, c’était vraiment bizarre en fait. Quand j’y pense maintenant ça me déchire le coeur de penser qu’on se moquait d’elle alors qu’elle était certainement déséquilibrée, mais je n’arrive pas à me résoudre à penser que ma mère était déséquilibrée, que ma mère était un peu cinglée quoi…alors que objectivement..oui c’est vrai, mais bon…y’avait de quoi ! Y’avait vraiment de quoi…
Adèle : Pendant son enfance et même une fois adulte, Danièle a été le témoin des souffrances psychologiques de sa mère. Elle en a été marquée personnellement. Mais c’est aussi la façon dont sa mère l’a traitée dans son enfance qui a forgé leur relation.
Danièle Laufer : Je me souviens que ma mère était assez violente par rapport à mon asthme. Quand j’étais petite et que j’avais des crises d’asthme, elle venait dans ma chambre et elle me disait « Rha, arrête cette comédie !! ». C’est mon père qui venait dans la chambre et qui se couchait par terre, qui dormait, parce qu’il sentait qu’il y avait quelque chose de…Enfin j’imagine que ça devait être extrêmement impressionnant, de voir une petite fille avec l’air qui soufflait, qui sifflait dans les poumons, et moi…je n’arrivais pas à respirer, c’est ça l’asthme, c’est terrifiant, on a l’impression qu’on va mourir…l’air ne passe pas. Quand j’étais malade, en tout cas, je sais que ça l’exaspérait, elle était exaspérée, sans doute parce qu’elle ne savait pas du tout comment réagir, peut être parce qu’elle réfrénait ses propos émotions, en tout cas, elle était pas là, elle était pas là pour me consoler et d’ailleurs je suis restée inconsolable. Et je le suis toujours, personne ne peut me consoler aujourd’hui (rire).
Pour la psychanalyste Régine Waintrater, le cas de Danièle montre que parfois, il est très difficile voire impossible pour un parent survivant, d’être confronté à la douleur et aux émotions de son enfant.
Régine Waintrater : Elle ne pouvait pas donner quelque chose qui lui avait manqué et elle n’arrivait pas être empathique. Et elle pensait en plus sûrement, que les souffrances de sa fille, quand elle lui disait « l’asthme, tout ça, arrête ton cinéma », étaient dérisoires par rapport à ce qu’elle avait vécu. Elle n’arrivait pas à s’approcher psychiquement et à être empathique. Y’avait quelque chose qui était abîmé, complètement abîmé, et qu’elle n’a pu récupérer. Je suis sûre que les survivants, ce qu’ils avaient comme idée c’est qu’un jour, on peut leur enlever leur enfant. Donc si on se tient à distance, et bien on sera moins attaché, c’est terrible ce que je dis, si on est moins attaché, peut être qu’on va moins souffrir quand on va nous les enlever. Alors je vous dis pas qu’ils se disaient ça consciemment, mais c’est quand même ça. C’est pas l’identité de quelqu'un d’être un génocidé. Maintenant, comment elle aurait été sans ça ? Je n’en sais rien et nous n’en savons rien mais sa capacité maternelle, sa capacité de communication, sa capacité d’empathie, visiblement étaient entamées.
Danièle Laufer : Les émotions de ma mère, c’était par exemple quand elle pleurait parce qu’elle voyait un petit chat qui miaulait dans la rue , alors tout à coup elle était absolument dans un état de tristesse profond, affectée, un petit chat qui miaulait parce qu’il avait faim, ça , ça l’atteignait, sa fille qui pleurait ou qui avait une crise d’asthme, ou qui avait un gros chagrin, ça non, elle pouvait pas...
Adèle : Malgré le manque d’empathie de sa mère envers elle, Danièle n’avait pas l’impression que celle-ci ne ressentait rien.
Danièle Laufer : J’ai toujours imaginé ce qu’elle pouvait ressentir, mais je ne suis pas sûre que ce que j’ai imaginé correspondait à ce qu’elle ressentait vraiment. Comme on en a jamais parlé parce qu’elle ne se livrait pas du tout, et d’ailleurs je ne suis pas sûre qu’elle savait ce qu’elle ressentait. Elle tenait tout ça tellement à distance pour ne pas souffrir, elle avait tellement souffert dans sa vie, qu’elle avait érigé un mur de béton autour d’elle , une enceinte, une armure, on pouvait pas accéder à ce qu’il y avait à l’intérieur…
Adèle : Régine Waintrater, qui a beaucoup travaillé sur les liens qui unissent le parent survivant et son enfant, m’explique que tous les cas de figure existent : des parents qui n'expriment pas ou peu d’émotions, d’autres qui sont trop présents et trop couvants, certains qui sont parvenus à ne pas être dans l’excès. Dans le cas de la mère de Danièle, la psychanalyste parle de la pathologie de “l’alexithymie”.
Régine Waintrater : Dans le registre des émotions, beaucoup de personnes qui ont passé ou la tortue ou les génocides, c’est-à-dire où il y a torture et des tortures mentales et psychiques demeurent ce que l’on appelle dans notre jargon « alexithymique », ça veut dire qu’ils ne sont pas pas capables de nommer et de ressentir des émotions mais ils les expriment souvent par le corps. C’est à dire qu’on voit beaucoup de manifestations psychosomatiques chez des survivants...Ils ne peuvent pas dire « je suis triste », « je suis en colère », c'est-à-dire identifier leurs affects. Moi je les appelle les « aveugles des émotions ». Donc souvent, y’a des comportements qui se montrent, sans que la personne elle-même puisse être consciente et nommer et reconnaître en elle un affect. Non, y’a une espèce de gel qui s’est étendu sur leurs émotions et ça donne de l’alexithymie, et vraisemblablement, la mère de Danièle était sûrement en partie alexithymique.
Adèle : Danièle a donc dû vivre avec cette affection maternelle en dents de scie et ces émotions décalées. Une fois adulte, ces rapports difficiles et parfois conflictuels ont persévéré. Ce qui m’impressionne chez elle, c’est sa capacité à prendre en compte l’histoire de sa mère dans sa propre histoire, tout en prenant beaucoup de recul. Elle m’a raconté une anecdote qui a compté dans sa relation avec sa mère. C’était un jour de 1983. Danièle avait invité sa mère au cinéma pour voir “Le Choix de Sophie”. Ce film raconte le parcours d’une femme polonaise qui arrive dans un camp de concentration avec ses deux enfants, et à qui on demande de choisir l’enfant qu’elle va garder, l’autre sera envoyé dans les chambres à gaz. Pendant la séance, la mère de Danièle ne cesse de lui répéter que le film est très réaliste et qu’il ressemble à ce qu’elle a vécu...En sortant du cinéma, Danièle est en larmes... Sa mère ne comprend pas sa tristesse et lui demande pourquoi elle pleure.
Danièle Laufer : Et alors là, j’ai compris un truc : elle, elle trouvait que c’était incroyablement bien fait, c’était le reflet de ce qu’elle avait vécu, elle avait passé des mois dans les camps, elle en était sortie , elle était plus dans cette histoire, elle était dans la vie d’après. Mais moi, moi je n’y étais jamais allée, je n’y suis jamais allée, et je n’irai jamais, et donc, j’en sortirai jamais…parce que pour moi, c’est des cauchemars, des fantômes, des angoisses, c’est quelque chose qui s’est emparée de moi, qui est rentré dans ma vie, qui s’est infiltré dans mon sommeil, qui a rôdé autour de moi, qui est là en permanence. Alors évidemment je ne pense pas qu’à ça tout le temps non plus , mais qui a fait de moi pendant des années une personne hyper angoissée, qui avait l’impression que j’arriverai jamais à rien, que je pourrais jamais rien réussir, que je méritais pas de vivre, que je méritais pas d’être heureuse…enfin bon…une espèce de,de...j’allais dire de survivante, aussi , c’est terrible de dire ça, parce que je ne suis pas du tout une survivante, mais je suis une fille de survivante et donc j’ai intériorisée mais sans m’en rendre compte, les choses que ma mère a dû vivre. Il y a quelque chose qui est passé et qui s’est infiltré et qui m’a collé à l’âme, au cœur, au cerveau... quelque chose dont il est impossible de sortir en fait.
Adèle : Puisque Danièle n’avait pas directement vécu l’horreur des camps de la mort, il lui était plus difficile de se débarrasser des images et des sensations qui la traversaient. Par définition, ce processus du fantasme ne connaît pas de fin, car il peut se réinventer constamment. A l’inverse de sa mère, pour qui les camps étaient une réalité vécue et révolue, avec un début et une fin.
Danièle Laufer : Je devais avoir 29 ans, 27 ans, je sais pas, je vais dans un hammam, pour la première fois de ma vie, je rentre dans cette pièce ou y’a une fumée, on voit rien, j’aperçois des corps nus, je suis prise d’une angoisse mais absolument monstrueuse, je suis sortie au pas de course, j’avais le coeur qui cognait, j’étais hyper angoissée, j’ai mis très longtemps à comprendre qu’en fait, j’avais eu la sensation d’être dans une chambre à gaz. Quand on y pense, un petit hammam fermé bah les chambres à gaz ça devait être ça, les corps nus, alors évidemment, y’avait pas une surpopulation mais voilà....c’est ça le fantasme. Bon maintenant je retourne au hammam, ça me fait plus du tout ça, j’y prends beaucoup de plaisir, mais la première fois...Il faut le temps de comprendre quand même, de comprendre ce qui se passe...
Adèle : Comment vous l’avez compris ?
Danièle Laufer : Comment je l’ai compris ? je ne sais pas ! un beau jour, ça m’a paru clair, peut-être que j’ai travaillé ça pendant mon analyse, honnêtement, j’en sais rien, vous savez ce chemin de l’analyse et du travail qu’on fait sur soi, il y a des choses qu’on dit, on les sait, on les comprend, on les explique doctement à l’analyste, aux amis, et puis un beau jour tout à coup, hop, ça rentre, et tout à coup, c’est comme si c’était incorporé, plus besoin d’expliquer, on l’a vécu, on l’a ressenti, on l’a revécu...Les mots sont un peu impuissants pour décrire cet espèce de travail qui fait qu’un beau jour, il y a une espèce d’évidence, et on se rend compte qu’on a tourné autour, qu’on a répété, qu’on a dit les choses mais que POF, ça a avait pas pris son sens quoi.
Adèle : Aujourd’hui, Danièle est toujours asthmatique, claustrophobe et doit faire face à des problèmes pulmonaires. Mais avec le temps, elle a su s’approprier des outils pour vivre avec ces fragilités physiques et psychiques, notamment, grâce à la relation qu’elle entretient avec ses émotions.
Danièle s’est appropriée l’histoire de sa mère, et a construit sa propre vie. Elle a été journaliste et écrivaine, elle est devenue mère à son tour. Au début de l’année 2021, elle a publié un livre, intitulé Venir Après ou elle a rassemblé une vingtaine de témoignages de personnes de sa génération, élevées par des parents survivants de la Shoah. Pour elle, l’écriture de ce livre lui a permis de regarder son histoire à la lumière de celle des autres, en constatant que son cas n'était pas isolé.
Pour mettre des mots, trouver du sens à ce qu’elle avait vécu en tant qu’enfant, mais aussi en tant qu’individu, Danièle a eu recours à la psychanalyse. Pour se construire, elle a appris avec le temps à vivre avec ses émotions...
Danièle Laufer :
Je pense que je suis exactement l’inverse de ma mère, c'est-à-dire que je pense que j’ai un très grand plaisir de vivre. Alors après c’est vrai, je suis excessive, quand je vais mal, je suis au fond du trou, quand je vais bien, je suis la plus heureuse des personnes, moi mes émotions, c’est ce qui me fait vivre. Alors c’est vrai que je m’épuise, mes émotions m’épuisent, je me fatigue toute seule, Je suis capable de rester un truc pendant longtemps mais en même temps, j’ai l’impression d’être vivante, c’est ce qui me rend vivante, c’est de ressentir tout ca.
Adèle : En réalisant cet épisode, j’ai compris qu’on pouvait réellement souffrir de blessures infligées aux générations qui nous ont précédés. J’ai aussi compris que même dans le cadre très particulier du génocide, on pouvait non pas s’en défaire, mais au moins, apprendre à vivre avec les émotions qui lui sont liées. De même qu’un descendant de survivant, n’est pas forcément voué à souffrir advitam du traumatisme de son parent…Il va peu à peu intégrer les informations auxquelles il a accès et se construire avec ce qu’on lui donne.
Ces éléments vont venir constituer sa propre mémoire, une sorte de mémoire “indirecte”....La chercheuse et enseignante américaine Marianne Hirsch a élaboré dans les années 90 le concept de “post-mémoire”. Il qualifie la relation que la “génération d’après” entretient avec le traumatisme subi par ceux qui l’ont précédée..Selon elle, cette post-mémoire a été transmise avec tellement d’émotions aux descendants que les expériences des parents semblent être devenues ce qui constitue la mémoire des enfants, basée sur des récits, des images et des comportements. Ces derniers se souviennent littéralement de choses qu’ils n’ont pas vécues directement. Parfois, ces souvenirs racontés par leurs parents prendront davantage de place dans leur mémoire que leur propre enfance.
Dans un article publié dans la revue” Art Absolument” en 2013, Marianne Hirsch précise ce concept: “Comme je la conçois, la connection avec le passé que je définis comme postmémoire ne s’opère pas au travers d’une forme particulière de remémoration, mais d’un investissement imaginaire, d’une projection et d’une création. Grandir avec le poids de souvenirs transmis qui vous submergent, être dominé par des récits d’événements qui ont précédé sa naissance ou qui se sont déroulés avant que l’on puisse en prendre conscience, c’est prendre le risque d’avoir les récits de sa propre vie déplacés, ou même évacués, par nos ancêtres. C’est être formé, bien qu’indirectement, par des fragments traumatiques d’événements qui continuent à défier la reconstruction narrative et à excéder la compréhension”
Je repense à présent à l’image utilisée par Régine Waintrater, pour décrire ces fragments d’histoire qui surgissent parfois dans la vie des descendants….comme des petits ruisseaux qui viennent infuser notre psychisme.
En dehors des cadres extrêmes comme le génocide, j’ai compris que chaque famille avait ses petits ruisseaux. Les miens, j’ai eu la chance de les parcourir avec ma grand-mère. Grâce à sa transmission, je me suis fabriquée des représentations, j’ai construit mon propre roman familial, renforcé par des lectures puis des rencontres. Surtout, j’ai eu un environnement propice pour cela, j’ai pu poser des questions, et on m’a répondu. Finalement, je crois que c’est ça, le plus important pour avoir accès aux émotions de nos parents ou de grand-parents : dialoguer lorsque cela est possible, oser poser les questions qui nous taraudent, braver notre pudeur et celle de nos interlocuteurs…Pour finir, j’ai envie de poser une dernière question : et vous, vous avez déjà essayé ?