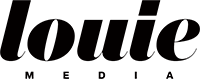Retranscription - Le trac: si vous l'avez, c'est une bonne chose
Micro-trottoir :
Personne 1 : Aujourd’hui, je dirais que je me sens assez excitée face à un renouveau un peu parce que j'ai pris ma première journée aujourd'hui.
Personne 2 : Je me sens, je me sens. Je me sens bien et un peu perdu en même temps parce que j'habite à Rio et que je suis revenu ici pour du travail et que du coup, je suis à la fois chez moi et pas vraiment chez moi. Donc je suis dans un entre deux.
Personne 3 : Je me sens bien *rire*, je sais pas.
Personne 4 : Ça va, je me sens comme tout le monde. Des fois, ça va. Des fois, ça ne va pas.
Personne 5 : Aujourd’hui, je ressens de la joie et j'ai fait des choses sans réfléchir, juste parce que je ressentais l'envie ou besoin. Et donc, du coup, c'est assez libérateur.
Personne 6 : J’ai passé une bonne journée, une bonne soirée et là, je me sens apaisée.
Adélie Pojzman Pontay : Est ce que vous sauriez le dire, ce que vous ressentez vous? Vous avez le mot exact pour décrire ce qui vous traverse, ce qui vous travaille depuis que votre réveil a sonné ce matin et que vous êtes levé, un peu maussade ou tout excité.
Vous sauriez dire ce que vous ressentez là tout de suite en écoutant ma voix. De la surprise, de la curiosité, de la joie d'avoir enfin trouvé un moment tranquille pour écouter un podcast.
Peut être de l'appréhension en découvrant cette nouvelle émission dont, vous ne savez encore rien du tout ?
On dit que c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Peut être parce qu’on ne sait pas toujours bien ce qu'on ressent ni pourquoi. Parce qu'on est souvent un peu perdus dans le fouillis de notre jungle intérieure. C'est justement ça que j'ai envie d'explorer dans ce podcast. Je m'appelle Adélie Pojzman Pontay. Bienvenue dans Emotions.
MUSIQUE
Je vais essayer de vous décrire ce que je ressent là, moi, tout de suite, si je veux être précise, je vais aller chercher dans ce que les universitaires appellent la granularité de mes émotions. C'est à dire dans toutes les nuances de ce que je ressent à cet instant précis.
Je peux vous dire, par exemple, que je suis en studio et que derrière la vitre, il y a Charlotte et Mélissa, mes cheffes. Bernard et Nicolas, les singés sons. Alice, l'attachée de production.
Ils me regardent tous avec des grands yeux. J'ai un peu du mal à respirer. J'ai le cœur qui bat super vite et je n'arrête pas de rire parce que je suis gênée je ris. C'est pas un réflexe hyper pratique, je vous assure.
Je suis la personne qui ris aux enterrements. A cet instant, qu'est ce que je ressent moi. De la peur, du stress, de l'angoisse. Depuis septembre, il y a ma kiné qui essaye désespérément de me masser le diaphragme, c'est le muscle sous votre cage thoracique et j'ai l'impression d'avoir un caillou à la place de l'estomac.
En fait, j'ai l'impression que présenter ce podcast, c’est comme si je m'avançais nue sur une scène, devant un public prêt à me jeter des clous. Devoir prendre la parole devant plein d'inconnus qui vont pouvoir critiquer et commenter.
J'ai peur de rater. J'ai peur de trébucher. En fait. J'ai le trac.
Comme Franck il y a 30 ans, je vous parle de Franck parce que sa fille Jeanne m'a raconté son histoire il y a pas longtemps. Comme moi, il rêvait de faire son métier depuis tout petit. Lui, c'était avocat. Il avait brillamment réussi l'examen du barreau dans sa ville, Nantes, et il avait commencé à travailler assez jeune. Franck avait été recruté par un avocat connu dans toute la région et cet avocat attendait beaucoup de lui.
Et puis, la pression était d'autant plus grande que Franck se lançait en droit pénal, c'est à dire qu'il se retrouvait à défendre des délinquants, des criminels, des gens qui risquent la prison. Et le trac a failli briser sa carrière. A 23 ans, il se retrouve à défendre un homme qui est détenu pour trafic de drogue.
Franck : Il est dans une situation qui est la pire en droit pénal, c'est à dire s'il est déclaré coupable, il est considéré en récidive légale.
Adélie Pojzman Pontay : Evidemment, quand on récidive, on risque gros et en plus, le client de Franck conteste ce qui lui est reproché. Il clame son innocence quand il arrive au tribunal. Franck a hyper peur.
Franck : C'est un ancien palais de justice Troisième République. Une salle avec du parquet, une barre en bois, des bancs de la défense en bois. Un box avec des croisillons et je me souviens très bien que cette affaire va être jugée en premier et que l'on va être dans une salle qui va être comble.
Adélie Pojzman Pontay : La salle est pleine, c'est le printemps, il fait très chaud dans le tribunal, Franck transpire sous sa robe noire. Il y a le public qui voit en lui quelqu'un de compétent, quelqu'un qui connaît son dossier sur le bout des doigts, dont on attend la prestation parce qu'elle va sauver son client. Et puis, il y a ses nouveaux collègues aussi et les avocats des autres cabinets qui l'attendent au tournant.
Franck : Et le regard des confrères, surtout dans les premières années, est toujours important. J'étais repéré déjà, ça faisait un an et demi à peu près que j'étais avocat. On savait chez qui j'étais avocat. Cet avocat, mon mentor qui était réputé pour former des gens aussi rigoureux que lui l'était. Ça participait indéniablement de mon stress. Le regard de ses pairs est plus difficile à supporter que le regard d'un public.
Adélie Pojzman Pontay : Mais dès le début de l'audience, les choses prennent un mauvais tour entre le client de Franck et le juge. Le dossier est à charge et le client continue de se dire innocent.
Franck : Quand l'audience commence, il commence à se passer, ce que je crains, c'est à dire une confrontation entre le magistrat qui préside et mon client sur le thème « je me demande si monsieur, vous êtes tout à fait conscient des éléments qui existent dans le dossier et je me demande si vos contestations ne sont pas le signe de votre volonté de se moquer du tribunal. »
Adélie Pojzman Pontay : Après le juge, c'est le procureur qui prend la parole. Il annonce la peine à laquelle il voudrait voir le client de Franck condamné cinq ans de prison ferme.
Franck : Le procureur se lève. Il expose tout le mal qu'il pense de mon client et toute la certitude qu'il a qu'il faut le condamner à une très forte peine en réponse à la fois à ce qu'il a fait, selon lui, et à son attitude dans le dossier et à l'audience.
Adélie Pojzman Pontay : Dans le tribunal, il y a trois parties le procureur qui demande la peine, l'avocat qui défend son client et le juge qui vient trouver le bon équilibre entre les deux. Au moment où Franck s'apprête à prendre la parole. Il a le sentiment que tout le monde est contre lui.
Franck : Je me demande si je vais arriver à être suffisamment éloquent pour attirer les juges dans une autre direction qui me semble, vraiment sincèrement, qui me semble devoir être prise. Qu’ils pensent ou non mon client soit coupable. Je me demande si c'est possible que je sois à la hauteur.
Adélie Pojzman Pontay : Franck se lève, s'avance à la barre devant les trois juges et il se lance dans sa plaidoirie.
Franck : Alors que je prononce une phrase qui doit se terminer par le nom de mon client, je bloque. Je suis incapable de prononcer le nom de mon client. J'ai oublié là, en train de plaider en pleine audience devant tous ces gens qui sont derrière moi pour le public, à côté de ses confrères qui sont à côté de moi. J'ai oublié le nom de mon client.
Je suis trempé de sueur, je baigne dans une chaleur terrible. Il me manque trois mots.
Le prénom et le nom de mon client précédé de monsieur.
C'est ce silence. C'est le silence de ma voix. C'est le silence de mon esprit, c'est le silence de cette salle d'audience. Les murs me renvoie le silence qui continue, qui dure et auquel je ne vois aucune fin et je n'ai aucune ressource. Les juges voient que je ne finit pas ma phrase, que ma phrase a la vocation à être achevée par le nom de l'homme là, dont on a déjà parlé des dizaines et dizaines de fois depuis que l'audience a commencé.
Et alors, un des membres du tribunal, je me souviens très bien, c'était l'assesseur de droite va se pencher vers moi, alors je suis à quatre, cinq mètres de lui. Il est sur une estrade. Moi, je suis en bas des marches. Il va se pencher vers moi et il va me souffler le nom de mon client. Il va le souffler fort pour que je ne l'entendent. En pleine salle d'audience.
Adélie Pojzman Pontay : Il le souffle pour aider Franck, bien sûr, mais ce n'est pas comme ça que Franck le prend.
Franck : Je vais l'entendre comme justement une gifle, comme la preuve de ma terrible incompétence.
Adélie Pojzman Pontay : Le client de Franck a bien écopé de la peine requise par le parquet cinq ans ferme, mais après tout, ce n'est pas la seule affaire difficile que Franck a eue dans sa vie et la seule qu'il a perdue. Pourquoi ce souvenir reste si vivement fiché dans sa mémoire ? Pourquoi, trente ans après, il se souvient encore de la chaleur de la salle d'audience et de la sueur qui lui coule le long du dos ? Qu'est ce qui, dans ce trac, est dans le regard que les autres ont posé sur lui ce jour là avaient tellement d’importance ?
Alors, j'ai posé la question à une psychiatre, Christine Barois.
Christine Barois : Le trac vient du jugement d'autrui. C’est à dire que j'anticipe de manière négative quelque chose qui est vraiment une hypothèse que je fais, et c'est ça qui me met déjà dans l'anxiété, dans l'anxiété sociale, l'anxiété de représentation.
Adélie Pojzman Pontay : Christine Barois explique que c'est l'instinct grégaire qu'on a tous en nous, c'est à dire l'instinct qui nous pousse à vivre en groupe, en société, qui fait qu'on a peur de la vie des autres. Car si leur avis est négatif, ils pourraient nous rejeter et seul personne ne survit.
Christine Barois : Qu'est ce que c'est dit de moi si je ne reçois pas l'approbation des autres ? Ça veut dire que je ne suis pas suffisant pour être dans ce groupe. Ça veut dire que je vais être regretté de ce groupe. Ça veut dire que je vais être exclu et ça veut dire que je suis abandonné. Et les angoisses d'abandon, c'est un peu comme des angoisses de mort. C’est à dire je meurs, je n'y arrive pas, je vais mourir.
Adélie Pojzman Pontay : Donc si on se retrouve tout seul on meurt ?
Christine Barois : Exactement quelqu'un de tout seul meurt.
Adélie Pojzman Pontay : Le trac, c'est donc anticiper d'être rejeté par le groupe dont on fait partie ou dont on veut faire partie. Et c'est évident en fait. C'est ce qui donnait le trac à Franck devant ses confrères il y a 30 ans, et c'est ce qui m'obsède, moi, depuis des semaines. C'est ce que les gens vont penser de l'émission de moi, de ma voix. Enfin, vous voyez l'enjeu, quoi. J’ai pas envie de décevoir. Ni vous, ni mes chefs, ni moi.
Et franchement, ce n'est pas une peur absurde. Les autres peuvent décider, de manière formelle ou non, de nous rejeter, par exemple. Je pourrais rater cette émission. Vous pourriez ne plus jamais écouter ce podcast et mettre de mauvais commentaires sur iTunes, s’il vous plait ne le faites pas. Ces autres dont on craint le regard quand on a le trac. Ils ont un vrai pouvoir sur nous. S'ils nous rejettent, ce sont nos projets d'avenir, l'identité qu'on s'était construite ou qu'on s'était rêvée, les liens avec les gens qui nous entourent, qui peuvent s'écrouler.
Et c'est un peu ce qui est arrivé à Aloïs.
Aloïs : C’est impossible que vous me viriez. Ça n'a pas de sens. Comment est ce que c’est possible, ce truc là? C'est pas possible.
Adélie Pojzman Pontay : Pour comprendre l'histoire d'Aloïs, il faut revenir dix ans en arrière à son année de seconde option arts plastiques dans un lycée d’Angoulême.
Aloïs : Dans cette classe, je rencontre pas mal de gens, notamment trois personnes qui vont devenir très importantes dans ma vie ensuite.
Adélie Pojzman Pontay : Vous voyez ces bandes d'ados inséparables, une clique qui a l'air hyper soudée. Ça, c'est le genre de bande que moi, j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais ado. Et bien Aloïs et ses potes.
Aloïs : Ruppert, Théo et François.
Adélie Pojzman Pontay : C'était ça.
Aloïs : Alors, ces trois personnes vont devenir importantes parce qu'en fait, elles partagent le même rêve que moi, on partage tous les quatre le même rêve. Notamment révolutionner le monde de la BD, rien que ça, donc on rigolait avec ça. Mais on était quand même un petit sérieux et donc on travaillait, ont dessinait, on s'amusait tout le temps avec le dessin. Bref, on était tout le temps fourrés ensemble et on dessiné tout le temps.
Adélie Pojzman Pontay : Au moment du bac, il décide tous les quatre de passer la même école, les Beaux-Arts d'Angoulême, qui est spécialisé dans la BD.
Aloïs : Et comme par miracle, tous les quatre étaient reçus aux Beaux-Arts après concours.
Adélie Pojzman Pontay : Sauf que voilà, quand on est aux Beaux-Arts d'Angoulême, il faut passer deux oraux chaque semestre. On se retrouve devant quatre professeurs et il faut défendre les projets artistiques qu'on a réalisés pendant le semestre. C'est noté sur 10. Et si vous avez moins de cinq à l'un des deux orauxs, eh bien, vous êtes viré. C'est pas la moyenne des deux oraux qui compte. C'est vraiment la note de chaque oral. Et bien Aloïs, il est pas terrible à l'oral.
Aloïs : Il faut savoir que la classe en est 35 40 et que moi, je suis toujours dans les cinq derniers. Je suis quelqu’un de très angoissé. Dès que je dois passer à l'oral devant des personnes, je ne suis vraiment pas à l’aise. L’anticipation, le coeur qui bat, le fait de réfléchir mille fois à la même phrase pour commencer, je suis vraiment mauvais, quoi.
Adélie Pojzman Pontay : Le jour de l'oral Aloïs s'installe dans une petite salle d'environ 20 mètres carrés. C'est petit, rassurant et plutôt intimiste.
Aloïs : Les profs arrivent vers moi. Je commence à parler. Je commence à sortir de trois petites blagues. Je commence à parler de mes projets un peu farfelus, un peu tiré par les cheveux, mais en même temps assez amusant. Et les profs sont réceptifs. Ils rigolent. Et quand je commence à faire rire les jurys, eh bien, il y a vraiment une espèce de confiance, une espèce de situation qui met à l'aise. Et du coup, j'enchaîne, je continue, je les fais rire, je les fais rire.
Ils passent vraiment un bon moment. Et ce qui fait que ben, ils me disent merci pour la prestation. T'inquiète pas. Et puis, à plus tard.
Adélie Pojzman Pontay : Les résultats tombent le soir même. Et bingo! Aloïs a 9 sur 10.
Aloïs : Truc de fou.
Adélie Pojzman Pontay : Il est premier ex-aequo de sa promo?
Aloïs : Ouais, je plane. Je suis exactement à l'endroit où je dois être. C'était irréel pour moi.
Adélie Pojzman Pontay : A la fin du deuxième semestre, Il y a le deuxième oral à passer.
Aloïs : Sauf que là, c'est différent du premier bilan. C'est que mes proches, mes potes, etc me disent toi, toute façon, ça se passera bien. Arrivé au deuxième bilan, je me retrouve pas dans l'arrière salle, mais bien dans la salle principale. Elle fait plus de 100 mètres carrés.
Adélie Pojzman Pontay : Aucun rapport avec la salle du premier oral, qui était petite et intimiste. La deuxième, elle, est beaucoup plus impressionnante.
Aloïs : Ce qui fait qu'il y a plus de monde.
Adélie Pojzman Pontay : Les autres élèves étaient tellement impressionnés par la note d'Aloïs au premier semestre qu'il y en a plein qui sont venus le voir.
Aloïs : J'installe ma présentation en U pour que les profs puissent se promener, voir tous mes projets de semestre. Et voilà tout simplement en U quoi. Les profs arrivent. Et là, j'avais prévu des blagues pareil, j’avais pris le pareil que le premier semestre, j'étais dans la même situation. Sauf que les blagues que je commence à dire, il n'y a pas de rire. Et du coup, je commence à perdre le contrôle, je commence à devenir tout rouge. Je commence à faire des blancs, je perd mes moyens.
Je n'arrive plus à articuler. Je n'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à dire ce que je voulais et dans ma tête, ça fait « Non, non, non, non, non, non, c'est en train d'arriver. Il ne faut pas que ça arrive. C'est pas bon, c'est pas ça. Il faut que je réussisse. » Je n'arrive plus à présenter mes travaux. C'est pas en train de réussir que ça ne marche pas.
Ça marche pas. Je regarde les profs, je relance des blagues, j'essaye. Ça fait toujours pas rire. Ils me regardent. Ils fuient mon regard. Ils se regardent entre eux. Ils regardent tout le monde. Tout se croise entre eux devant moi et je suis statique.
Et le pire dans cette situation, c'est qu'au moment où je commence à galérer, il y a d'autres personnes, d'autres camarades qui montent parce qu'ils ont entendu dire que ça commençait pour venir voir ce qui se passe.
Même s'ils ne sont pas nombreux, je ne sais pas, ils sont trois, quatre, ils sont six, ils sont peut être dix. Je n'en sais rien, en fait.
Adélie Pojzman Pontay : Aloïs perd tellement ses moyens qu'il en oublie de présenter son projet principal. Le truc qui avait plu à tous ses profs et aux autres élèves au cours du semestre. Dans le public, il y a un de ces trois amis, Théo. Il le soutient du regard. Lui dit oui, de la tête, comme pour dire « T'inquiète, ça va passer, mec »
Aloïs : Mais vous savez, le oui de la tête, mais avec les sourcils tristes.
Adélie Pojzman Pontay : A la fin de l'oral, Théo essaye de réconforter Aloïs.
Aloïs : Il y a du coup Théo qui me dit « t'inquiète pas, ça va passer, de toute façon t’as eu 9 sur 10 donc là tu vas avoir 6 ou 5 mais ça va passer ils vont pas te virer c’est impossible qu’ils te virent ». OK.
Adélie Pojzman Pontay : Au moment où les résultats vont tomber, on sait déjà que trois personnes vont se faire virer.
Aloïs : Mais il y en avait une quatrième et forcément, vous en doutez. La quatrième, c'était c'était moi.
Adélie Pojzman Pontay : Aloïs a eu trois au deuxième oral.
Aloïs : Et du coup, je me rappelle après, on s'est retrouvé avec Ruppert et Théo dans le coin et on s'était mis dans un spot qu'on avait et on était là mais tellement tristes. Ils m’en voulait tellement et en même temps, il y avait tout qui tombait en fait, le fait que je parte, ils m'en voulait terriblement parce qu'en fait, je n'avais pas réussi à rester. Et du coup, il y a toute notre fusion tout ce truc là qui disparaissait avec moi.
Adélie Pojzman Pontay : Ce qui est marrant, c'est que d'après mes recherches, la plupart du temps, le trac est censé justement éviter ça, éviter qu'on trébuche sur scène. On a peur que ça arrive donc on panique tranquille derrière le rideau, en l'absence des autres, de ceux qu'on a peur de perdre ou de décevoir. En fait, ce qui caractérise le trac, c'est qu'il intervient normalement avant de monter sur scène, avant de faire face au danger.
Patrick Tort : In absentia.
Adélie Pojzman Pontay : In absentia, c'est le mot savant, emploie Patrick Tort pour dire qu'on a peur d'un danger qui n'est pas présente devant nous. Patrick Tort, il est philosophe et théoricien des sciences. C'est le directeur de l'Institut, Charles Darwin International. Il a consacré toute sa vie à Darwin et il est en train de publier son oeuvre intégrale en 35 volumes. Pourquoi je me suis retrouvée à discuter avec un expert de Darwin ? J'ai tout simplement tapé. Pourquoi on a le trac ? Dans Google et je suis tombée sur tout un tas de vidéos et tout un tas d'articles qui me disaient que Darwin avait théorisé le trac. Je me suis rendue chez Patrick Tort, dans le Tarn, et la première chose qu'il m'a dite, c'est qu'Internet avait faux et que Darwin n'avait jamais parlé de trac. Notre conversation aurait donc pu s'arrêter là au bout de trente secondes d'interview, après 800 kilomètres de trajet. Sauf qu'en fait, Patrick Tort avait aussi d'autres choses à me dire, notamment que le trac n'existe pas juste pour nous faire souffrir. Il a une fonction.
Patrick Tort : Il est utile parce qu'il permet de se défaire de la peur en l’éprouvant in absentia c'est à dire en dehors du danger, en dehors de l'épreuve avant l'épreuve. Mais c'est l'expérimentation dans l'imaginaire et en même temps le vécu sensible et sans danger, objectif d'une situation dont on veut se délivrer dans la vie réelle. Et le trac a cette fonction.
Adélie Pojzman Pontay : Le trac, c'est comme un vaccin. En fait, c'est cette petite dose d'angoisse, d'abandon, de mort sociale qui vous immunise théoriquement pour surmonter l'épreuve devant vous au moment où vous n'avez plus d'échappatoire. Vous êtes en coulisse, de l'autre côté du rideau. Il y a un public ou un jury qui vous attend et à ce stade où vous montez sur scène et vous réussissez, bravo! Ou vous courez la mort sociale parce que que vous ratiez sur scène ou que vous ne montiez pas sur scène.
Dans les deux cas, vous aurez échoué au regard des autres et vous emmènerait ses regards avec vous. Et si vous en avez quelque chose à faire de ce jugement, des autres ne culpabilisait pas. C'est le propre de notre condition humaine. Seuls les gens ont le trac. C'est pas comme la peur. Un hamster a peur, un humain, il a peur et il a le trac. Parce que le trac implique la conscience des valeurs et la capacité à se projeter dans le futur.
Par exemple, pour Aloïs C'est se demander juste avant son oral s'il va bien réussir les Beaux-Arts et devenir l'auteur de BD qu'il a toujours rêvé d'être.
Patrick Tort : Il inclut la conscience du jugement des autres, c'est à dire qu'il oppose l'estime et le mépris. Il est intimement lié à la capacité de se représenter l'avenir. Là, je reprends les termes de darwiniste et l'intériorisation de ce que Darwin précisément, nomme l'importance accordée à l'opinion d'autrui.
Adélie Pojzman Pontay : En fait, chez Darwin, selon Patrick Tort, c'est une question d'éthique qui se joue là. Les humains seraient constamment traversés par deux formes de désirs contradictoires. Le premier, c'est le désir immédiat qui nous pousse à vouloir acquérir quelque chose ou à en jouir. Le deuxième désir, c'est un désir à long terme, c'est celui qui nous permet justement de vivre en société les uns avec les autres, et ce désir là qui est plus durable, c'est d'obtenir l'approbation d’autrui.
Patrick Tort : L'éthique de la civilisation chez Darwin, c'est quelque chose qui repose sur l'exigence que l'on a d'être en tout point conforme à l'attente d'autrui. C’est à dire que le prix que l'on accorde à l'opinion que l'autre a de nous mêmes et ce qui structure en fait au niveau des individus, la cohérence de la civilisation.
Adélie Pojzman Pontay : Le tract c’est la réponse à ce désir profond d'appartenir à la société. Est ce que pour autant, ça veut dire que tous les humains ont le tract de la même manière et avec la même intensité ? Non. Un professeur d'art oratoire qui s'appelle Stéphane André a une anecdote rigolote sur ce sujet d'ailleurs.
Stéphane André : On pense généralement que l'art oratoire est un don.
Adélie Pojzman Pontay : Stéphane André anime régulièrement des conférences et des ateliers pour aider les gens à être plus à l'aise à l'oral dans chacune de ses conférences. Il demande à quelqu'un de se porter volontaire pour venir sur scène et parler pendant deux ou trois minutes du sujet qu'il veut. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes déjà crispé en entendant ça, mais deux ou trois minutes pour parler sans avoir rien préparé devant des inconnus dans un amphithéâtre. Moi, je trouve ça terrifiant.
Stéphane André : Alors, quand on demande et quand on demande encore aujourd'hui dans un amphithéâtre d'Européens, de Français en particulier, est ce que quelqu'un veut bien venir faire un exposé alors qu'il y a 200 personnes dans l’amphithéâtre ? Je dirais presque que chacun regarde dans son cartable en se disant « J'ai un truc à faire dans mon cartable et tout », un peu comme quand on avait quand on était à l'école et qu'on avait 12 ans ou 13 ans et que le prof disait quelqu'un va venir au tableau et à ce moment là, tout le monde regardait dans son cartable ou regardait dans ses notes.
J'ai pratiquement le même comportement adulte de gens de 40, 50 ou 60 ans dans un amphithéâtre. Si vous demandez que l'un d'entre eux veuille bien venir à la tribune faire un exposé, les gens n'ont pas envie de venir. C'est pourquoi, en général, maintenant, je désigne les gens que je fais monter sur scène. C'est plus simple.
Adélie Pojzman Pontay : La grande majorité du temps, Stéphane André donne cette conférence devant un public français. Mais il y a quelques années, il se retrouve à faire la même conférence en anglais devant des élèves nigérians.
Stéphane André : Au moment où je leur ai demandé que l'un d'entre eux veuille bien descendre les degrés de l'amphithéâtre pour venir s'asseoir à la tribune et faire un petit exposé sur un thème de son choix. Quand j'ai eu fini de parler quasiment la totalité, il faut dire que je parlais depuis pratiquement une heure, la totalité de l'amphi s’est levé et tous ces gens jouer des coudes entre eux, à qui arriverait le premier en bas à la tribune, pour faire son exposé. Et pour moi, ça m'a fait un choc incroyable parce que jamais je n'avais eu une telle envie de parler en public devant un amphi de français.
Et j'ai compris que finalement, le trac était d'origine culturelle. Donc, ça veut dire pas personnel.
Adélie Pojzman Pontay : Est ce qu'il y a des pays où on serait particulièrement traceux ? Ou est ce qu'il y a des gens devant qui il est particulièrement difficile de parler ? Peut être qu'on n'est pas tous égaux devant le trac, mais peut être aussi que certains publics ont un regard plus dur que d'autres. Et si le problème en fait, c'était pas moi, c'était vous. Et si vous étiez particulièrement attentif à la moindre erreur, prêt à rire, à juger, à vous moquer?
Je dis vous, je ne pense pas vraiment à vous tous qui m'écoutez. Je pense à ceux qui, comme moi, sont français. Et si en France, on était particulièrement dur face à la parole de l’autre ? En France, le silence est d’or, le rompre, c'est terrifiant.
Et c'est Roberte Langlois qui, à la fois institutrice en maternelle et chercheuse en sciences de l'éducation, qui m'a expliqué pourquoi elle a notamment écrit une thèse sur la place de l'oralité dans l'école française. Et elle m'a reçu chez elle, à Rouen.
Quand je suis arrivé dans son salon, il y avait sur la table un exemplaire du journal Le Monde.
Roberte me tend le journal qui est daté du 3 septembre, la veille de mon arrivée, et qui contient une interview du comédien Jacques Weber. Dedans Weber raconte justement qu'il a été traumatisé par son éducation.
Roberte Langlois : Le dimanche, le lundi 3 septembre, je lis Le Monde et je vois la page de Jacques Weber. Il y a toujours une page rencontre avec un comédien, un homme public, pour savoir qui il est et pourquoi il en est arrivé là. Jacques Weber raconte « je suis marqué au fer rouge par l'Éducation nationale » il raconte qu’il était un cancre dans une famille où il fallait être intelligent. Et le mépris de son père.
Adélie Pojzman Pontay : Le journaliste dit à Weber.
« Vous dites avoir été un cancre. Est ce que vous n'aimez pas l'école où l'école n'était pas faite pour vous? » Weber répond « C'était réciproque. Je n'aimais pas l'autorité de l'école et sa foncière en justice. J'avais des difficultés, car j'étais très introverti. J'écrivais mal parce que j'étais hyper nerveux et très émotif. On me disait que j'étais nul crétin. Mon père en rajoutait une couche en balançant Les petits imbéciles n'ont pas la parole à table. »
Roberte Langlois : « Les petits imbéciles n'ont pas la parole à table. » Le droit à la parole, c’est très français ça comme l’expression. Ne pas avoir droit à la parole. Parler comme un livre, quand on sait, on se tait, voilà toutes ces expressions qui donnent la nature de la parole au niveau de l'école des enfants, même au statut familial finalement,.
Adélie Pojzman Pontay : Ce qu'elle m'explique, c'est que l'éducation française laisse vraiment peu de place à l'oral. Quand on a le droit de parler, c'est pour lire en fait, lire à voix haute un texte écrit, réciter une poésie écrite. Mais les élèves ont peu la liberté de s'exprimer, de donner leur point de vue.
En fait, ce n'est pas un hasard. Laissez moi vous présenter Ferdinand Buisson et son Dictionnaire de l'éducation, publié en 1882. Sur sa page Wikipédia Ferdinand a l'air d'un monsieur typique de la Troisième République. Il est chauve. Il a une grande moustache qui rebique et des petites lunettes posées sur le nez. Et son dictionnaire, qui compile tout ce qui se dit à l'époque sur l’éducation, des articles de loi des débats à l'Assemblée, définit les bases de l'école de la République qui resteront plus ou moins les mêmes, à peu de choses près, jusqu'en 1972.
Roberte Langlois : Ce qui est intéressant, c'est dans le dictionnaire de Ferdinand Buisson. Il est quand même écrit bien l'oral à l'école, c'est le dialogue pédagogique qui se définit comme le maître pose une question. L'enfant répond.
Adélie Pojzman Pontay : Vous vous rendez compte que c'est le seul dialogue valable à l'intérieur de la salle de classe? Pas les élèves posent des questions, pas les élèves, suggèrent des idées, pas les élèves tâtonnent ni débattent juste le maître pose une question et l'élève répond. Comment on en est arrivé là ? Il faut remonter quatre siècles plus tôt, à la Renaissance. Jusque là, c'étaient les religieux qui enseignaient.
Roberte Langlois : Et tout se faisait à l'oral, et notamment en latin.
Adélie Pojzman Pontay : Et à la Renaissance. On entre dans une période de questionnement de fond sur la place de l'écrit. D'abord, il y a l'imprimerie, qui arrive en France en 1470. Et puis, il y a aussi le protestantisme, qui arrive 50 ans après et qui met la Bible, donc le livre au cœur de sa pratique religieuse. Et puis, enfin, il y a les jésuites. C'est quoi, les jésuites ?
C'est un ordre religieux qui naît à cette époque là aussi. Mais surtout, ce sont les gens qui, au sein de l'Église, sont complètement focalisés sur l'instruction. Et ces jésuites, Ils donnent une importance immense à l'écrit et vous croyez peut être que ça ne vous concerne pas, mais si en fait, parce que l'enseignement jésuite a irrigué toute l'éducation en France.
Roberte Langlois : Les jésuites ont créé une école de contrôle. Il fallait contrôler les élèves. On les a contrôlés par les exercices écrits
Adélie Pojzman Pontay : et la seule parole qu'ils autorisent, c'est une parole contrainte.
Roberte Langlois : Les jésuites, ils ont développé aussi la rhétorique qu'est ce que c'est, la rhétorique? J'écris un texte que je vais moraliser.
Adélie Pojzman Pontay : Ils développent une parole qui ne fait que mimer l'écrit.
Roberte Langlois : Et puis, il y a aussi le cours magistral. Alors, les Jésuites, ils ont repris ce qui se passait à la religion, c'est à dire que le prêtre, le dimanche, il parlait à l'assemblée. Il était seul face à un auditoire central, un peu surélevé, comme sur une estrade et à l'école de Jules Ferry il y avait bien l'estrade où il y avait le bureau et le maître. Qui parle à l’école ? Si ce n'est les profs.
Adélie Pojzman Pontay : Donc, dites vous que à ce stade, pour les écoliers français de la Renaissance, prendre la parole devant les autres de manière libre et naturelle, c'est déjà pas simple. Mais ça va encore s'aggraver parce qu'à partir de la révolution, l'idée germe qu'il faut éduquer le peuple avant l'éducation. C'est un truc de nobles, de riches ou de religieux. Permettre au peuple d'accéder à l'éducation, c'est le fondement de la démocratie. Mais pour devenir un corps politique, pour pouvoir débattre, c’est quoi la base ? C'est parler la même langue. Problème les gens en France parlent des patois différents. Il faut donc leur apprendre une langue commune.
Évidemment, il faut du temps pour que ça se mette en place. Tout ça, c'est ce qui nous amène au XIXè siècle et à la Troisième République de notre ami Ferdinand Buisson. Et c'est là que commence le vrai bras de fer entre l'écrit et l'oral. Pour inculquer le français aux petits écoliers de la Bretagne jusqu'à Nice, il faut faire taire les patois.
Roberte Langlois : Si on laissait s'exprimer les enfants, les petits Bretons dans les classes, par exemple, ils s'expriment en breton. C'était leur langue. Surtout, il fallait pas qu'ils s'expriment en breton puisqu'il fallait qu'ils apprennent le français et qu'ils parlent que français. Et c'est par l'écrit qu'on va unifient par A, B, C, d, l'apprentissage des lettres, l'apprentissage de la lecture, l'écriture. Le système éducatif français s'est créé sur ce déséquilibre, sur cette tension.
Adélie Pojzman Pontay : Donc, on arrive à la fin du 19ème siècle avec un Jules Ferry et un Ferdinand Buisson qui, pour faire aboutir le projet révolutionnaire, est dans la droite lignée des changements qui ont commencé à la Renaissance vont rendre la prise de parole en classe hyper risquée. Ça, c'est ce que Roberte Langlois appelle le statut de l’erreur.
Roberte Langlois : Par exemple les enfants français. Alors, ça se voit à l'écrit. Je ne parle pas de la parole, mais lorsqu'ils savent, ils ont peur de ne pas savoir, ils s'abstiennent, ils répondent pas les autres enfants, ils répondent dans tous les autres pays, ils répondent même s'ils savent pas le statut de l'erreur. Se tromper. J'ai raté en maîtresse, j'ai raté, je me suis trompé. C'est une tare qui qui fige la confiance en soi parce qu'il y a cette idée qu'il faut toujours réussir. Et c'est dans la tête des parents. L'enfant n'est pas sûr. Une fois qu'il a raté il ne refait plus.
Adélie Pojzman Pontay : Ça vous rappelle des souvenirs?
Donc certes, le trac est universel. Pensez au regard des autres fait partie de la condition humaine. Mais quand vous avez grandi en France, où l'on vous apprend à ne pas prendre la parole ou que vous devez parler devant des Français qui pensent que votre parole ne vaut que si elle ressemble à du Victor Hugo déclamé, clairement, on comprend que votre trac s'aggrave. J'ai eu envie d'en parler avec quelqu'un qui n'est pas français, justement, mais qui est souvent confronté au regard des Français.
Sebastian Marx : Je m'appelle Sebastian Marx et je suis un humoriste. Je monte sur scène et je raconte des blagues, je joue en français et en anglais.
Adélie Pojzman Pontay : J'ai retrouvé Sébastien dans un café à Montreuil avant qu'il monte sur scène. Il avait plein de choses à me dire sur les Français.
Sebastian Marx : Une fois, j'étais dans la rue. Je parlais avec un ami français. Je parlais en français au téléphone. J'étais sur une place à la place Tertre ou chose comme ça et j'ai dit « titre », j'ai fait une faute et quelqu'un juste à côté de moi, un piéton juste à côté, m'a corrigé.
Adélie Pojzman Pontay : Il a dit quoi exactement?
Sebastian Marx : C'est une femme, elle a juste dit « C’est Tertre », même pas un bonjour, c'est juste elle a entendu que j'ai fait une faute. C'était dans ses oreilles. C'était inadmissible. Elle a osé. Elle avait le culot de corriger un étranger qui parlait au téléphone à quelqu'un d'autre d'une façon malpoli, parce que j'étais dans ses yeux, impoli d'avoir un peu mal prononcé sa langue.
Adélie Pojzman Pontay : Tu penses que c'est une question de politesse, vraiment?
Sebastian Marx : Non, je ne pense pas que c'était une question de politesse. Je pense que c'est une question de droit à l'erreur. Je pense qu'en France, j'étais prof de la langue anglaise à une école française. J'ai vu à quel point l'importance est mise sur l’écrit. Il y a des dictées qui sont très importants apparemment en France, et c'est très maître qui récite des choses à des élèves. Les élèves doivent se taire et juste noter notes et noter par rapport aux Etats-Unis, on met beaucoup plus d’importante au dialogue et les élèves ont le droit, ils sont poussés à poser des questions et de faire des erreurs, de poser des questions bêtes. Et en France, j'ai l'impression que ça se fait pas dire si on ose poser une question ma maîtresse ou le maître va dire non. Il ne faut pas parler maintenant. Après ou si on fait une faute, c'est assez grave et en plus en plus.
La langue est tellement difficile que finalement, on va faire des bêtises avec cette langue. C'est tellement facile à faire de fautes.
Si je dis oh, au lieu de 1, c'est un autre mot. Donc, c'est un autre mot. Et les gens ne vont pas comprendre. Et ils ne vont pas être sympa sur le fait qu'ils s n'ont pas compris. On te regarde comme si tu raconter le pire chose du monde.
Le problème aussi, c'est que si tu dis à quelqu'un un baguette au lieu de une baguette, ils peuvent même pas faire l'effort de deviner, mais ils vont faire croire que tu dis n'importe quoi. Mais je trouve que oui, il y a moins d'acceptation de l’erreur justement.
Adélie Pojzman Pontay : Je sais pas si tu fréquentes beaucoup d'autres expats américains en France. Est ce que c'est dont vous parlez entre vous, genre ces Français Ils sont trop méchants?
Sebastian Marx : Ouais, je dirais pas forcement méchant, mais qui jugent. En tant que humoriste aussi. On monte sur scène devant le public français et en tant qu’Américain, on a souvent aux Etats-Unis des publics assez accueillant, ils vont dans un comedy club parce qu'ils ont envie de rire et donc ils sont partants, sur un bon a priori, ils disent « OK, là, on est dans comme les clubs, la personne qui va monter sur scène est forcement drôle. On va rire ». Mais aussi, c'est le lieu qui compte beaucoup.
C'est un club. Il y a des petites tables. Tout le monde boit alors qu’en France c’est un théâtre, donc une espèce de cadre très clair, qui fait aussi qui peut être, peut rappeler. maintenant, j’y pense une salle de classe, il y a quelqu'un qui parle et le public ne parle pas. Souvent, le Stand-upper marche très bien quand il y a un petit réaction, interaction entre le 2 et parfois c’est difficile, je pose des questions au public français.
Et il n'ose pas répondre. Ou une personne et tout le monde le regarde. Et oui, il y a cette appréhension. Dans un premier temps, ils ont un a priori négatif. Ils ont le bras croisés, ils vont dire « OK, fais moi rire. J'attends que l'humoriste soit sur scène. Je vais essayer de rester dans ma coquille, jusqu'à ce qu'il casse ma carapace et OK c’était pas mal. » On va recevoir des éloges comme « Ah c'est pas mal », c’est le maximum qu’on peut espérer si un Français te dit c'est pas mal, jackpot, ça va.
Adélie Pojzman Pontay : Au moins, maintenant, je serais hyper flattée si je lis « c'est pas mal » dans les commentaires iTunes. Et si vous me dites que vous avez trouvé ça extraordinaire, je saurais qu'on a des auditeurs élevés, loin de Ferdinand Buisson, dans la joie et l'enthousiasme. Mais surtout, je crois que ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle que j'ai eu le trac en fait, c'était ma manière de penser à vous qui m'écoutez.
Et peut être qu'après cet épisode, on essaiera de ne plus croiser les bras en allant dans un comédie club, d'accepter un peu mieux cette parole vivante qui se cherche, qui déraille et qui hésite et de se dire « Tant pis si on trébuche. C'est notre réflexion en train de naître et de faire ses premiers pas. » Et à chaque fois qu'on aura le trac. On pourra aussi se dire que c'est normal, que ça prouve que simplement, on n'est pas des hamsters.
GENERIQUE
C'était Emotions, un podcast de Louie Media que vous pouvez vous empressé de suivre sur tous les réseaux sociaux sur les comptes @EmotionsPodcast sur tweeter, Facebook et Instagram pour ne rater aucun épisode. Retrouvez nous là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts sur iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pourrez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires un peu partout pour nous dire si ça vous a plu et n'hésitez pas à le recommander à vos proches.
Les interviews ont été réalisées par Jeanne Boëzec, Alice Boulot, Iris Ouédraogo, Maureen Wilson et moi même. Alice m'a aussi aidé dans les recherches. Jean-Baptiste Aubonnet, Claire Cahu, Tristan Mazire, Bernard Natier, Nicolas Vair ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas de Gélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé le logo Merci à Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlowski pour la direction éditoriale et la production. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps.
Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louiemedia.com comme retrouver Emotions un lundi sur deux.
À très bientôt!