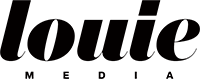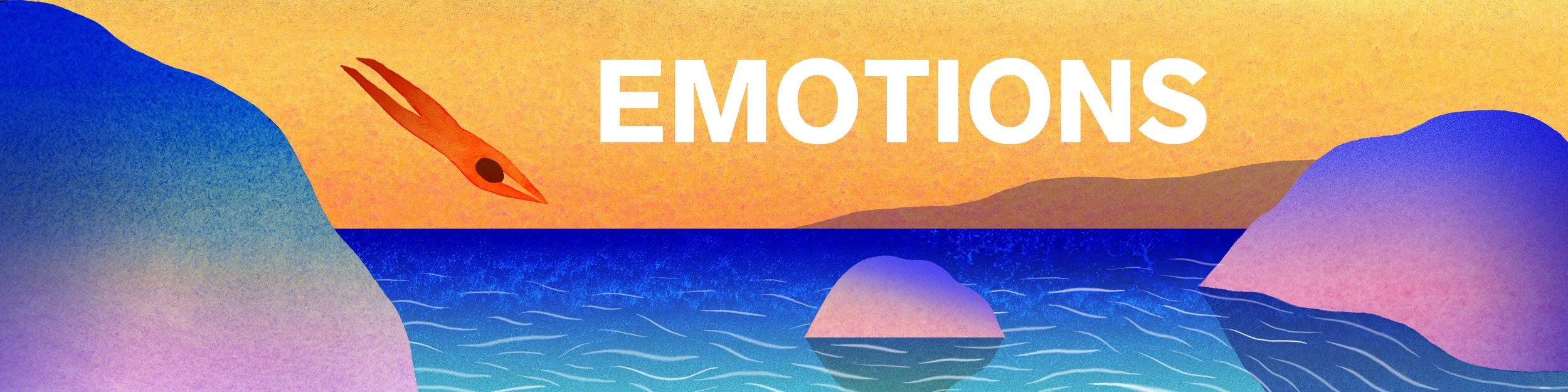Episode Bonus au Centre Pompidou: qu'est-ce qu'on ressent quand on crée ?
/ILLUSTRATION : JEAN MALLARD
“L'art est une garantie de santé mentale”, disait la sculptrice et plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois, morte en 2010, à l’âge de 98 ans.
De son vivant, Louise Bourgeois n’a jamais caché ses traumatismes d’enfance, ni le fait qu’ils étaient les principales sources d’inspirations de ses oeuvres. Elle a toujours dit que l’Art lui avait permis, tout au long de sa vie, d’exorciser ses maux.
Mais que se passe-t-il dans la tête des artistes quand ils créent? Est-ce qu’ils ressentent de l’apaisement? De l’excitation? Du bonheur? De l’angoisse?
Les émotions qui se dégagent de leur oeuvre restent-elles encore en eux, une fois celle-ci terminée ? Qu’est-ce qui explique que le fait de créer des œuvres d’art peut parfois apaiser, calmer, voire soigner ?
L’épisode bonus d’Émotions que vous allez entendre a été enregistré au Centre Pompidou. C’était le 21 novembre dernier, et nous y étions dans le cadre de la 7eme soirée sonore organisée par le musée, dont la thématique était ce soir-là Art & Thérapie.
Pour cette soirée, nous avons organisé une table ronde avec trois femmes dont les parcours nous ont semblé pertinents pour répondre à toutes les questions sur l’art et les émotions nous nous posions. Car chacune de ces femmes, l’artiste-peintre Inès Longevial, la psychologue Marion Botella et la drama-thérapeute Sandrine Pitarque, font le lien, dans leurs domaines bien spécifiques, entre le monde de l’art et celui des émotions.