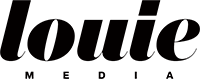Pourquoi les voix nous font-elles tant d’effet?
/Depuis des mois qu’on s’apprête à sortir Entre, notre podcast lancé ce mercredi 7 mars, on écoute en boucle nos interviews de Justine. Et, outre son propos, ce qui nous reste en tête, imprimée en nous, c’est sa voix. Son ton, sa tessiture, ses intonations. Quand elle dit: «Y’a tout le temps quelqu'un qui vient te voir et qui te fait passer dans le passage de la préadolescence». Et quand elle dit «Faites-moi un nuage. Avec vos rêves dedans».
C’est une des remarques qui revient souvent parmi les auditeurs d’Entre ou de Transfert: le pouvoir des voix, la manière dont elles s’inscrivent en nous, génèrent ce sentiment de proximité et d'intimité. Et même quand les narrateurs ont des voix qui agacent, voire insupportent, elles ne nous laissent jamais indifférent.e.s.
Pourquoi?
L’enjeu d’authenticité
En réalité, peu de choses émanent d’une personne avec autant d’authenticité qu’une voix. Même quand ce n’est pas volontaire. Parce que beaucoup de coachs ont beau proposer de vous apprendre à maîtriser votre voix, la voix échappe en réalité à un contrôle total. Pour une raison simple: on ne s’entend pas de la même manière que les autres nous entendent.
Comme l’explique cet article de Slate.fr, habituellement, on entend les sons propagés par voie aérienne: «les sons portés par l’air sont transmis aux tympans, qui font vibrer trois os appelés osselets, et ces vibrations finissent dans la cochlée qui les transforme en signaux électriques envoyés au cerveau». Lorsque nous nous entendons nous-mêmes, c’est par propagation osseuse que notre voix nous parvient: «les vibrations des cordes vocales atteignent directement la cochlée par la propagation osseuse».
Ne pas nous entendre de la même manière que les autres nous empêche de contrôler notre propre voix et force ainsi à un minimum d’authenticité. (C’est d’ailleurs parce que l’on s’entend d’habitude de l’intérieur (par propagation osseuse) qu’écouter un enregistrement de soi et s’entendre ainsi par propagation aérienne crée un sentiment d’étrangeté.)
Mais, au-delà du plaisir qu’il y a à accéder par la voix à une certaine vérité de l’autre, ces voix que nous entendons ont aussi une influence sur nos émotions. C’est ce que montrait une étude, menée par Jean-Julien Aucouturier, chercheur au CNRS, et publiée dans «Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America» en 2016. Une centaine de participants ont répondu à des questions simples sur leurs émotions et leur humeur pour déterminer s’ils se sentaient plutôt heureux, tristes ou inquiets. Ensuite, ils ont dû lire un texte à voix haute en entendant simultanément leur propre voix à travers des écouteurs. On leur a enfin demandé d'évaluer à nouveau leurs émotions en utilisant le même questionnaire (les participants n'ont pas été informés que le fait de raconter leurs émotions et de lire le texte à voix haute faisait partie de la même expérience).
Mais ce que les participants ignoraient, c'est que le timbre de leur voix qu'ils entendaient dans leurs écouteurs était en fait légèrement modifié, à l’aide d’une plateforme audio-numérique créée par les chercheurs, pour qu'il sonne plus heureux, plus triste ou plus inquiet (hauteur plus élevée pour le bonheur par exemple, légers tremblements dans la voix pour la peur et l’anxiété). Les chercheurs ont alors constaté après la lecture que les participants ne s’étaient rendu compte de rien, et décrivaient même en très grande majorité leurs émotions conformément aux modifications que leur voix avait subies. La voix que les participants ont entendu dans leurs oreilles a modifié leur état émotionnel.
La voix, un mode de communication plus empathique que les autres
Une autre étude, menée par Michael W. Kraus de Yale University School of Management, publiée en 2017 dans «American Psychologist», a révélé que la voix seule, dépourvue d’appuis visuels comme le visage, était d’ailleurs le mode de communication qui suscitait le plus d’empathie. En d’autres termes, que l’on percevait mieux les émotions des autres en se reposant uniquement sur leur voix. Kraus a réalisé des expériences dans des situations diverses et variées. Dans l’une, il a demandé aux participants de regarder des vidéos de deux personnes interagissant et se taquinant l'une l'autre et d’évaluer la gamme d'émotions suscitée au cours de l'interaction. Dans une autre, il les a fait interagir directement entre eux dans une pièce tantôt éclairée, tantôt plongée dans le noir. Dans une troisième étude, on a demandé à un groupe différent de participants d'évaluer les émotions des interlocuteurs qui avaient été filmés.
À chaque reprise, lorsque les participants n’entendaient que la voix, l’évaluation émotionnelle des autres atteignait une précision inégalée. Kraus s'est alors demandé pourquoi la voix, surtout lorsqu'elle est le seul indice, est un mode d'empathie aussi puissant par rapport aux autres situations (un visage sans voix, ou encore un visage et une voix). Sa conclusion est que lorsque nous n'écoutons que la voix, notre attention pour les subtilités de la tonalité vocale s'accentue. Nous nous concentrons davantage sur les nuances que nous entendons dans la façon dont les interlocuteurs s'expriment. C’est ainsi que dans Du côté de Guermantes, le narrateur évoque la voix de sa grand-mère lorsqu'il réussit, après de nombreux essais, à l'avoir au téléphone:
«Tout d’un coup j’entendis cette voix que je croyais à tort connaître si bien, car jusque-là, chaque fois que ma grand’mère avait causé avec moi, ce qu’elle me disait, je l’avais toujours suivi sur la partition ouverte de son visage où les yeux tenaient beaucoup de place ; mais sa voix elle-même, je l’écoutais aujourd’hui pour la première fois. Et parce que cette voix m’apparaissait changée dans ses proportions dès l’instant qu’elle était un tout, et m’arrivait ainsi seule et sans l’accompagnement des traits de la figure, je découvris combien cette voix était douce (...); fragile à force de délicatesse, elle semblait à tout moment prête à se briser, à expirer en un pur flot de larmes, puis l'ayant seule près de moi, vue sans le masque du visage, j’y remarquais, pour la première fois, les chagrins qui l’avaient fêlée au cours de la vie.»
C’est parce qu’elle ôte ce masque du visage que la voix dénude si bien les êtres, et qu’elle parvient si fort à nous toucher.