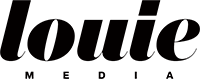Comment trouver sa voix
/Chez Louie, on aime beaucoup écouter The Heart, le podcast de Kaitlin Prest. Ici, pas de routine. Dans ce podcast narratif où le ou la protagoniste raconte une histoire très personnelle sous la forme d'une enquête, l'irrégularité c'est la règle. On ne sait jamais sur quoi va porter l'histoire qui nous sera contée. Pourtant, on peut vous assurer qu'une fois que vous aurez écouté quelques épisodes, vous saurez reconnaître The Heart entre mille. Il y a quelque chose dans la voix, comme une empreinte, chez tous les protagonistes de ce podcast, qui nous plonge dans un univers particulier.
Car la voix est le mode de communication le plus empathique et authentique. Elle est un ingrédient fondamental des podcasts. Nous en parlions dans un article, alors que la saison 1 de Entre venait d’être lancée et que l’on était subjugué.e.s par la voix de Justine. Depuis, nous avons sorti Plan Culinaire, Émotions et Injustices qui sont tous les trois des podcasts de narration. Et, à chaque enregistrement, on se demande comment rendre notre voix la plus agréable possible à écouter pour porter, accompagner cette narration.
Quand on enregistre un podcast, on le fait en studio. On se retrouve debout face à un micro, derrière une vitre. C’est une scène qu’Adélie Pojzman-Pontay raconte très bien dans l’épisode 1 d’Émotions. On a un casque sur la tête, on entend notre voix et on ne la reconnaît pas. Parce que la voix qu’on entend à l’intérieur de nous est plus grave que celle que l’on projette à cause de toutes les vibrations que l’air provoque sur nos os lorsqu’on parle. De l’autre côté de la vitre, se trouvent l’ingénieur son et les autres personnes de l’équipe qui ont travaillé avec nous sur la réalisation de l’épisode. L’ingénieur du son a deux gros écrans d’ordinateur devant lui et une table de mixage. Et autant vous dire que, dans ces conditions, c’est difficile d’avoir une manière naturelle de parler. Pourtant, ce que l’on recherche c’est que la voix soit fluide, naturelle, ni trop rapide, ni trop monotone, tout en pensant à l’articulation, à la projection de notre voix, et à la clarté de notre propos.
Pour le podcast Injustices, Clara Garnier-Amouroux commence déjà à préparer sa voix en chemin pour le studio: ”J’écoute les voix des gens que j’aime bien sur mon vélo parce qu’ils ont une intonation qui me plaît, et je répète ce qu’ils disent à voix haute jusqu’à ce que ça sonne bien dans ma voix à moi. Et, au moment de m’enregistrer, je m’étire à chaque fois que je bloque sur un passage.”
Respirer pour mieux parler
Marie Lelong est coach vocale à l’Ecole de Journalisme de Sciences Po, elle aide de futurs journalistes à poser leur voix. Vous l’avez sûrement déjà entendue dans des publicités à la radio et elle a longtemps été comédienne. “Ma voix a changé à partir du moment où j’ai commencé à jouer et à la travailler. Elle est plus puissante et l’écart de ses possibilités a beaucoup grandi. Maintenant, j’ai l’impression d’avoir plus de liberté d’interprétation, de jeux et d’univers vocal parce que je sais utiliser ma respiration.”
Pour Marie, le nerf de la guerre c’est ça: la respiration! Et, d’après elle, il faut retourner à une respiration naturelle, celle que l’on pratique lorsqu’on dort, celle que l’on pratiquait enfant; la respiration abdominale. C’est à cause du stress quotidien que nous respirons de plus en plus haut et que notre souffle se bloque au niveau de la poitrine. Alors que “la clef de voûte d’une bonne voix qui sort, qui peut varier, qui est libre (...) c’est la respiration abdominale”.
Eh oui, tout se joue au niveau du ventre. Pour y arriver, Marie demande à ses étudiants de parler avec la voix la plus grave possible. Essayez, vous verrez que votre sangle abdominale se contracte automatiquement. Parler en projetant sa voix, c’est presque du sport. “Quand je sors de studio, je sens que mes abdos se sont mobilisés, que mon corps a été présent”, raconte Marie Lelong.
Donner la parole aux critiques
Pour pouvoir être le plus naturel possible, pour pouvoir faire passer des émotions, il faut donc mobiliser son corps. Être debout devant un micro, les jambes et le tronc crispé, ne bouger que sa bouche et se concentrer sur son articulation ne mènera à rien d’autre qu’à réciter son texte à la façon d’Alexa ou celle du GPS de votre voiture. “C’est impossible d’être juste et naturel en n’utilisant absolument pas son corps. (...) Quand je suis en studio, je bouge comme quand je parle à un ami. Je fais beaucoup de gestes en parlant, donc j’essaie vraiment de me mettre dans cette disposition là.” Le fait de bouger permet de penser ce que l’on dit et pour pouvoir faire passer des sentiments, il est extrêmement important d’être porteur soi-même de ces émotions. Alors on bouge les mains, on fait des signes, des mimes même s’il le faut, pour nous permettre de vivre notre texte. Pour qu’on entende un sourire dans une voix, il faut vraiment sourire, d’un vrai sourire!
Pour le podcast Émotions, Adélie Pojzman Pontay fait des exercices avant et pendant chaque enregistrement: ”Je fais des étirements inspirés du yoga pour détendre mon cou, mes épaules, mon buste et surtout mon diaphragme. Je fais aussi quelques vocalises pour échauffer ma voix et les muscles de mon visage.”
Marie Lelong préconise d’anticiper ce que l’on veut que les gens retiennent. Elle appelle ça le “doggy bag”: “Je me demande comment et avec quelle idée je veux que [l’auditeur] reparte. Est-ce que les gens se diront que c’était hyper drôle? Ou plutôt que ça les a séduit?” Et quand il lui arrive de devoir parler de sujets qui ne la touchent pas forcément, comme elle le fait pour des publicités, elle tente de trouver une connexion avec le thème qu’elle traite. ”Quel que soit le message, il faut qu’il fasse écho chez [moi] à un endroit”.
On ne peut pas changer le timbre de sa voix, mais avec toutes ces astuces, on peut la travailler et la rendre agréable à l’enregistrement. Plus vous l’exercerez, plus vous serez à l’aise. Ce n’est que comme ça que vous pourrez réellement trouver votre identité vocale.
Amel Almia