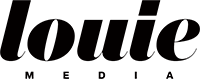Comment faire du (bon) reality show en son ?
/Plaisir coupable ou passion assumée, la télé-réalité plaît autant qu’elle interroge et ce depuis le début des années 2000 en France. Aujourd’hui, ces programmes ne bénéficient plus de l’attrait de la nouveauté. Mais c’était avant que le podcast s’empare du genre. Nous avons échangé avec les producteurs du podcast anglais d'audio-réalité The Brights pour comprendre comment ce type de programme peut devenir addictif.
De la télé-réalité en son ?
Le podcast The Brights suit la famille du même nom dans son quotidien. Leur particularité? Lydia Bright, l’une des filles, est également star de la télé-réalité britannique.
Si nous nous intéressons à The Brights, c’est d’abord parce que c’est l’une des premières production d’audio-réalité, même si d’autres programmes l’ont précédée, comme The Habitat du studio de podcasts américain Gimlet. On parle d’"audio-réalité" car elle reprend des codes bien définis de la télé-réalité en les adaptant aux contraintes du son.
Steve Ackerman, en charge de la conception et du marketing de l’émission, nous explique que l’enregistrement d’un épisode se fait deux après-midi par semaine - auquel vient s’ajouter le contact quotidien par messages avec l’un des producteurs qui se doit de rester au courant de ce tout qui se trame chez les Bright. L’objectif étant de faire de la série le contenu le plus authentique possible, comme nous l’a expliqué Chris Skinner, producteur de l’émission. Pour cela, lui et son équipe se sont immiscé.e.s chez les Bright: ils repèrent une histoire de cœur ou un début de dispute, leur demandent d’attendre l’arrivée des micros et s’assurent de faire le meilleur enregistrement possible. En tout, six personnes travaillent sur la série et décortiquent les sons des sept micros branchés à chacun des membres de la famille.
Pour Steve Ackerman, il est important que la narration suive le fil du réel et non l’inverse. Le plus dur est de choisir quelles histoires retenir et lesquelles abandonner. Si, comme on peut le lire dans cet article du Figaro, "a promesse [de la téléréalité] était au départ de montrer dans gens comme nous dans leur vie quotidienne", il reste "très difficile de s'en tenir à la banalité". D’où la nécessité, pour tromper l’ennui, de forcer certaines conversations au sein de la maisonnée Bright. "On ne les force pas à s’adapter à une structure narrative rigide, on les laisse créer leur propre histoire, nous dit Chris Skinner. On leur suggère des idées, mais on finit rarement par diffuser ce à quoi on pensait originellement".
Si la série reste écrite et narrée, elle ne rime pas pour autant avec continuité. Cette absence de logique temporelle est d’ailleurs ce qui fait le succès des séries de télé-réalité - on comprend donc pourquoi The Brights tient à reproduire l’astuce. Dans une étude publiée en 2008, les chercheurs.euse.s Lisa K. Lundy, Amanda M. Ruth et Travis D. Park avaient constaté que les étudiant.e.s interrogé.e.s plébiscitaient l’indépendance des épisodes de télé-réalité les uns par rapport aux autres. "Contrairement aux fictions scénarisées où ils prenaient du retard quand ils rataient un épisode, les séries de télé-réalité semblaient bien s’adapter aux emplois du temps changeants et aux styles de vie denses des étudiants." Steve Ackerman est fier que celles et ceux qui écoutent sa série le fassent d’une traite et dans le désordre. "Environ la moitié de notre public est nouveau chaque semaine, donc on se doute bien qu’ils/elles ne connaissent pas tous les épisodes précédents."
Réinventer le genre
The Brights s’inspire fortement des codes de la télé-réalité pour fidéliser et renouveler son public, mais elle ne se prive pas pour autant d’inventer ses propres pratiques, en évitant les mises en scène artificielles et grossières, par exemple.
En premier lieu, les producteurs ont pris conscience de la sobriété que permet le format du podcast. "On s’est assez vite rendus compte qu’il ne faut finalement que très peu de dialogue pour faire comprendre une histoire. La voix-off de Lydia [Bright] aide énormément le public à se repérer, à se remémorer ce qui s’est passé dans les épisodes précédents et quels sont les rapports qui lient chaque voix l’une à l’autre", explique Steve Ackerman.
Et s’il y a un avantage incontestable à l’audio par rapport à l’image quand on est producteur, c’est le gain de temps. Steve Ackerman nous explique le ratio : ce qui pourrait mettre deux jours à être filmé met une après-midi à être enregistré en audio. Il en va de même pour le montage, beaucoup plus fluide et rapide que pour la télévision. À la lourdeur des caméras et des perches se substituent également la légèreté et la maniabilité des micros-cravate. Une fois les Bright câblés, l’équipe technique peut disparaître.
Parce qu’un autre atout de l’audio, c’est qu’on ne vous voit pas. Une solution pratique lorsqu’il s’agit de faire entendre une grande diversité de personnes, pas forcément à l’aise avec le fait d’être filmées. C’est le cas de Dave Bright, père de Lydia, qui a toujours refusé de participer à l’émission de télé-réalité dans laquelle sa fille évolue - mais qui participe au podcast. Chris Skinner s’en félicite : "On peut maintenant attirer des personnes aux histoires et aux vies intéressantes, qui auraient peut-être été réticentes à l’idée par le passé." Se passer de l’image permet aussi de s’affranchir des questions physiques : "Soyons honnêtes, beaucoup de ces shows de télé-réalité montrent des gens jeunes et beaux et quand vous n’avez plus ces contraintes [...] vous pouvez juste vous intéresser à quiconque a une bonne histoire et une vie intéressante."
Pour accompagner les auditeurs et auditrices, c’est Lydia qui sert de fil conducteur : elle résume les épisodes précédents et décrit la scène. Chris Skinner juge sa voix essentielle, car elle raconte aux auditeur.trice.s ce qu’ils et elles ne peuvent pas voir, en décrivant les personnages par exemple. "Lydia s’est prêtée au jeu – par exemple elle ne disait pas seulement «Dave fait ceci» mais plutôt «Dave, mon père, qui est plutôt comme ça…, fait ceci»." Car il est essentiel, pour créer une histoire, d’avoir des personnages identifiables. "Nous nous sommes rendus compte qu’avoir trop de voix, trop d’histoires pouvait rendre le tout confus", nous explique Chris Skinner. Alors pour éviter la confusion, la production de The Brights a fait le choix de se concentrer sur un ou deux événements centraux par épisode. "Dans l’audio particulièrement, on doit raconter une histoire de façon assez simple car il y a plusieurs voix et surtout, on ne voit rien. Donc la simplicité est cruciale", continue Chris Skinner. Réussir à raconter une histoire simplement en créant une ambiance qui permettra à l’histoire de fonctionner est un art qui ne s’improvise pas. "Quand on prend la peine d’aller enregistrer sur place, il faut que les auditeurs comprennent où ils sont [...] Nous voulions que la série soit aussi réaliste que possible, avec des bruits de bouilloires, des gens qui s’interrompent sans cesse, des oiseaux qui chantent dehors, nous dit Chris Skinner. Au début, on préférait éviter les sons environnants pour privilégier les conversations [...] mais très vite, je me suis dit qu’en discutant, la mère et ses filles feraient probablement bouillir de l’eau pour un thé, donc maintenant, on laisse la bouilloire siffler en fond sonore, on laisse les tasses s’entrechoquer."
La télé-réalité comme porte d’entrée vers le podcast ?
Avoir un podcast de qualité ne garantit pas le succès et une large audience. Mais l’équipe de production a pu compter sur la popularité de ses personnages principaux. D’après les centaines de commentaires laissées sur les plateformes spécialisées, Steve a retenu que, pour beaucoup d’auditeurs, ce podcast était le premier qu’ils écoutaient. Un public probablement acquis grâce à Lydia Bright : "notre intuition, c’est qu’ils sont plutôt jeunes et qu’ils ont suivi Lydia et sa famille sur les réseaux", nous explique Steve Ackerman. Lydia Bright a plus d’un million de followers sur Instagram et autant sur Twitter –sa mère se contente de la moitié, ses sœurs de centaines de milliers.
Et les Bright offrent à leur public une échappatoire. Dans le cadre de l’étude publiée en 2008 par Lisa K. Lundy, Amanda M. Ruth et Travis D. Park, des étudiant.e.s d’université ont dit aimer regarder de la télé-réalité car elle leur permettent d’échapper à leur vie quotidienne et de goûter à d’autres vies que la leur. "Les participants disaient vivre par procuration à travers les personnages de ces séries. Pour ces étudiants, la télé-réalité semblait offrir la possibilité d’envisager et de parler de la manière dont ils se comporteraient dans les situations présentées par les séries. Beaucoup des situations rencontrées par les personnages de télé-réalité - vie amoureuse, tensions familiales ou raciales et décisions morales - sont particulièrement parlantes pour des étudiants". C’est d’ailleurs ce que souligne le producteur de The Brights : "Je pense que la bonne audio-réalité marche quand on met en scène des gens pour qui on ressent des émotions fortes - ça peut être de l’amour, de la haine, n’importe, l’important c’est de ressentir des choses, de s’attacher et s’identifier aux personnages", nous dit Chris Skinner. Et selon lui, Lydia est "adorable".
Le producteur reconnaît des ressemblances entre télé-réalité et audio-réalité: les deux nous rappellent notre quotidien. Qu’elle soit sur écran ou dans nos oreilles, la réalité nous permet de nous identifier à des inconnus. D’autres sont plus partisans du fait que la télé-réalité a une vertu cathartique, comme François Jost, sociologue et spécialiste de la télé-réalité. Dans cet article de Libération sur la télé-réalité, il affirme: "Les Français ont découvert la télé-réalité avec l’émission Loft Story en 2001. Aujourd’hui, ils en consomment encore de nombreuses copies, comme La Ferme des Célébrités ou Les Anges de la Télé Réalité." À en croire François Jost, "ces émissions, c’est le Dîner de cons version télé-réalité. Les candidats pensent qu’ils vont être aimés pour eux alors qu’on aime leur connerie". Selon le sociologue, ce qui rend "heureux" la majorité du public, c’est de regarder ces programmes pour se détendre, se moquer, mais aussi se comparer aux candidat.e.s, pour se rassurer soi-même. Ce qu’on aime, c’est pouvoir s’identifier aux personnages, à leurs vies, tout en ayant conscience de notre plus grande valeur.
Maintenant que The Brights a trouvé la formule qui lui convient, on pourrait s’attendre à ce que la série inspire d’autres à faire de l’audio-réalité. Mais pour l’instant, la prochaine étape pour The Brights est peut-être à la télé: Steve Ackerman estime que "L’audio-réalité permet de créer quelque chose avec peu de moyens - on pourrait très bien imaginer une série comme The Brights à la télévision. Ce basculement fait d’ailleurs partie de notre stratégie idéale, à terme."
Alice Bouleau et Maureen Wilson