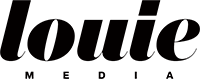Des femmes noires aux micros des podcasts
/Certains visages et certaines voix sont sous-représentés à la télévision, à la radio et dans la presse. À l’inverse, les podcasts sont souvent perçus comme étant un porte-drapeau de ces paroles invisibilisées, notamment celui des femmes racisées. Mais n’est-ce qu’un mirage? Nous avons posé la question à des femmes noires, présentatrices et créatrices de podcasts français. Des podcasts que l'on vous conseille de glisser dans vos oreilles si ce n’est pas déjà fait.
Se revendiquer afroféministe, c’est considérer que le racisme est vécu différemment en tant que femme et que la machisme revêt d’autres réalités lorsqu’on est noire. D’où le terme “misogynoire” qui additionne la misogynie et le racisme, à l’intersection entre ces deux discriminations. Ces expériences-là, celles des femmes noires, sont rarement présentes dans les médias traditionnels. Binge Audio produit Miroir miroir de Jennifer Padjemi et Kiffe ta race avec Rokhaya Diallo et Grace Ly, tous les deux lancés en septembre 2018. Hormis ces exceptions, les femmes que l’on a interrogées ont créé leur podcast de manière indépendante pour faire entendre leurs voix.
Sexuality Matter
C’est le podcast “le moins assumé de la planète” et c’est elle qui le dit à chaque début de chronique. Wendie Zahibo a 27 ans. Elle a lancé son webzine Reines des temps modernes il y a quatre ans. Dans son podcast, elle veut parler de sexe comme on en parle à des potes. “C’est un sujet tabou de manière générale. Quand on est une femme noire [particulièrement], c’est un sujet que l’on ne peut pas aborder avec ses parents.” Alors, une fois lancée, elle voulait quelque chose de “ludique et fun”.
Pari réussi car dans ses chroniques de dix minutes, elle combine humour et sérieux sans une once de gêne. Elle parle de masturbation, de cunnilingus et parfois elle y ajoute son analyse afroféministe, comme dans l’épisode sur le porno noir: “Je me suis toujours décrite comme féministe. En grandissant, en me lançant dans mes différents projets, je me rendais compte que ça ne suffisait pas. On ne prenait pas en compte le fait d’être une femme noire dans l’Hexagone.”
Maintenant, on attend avec impatience la deuxième saison. Elle ne nous a pas donné de date précise, mais nous a assuré que cela devrait être pour bientôt…
The Womanist
Direction les États-Unis, où vivent deux françaises: Laéthycia Judy et Louisa Adj. C’est en s'épanouissant dans une start-up new-yorkaise aux idées “extrêmement progressistes” que Louisa Adj a compris les enjeux de l’afroféminisme. Ou plutôt, du womanism “même si les termes sont plutôt proches”. Pour elle, contrairement à sa vision de l’afroféminisme, le mouvement womanist ne se concentre pas uniquement sur les femmes mais “inclut aussi les hommes et les enfants”.
Le déclic du podcast est né en 2017: le moment était venu pour elles de “célébrer et réunir les femmes noires. Nous donner une voix.” Outre-Atlantique, elles se sont imprégnées d’une autre forme de liberté d’expression qu’elles n’avaient pas dans l’Hexagone. “La plupart des podcasts français que je connais et qui sont abordés pour et par des personnes racisé.e.s sont produits de manière individuelle, indépendante et diffusée à plus petite échelle. Aux États-Unis, c’est beaucoup plus inclusif avec des programmes vraiment distribués à grande échelle, vraiment populaires. Ce sont des podcasts qui sont pour les femmes noires et qu’on n’entendrait pas en France”. On peut citer notamment 2 Dopes Queens de Phoebe Robinson et Jessica Williams produit par la WNYC et Yes Girls ! de Cori Murray, Charli Penn et Yolanda Sangweni diffusé par Essence.
Un an et demi plus tard, les deux créatrices ont déjà vingt-deux épisodes à leur actif. Elles parlent aux femmes, noires entre 25 et 45 ans. À chaque début du talk, les deux animatrices prennent quelques minutes pour revenir sur leur quotidien, leur bien-être. Ce n’est qu’ensuite qu’elles approfondissent –seules ou avec une invitée –un sujet comme l’importance de savoir dire non ou le “racisme anti-blanc” . Elles abordent principalement des problématiques de société (amour, famille, sexualité), d’actualité et de bien-être. Ce dernier thème est presque emblématique des podcasts afroféministes. D’après Louisa Adj, “de manière générale, on en parle beaucoup depuis deux ou trois ans [...] mais encore plus dans le discours militant parce que, quand on est racisé, on doit faire face à des micro agressions permanentes. Il y a une fatigue mentale. [...] Les personnes qui vivent le racisme et les discriminations constamment doivent prendre soin d’elle. C’est le premier geste, c’est une façon douce de lutter contre les agressions extérieures. C’est indispensable”.
Me, My Sex And I®
Ne parlez surtout pas d’afroféminisme à Axelle Jah Njiké! La créatrice de Me, My Sex and I® est noire et féministe un point c’est tout. Dans son podcast, elle veut mettre en valeur “les féminités noires” dans leur pluralité. Elle s’entoure de femmes qu’elle trouve inspirantes. Chacun de ses épisodes porte sobrement le prénom de celle qui partage son témoignage et ses expériences. Comme Paoline, elle est la première joueuse noire de l’équipe de France de basket et elle revient sur une enfance emplie d’extrême violence. Avec ses invitées, elle parle de l’intime, de l’enfance: “J’ai essayé de proposer [cette idée] à d’autres podcasts. Mais ils ne comprenaient pas l’importance de l’intime. Ils étaient accoutumés à ce qu’on leur parle de discriminations”.
Axelle Jah Njiké souligne l’importance qu’il y a à parler de l’intimité des femmes noires et se lance, seule, en mai 2018. Adolescente, elle déplore n’avoir accès à aucun contenu à propos de l’intimité dans les communautés noires. Donc elle développe sa vision propre: “[Dans] la communauté afro, les podcasts ont un peu tous la même trame. On est encore sur le fait d’être noir plutôt que d’être des personnes. Je voudrais voir des personnes noires aborder des thématiques plus vastes, comme par exemple, celles des nouvelles technologies.” Pour elle, l’un des meilleurs exemples est le prochain podcast de cette liste: Après la première page.
Après la première page
On s’immerge dans la littérature. Pour Maly Diallo, la créatrice d’Après la première page, ce podcast est un “objet”. Elle est une femme noire et elle invite des autrices noires et / ou des lectrices à parler derrière son micro. “Ma démarche est afroféministe en ce qu’elle met en avant les femmes noires sur un plan sur lequel elles sont peu attendues en France à savoir, la littérature. Mais je ne crois pas que toutes celles qui passent au micro se reconnaissent dans l’afroféminisme.” Elle ne demande pas à ses invitées si elle sont afroféministes. Elle ne cherche pas à n’être écoutée que par des femmes noires. “Ma cible, c’est cette personne qui s’est déjà fait porter pâle parce que qu’elle ne parvenait pas à lâcher un livre passionnant, [...] c’est cette personne qui voyage dans des contrées extraordinaires depuis le fond de son lit.” Dans l’épisode Voici venir les rêveurs, Maly Diallo débute avec une conversation autour d’une recette. Ensuite, on entre dans le vif du sujet: le roman de l’autrice camerounaise Imbolo Mbue. L’enregistrement est hors studio, informel sur la forme comme dans un club de lecture.
Du point de vue de Maly Diallo, il reste encore beaucoup à faire: “Il y a un vernis d'inclusivité dans le paysage podcastique français. Qualitativement parlant, c'est sans commune mesure avec les médias mainstream. Néanmoins, les dynamiques de pouvoirs dans ce monde-là sont peu ou prou les mêmes que celles de la société: des personnes blanches qui construisent leur succès grâce à l'exploitation de thématiques arrivées sur le devant de la scène à la suite de combats acharnés de personnes concerné.e.s (qui, elles, n'en retirent rien)”.
Aujourd’hui, ce que ces femmes interviewées ressentent –sans que d’études ne le démontre– c’est qu’il y aurait une fuite des auditeur.trice.s racisé.e.s vers des médias qui parlent d’eux, qui en parlent sans stéréotype et qui les rendent visibles. Pour Axelle Jah Njiké, le podcast a compris les besoins de ces auditeur.trice.s: “On a été beaucoup plus rapide que les autres médias. [...] On a réussi à mettre sur la table la diversité de la société dans laquelle on est.”
Financièrement, la majeure partie des podcasts afroféministes français sont indépendants. Ils ne sont affiliés à aucune grande plateforme de podcast. Wendie Zahibo de Sexuality matter et Axelle Jah Njiké de Me, My Sex And I® ont essayé pourtant. Elles ont contacté ces plateformes mais il leur a été rétorqué que leur idée n’était pas assez aboutie ou que le sujet n'intéressait pas suffisamment les auditeur.rice.s. Axelle Jah Njiké est actuellement en pleine recherche de financement pour sa prochaine saison. Les autres créatrices de ces podcasts n’ont même pas songé à se rattacher à une plateforme déjà existante. Elles aiment la totale liberté qu’offre le podcast.
Amel Almia et Maud Benakcha