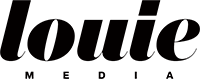Racontons-nous encore de vraies histoires?
/Il y a quelques semaines, le sociologue Christian Salmon nous annonçait un changement. Lui qui avait théorisé, il y a une décennie, la manière dont nous étions entré.e.s dans l’ère du storytelling (technique de communication consistant à user des procédés narratifs et de la mise en récit pour renforcer l'adhésion du public au fond du discours, à des fins économiques ou encore politiques; ou comment «transformer un politique, un cadre d'entreprise ou un baril de lessive en héros de saga») déclare maintenant aujourd’hui: «Fini le storytelling, bienvenue dans l’ère du clash». Dans son long papier ainsi titré, publié sur le site de Médiapart, il explique la manière dont désormais «les événements ne s’ordonnent plus en feuilletons mais sont gouvernés par l’imprévisibilité, l’irruption, la surprise».
Il y a 10 ans, Salmon regrettait dans son passionnant ouvrage que «l’essor du storytelling ressemble en effet à une victoire à la Pyrrhus, obtenue au prix de la banalisation du concept même de récit et de la confusion entretenue entre un véritable récit (narrative) et un simple échange d’anecdotes (stories), un témoignage et un récit de fiction, une narration spontanée (orale ou écrite) et un rapport d’activité.» Si l’ère du storytelling s’achève. Va-t-on pouvoir enfin restaurer de vrais récits, de vraies histoires? Et se pose alors la question: c’est quoi, une vraie histoire?
Figurez-vous que Walter Benjamin, philosophe allemand du début du XXème siècle, peut nous aider à répondre à cette question.
«L’art de raconter est en voie de se perdre», constatait-il dans Expérience et pauvreté, publié en 1933. Nous sommes près d’un siècle avant Salmon et déjà le philosophe analyse avec une lucidité étonnante le tournant qui est en train de se jouer à la charnière du XIXème et du XXème siècle. Selon Walter Benjamin, le XXème siècle entre dans une véritable crise de la narration qui a déjà débuté au siècle précédent.
Une finalité morale
Traditionnellement, la narration repose sur un aspect utilitaire, une moralité, un conseil de vie. Cette finalité morale du récit suppose, chez celui ou celle qui raconte, une forme de sagesse «tissé[e] dans l'étoffe d'une vie vécue». Cette sagesse précisément, explique le philosophe allemand, est en déclin au début du XXème siècle. La sagesse se comprend, selon lui, comme une forme d'autorité acquise par l'expérience des années passées et la proximité d'avec la mort. Le mourant est alors le symbole d'une sagesse qui se veut transmissible. C’est la figure extrêmement courante du vieux sage. Et quel est le point commun entre les trois plus grands ou plus célèbres vieux sages de la culture pop: Yoda de Star Wars, Dumbledore de Harry Potter et Gandalf du Seigneur des anneaux? [SPOILER] Ils meurent. Tous les trois. (Même si ok, certains ressuscitent ou parlent d’une mystérieuse façon aux vivants). Et ils ont anticipé leur mort prochaine. D’où la nécessité de transmettre leurs histoires et leurs expériences à un héritier ou un apprenti plus jeune.
Or, «au XIXe siècle, la société bourgeoise, avec ses institutions hygiéniques et sociales, privées et publiques, a obtenu un résultat accessoire, qui était peut-être inconsciemment son but principal: permettre aux hommes de ne plus assister à la mort de leurs congénères». La poursuite effrénée du nouveau dans les sociétés modernes a anéanti la sagesse en mettant à distance les personnes âgées susceptibles d’avoir des expériences à partager, donc les vraies histoires.
Il faut ajouter que les nouvelles techniques d'enregistrement de la voix (gramophone, phonographe, téléphone), jouent un rôle crucial dans cette disparition de la sagesse. Elles ont en quelque sorte supprimé l'autorité conférée par la mort prochaine et la nécessité urgente de transmettre les expériences. Quand un simple bouton permet d'immortaliser une voix, un conseil sage, une philosophie de vie, il n'y a plus d'angoisse de la transmission.
Il importe assez peu qu’il s’agisse d’une histoire vraie, plutôt que fausse. Il faut, en revanche, que ce soit une véritable histoire, pas une anecdote, ou un récit simplement divertissant. Une vraie histoire, selon Walter Benjamin, c’est donc la narration d'une expérience qui permet à l'auditeur d'en apprendre plus sur la personne qui raconte mais aussi et surtout sur l'être humain en général. On en sort grandi.e, enrichi.e d'une sagesse nouvelle qu'il faudra transmettre à notre tour aux générations suivantes.
Pourquoi ne racontons-nous plus de véritables histoires?
La narration suppose donc le partage d'expériences. Or, ce partage s'effectue dans le cadre d'une tradition reprise par les générations successives, dans la continuité d'une parole transmise des parents aux enfants. Mais la modernité, selon Walter Benjamin, se caractérise par le «temps disloqué et entrecoupé du travail dans le capitalisme moderne». Les événements de la vie quotidienne deviennent alors pour lui intransmissibles. Perdu dans l'«existence normalisée et dénaturée des masses soumises à la civilisation», l'individu moderne perd ses capacités narratives, privé d'expériences à raconter et d'interlocuteurs à qui les raconter. La massification de la civilisation et le développement de l’ère industrielle sur le modèle de la standardisation ont fait perdre aux actes des êtres humains leur caractère d’événements singuliers et d'expériences individuelles et uniques. C’est-à-dire, en définitive, leur possibilité de s’intégrer dans un récit, avec toutes leurs dimensions d’imprévu, de surprise, et d'absence d'explication.
Walter Benjamin constate un déclin de la continuité temporelle, fondée sur les relations entre les générations. Une forme nouvelle de continuité apparaît entre le XIXème et le XXème siècle: celle de la masse, spatiale, liée à l’urbanisation. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et de la mondialisation, c'est le contact avec les autres individus, éloignés spatialement de nous, que nous recherchons. Le partage des expériences se fait dans l'instantané mais sur des grandes distances. À l'inverse, les vraies histoires, selon le philosophe, se transmettent face à face et directement, entre deux personnes que de nombreuses années séparent.
Par quoi les avons-nous remplacées?
Au cours de la deuxième moitié du XIXème, l'information connaît des progrès incroyables. La presse se développe considérablement, s'organise, se spécialise et est lue par des millions de personnes. Selon Walter Benjamin, l'information se concentre sur l'explication: «l’événement […] est […] imposé au lecteur dans ses connexions logiques». Au contraire, la narration est beaucoup plus ouverte et refuse l'explication systématique. Elle laisse au lecteur ou à l'auditeur le soin d'interpréter le récit comme il l'entend ou même de demeurer dans l'étourdissement d'une histoire surprenante, voire incompréhensible.
La suppression de la proximité physique entre la personne qui raconte et celle qui écoute a rendu caduque toute possibilité d'échange et d'incarnation des événements transmis. Ce que la presse raconte et explique apparaît entièrement détaché de la vie du lecteur. La narration, à l'inverse, «incorpore [les événements] dans la vie même de celui qui raconte, pour le[s] communiquer, comme sa propre expérience, à celui qui écoute. Ainsi le narrateur y laisse sa trace, comme la main du potier sur le vase d’argile».
En réalité, le face à face solennel, parfois difficile à obtenir, n’est sans doute pas nécessaire à un véritable récit. Du moment que ce que Benjamin associe au face à face –l’incarnation très forte, l’attention à l’autre, la possibilité d’un partage– est reproduite ailleurs. Par exemple (vous me voyez venir?) via les podcasts narratifs. Vous avez à travers ces récits cette transmission incarnée, par la voix, l’écoute active qui se distingue de l’attention passive que l’on constate parfois vis-à-vis des écrans.
Peut-être que si le monde politique désinvestit le storytelling, nous reviendrons plus facilement collectivement à ces vraies histoires que Benjamin louait.
Moralité de la newsletter: Walter Benjamin aurait écouté des podcasts, à coup sûr!