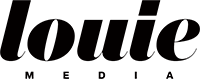Le mystère du langage est-il enfin résolu?
/Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, époque à laquelle explosaient les sciences du langage, tout le monde se passionnait pour la parole: c’était l’âge d’or de la linguistique structurale, de la psychanalyse, on pensait le langage comme une spécificité humaine… Et puis il y a eu un changement de paradigme scientifique, on a cessé d’opposer de manière aussi radicale nature et culture et, les sciences se sont désintéressées de la parole pour aller sur les terrains cognitifs et comportementaux.
Mais pendant ce temps-là, la question du mystère du langage humain n’est toujours pas résolue: pourquoi les humains parlent-ils? Vous, moi (moi beaucoup), qu’est-ce qui fait que l’on s’est mis à parler, un beau jour, il y a plus de 2 millions d’années? Que le cerveau humain est le seul adapté au langage. Pas seulement à la communication (comme tous les autres animaux) mais au langage, en désignant des choses absentes, des concepts complexes, des choses imaginaires ou futures. Un langage dit intentionnel. Et de la pensée et du langage, lequel produit l’autre?
En 2013, le linguiste américain Noam Chomsky notait encore:
«La plupart des questions relatives au langage demeurent de complets mystères. (...) Dans l’usage le plus quotidien de la langue, les gens ne cessent de créer de nouvelles expressions, de nouvelles associations. Inédites pour eux, pour qui les entend, et peut-être inédites dans l’histoire de cette langue. Cette créativité, qui est pour Descartes le trait distinctif de l’esprit humain, demeure mystérieuse aujourd’hui comme elle l’était pour lui. Bien sûr, nous savons beaucoup sur l’expression, la construction du langage, etc. Mais le lien entre l’esprit et l’activation du langage? Mystère. Non seulement le mystère demeure, mais plus on étudie, plus on découvre l’ampleur de ce qu’on ignore.»
Cette histoire de mystère du langage me fait parfois l’effet que produit la répétition d’un mot. Vous dites courgette. Encore et encore et encore et tout à coup vous vous demandez comment ce mot peut bien vouloir dire ce qu’il veut dire, et vous n’êtes plus très sûr.e, un instant, de ce que c’est qu’une courgette. À force de faire parler des gens, et d’en écouter toute la journée dans des podcasts, ça génère parfois le même effet: pas seulement de créer du flou sur le sens d’un mot ou d’un autre, mais sur le sens même de la parole.
Mais je crois que je ne suis pas seule. Prenez Unabomber, la récente série Netflix réalisée par Greg Yaitanes. L’histoire du terroriste Ted Kaczynski est racontée par la quête des agents du FBI qui espèrent le cerner. Ils y arriveront grâce à une expertise linguistique; la série de nouveau explore le langage et ce qu’il contient.
Quelques mois plus tôt, c’était déjà le sujet du film Premier Contact de Denis Villeneuve, adapté au cinéma de la nouvelle de Ted Chiang. Des extraterrestres sont arrivés sur terre, ils n’ont pas de corps, pas de bouche, ils ne semblent pas dotés d’organes permettant la parole à la manière des humains. Comment va-t-on pouvoir communiquer avec eux? Quel langage adopter? Et quel rapport au monde ce langage traduit-il?
Est-ce que ce sont les débats sur le «politiquement correct» (écriture inclusive, emploi d'un mot plutôt qu'un autre...) et la manière dont la langue s’adapte aux combats politiques, ceux sur la manière de communiquer aujourd’hui alors que les emojis s’insèrent dans le langage et que nos échanges sont à la fois instantanés (internet) et éternels (l’archivage des données), qui alimentent cette préoccupation majeure depuis le structuralisme d’après-guerre?
Tout ça pour dire mon ravissement en tombant sur cette une de The Economist «Comment des Nicaraguayens sourds ont résolu le mystère du langage» (oui c’est écrit en très petit).
L’article raconte qu’au Nicaragua, un nouveau programme de formation pour les sourds émerge à la fin du XXème siècle. Les professeurs doivent interdire la langue des signes pour favoriser l'apprentissage de la langue orale malgré le handicap. C'est un échec. Mais plusieurs années après, une enseignante prend conscience que l’une de ses élèves est en train de faire des gestes qui ne sont pas des mimes mais des signes, propres à une langue nouvelle. Elle se rend compte que les élèves, privés de la langue des signes connue jusqu’alors, ne connaissant aucune langue, ni parlée ni gestuelle, en ont réinventé une nouvelle. De toute pièce.
Le cas a énormément intéressé les scientifiques, qui voyaient là une reconstitution possible du cadre dans lequel les hommes se sont retrouvés aux premiers temps de l'homo sapiens: sans fréquentation de langue préalable, comment en avaient-ils fait émerger une? Et donc était-ce acquis ou inné?
Le cas du Nicaragua apporte un argument de plus aux partisans de la théorie de l’inné: même sans fréquenter d’autres langues, la population sourde nicaraguayenne a fait émerger sa propre langue.
Néanmoins, les tenants de l’acquis pourront aussi noter qu’un élément favorise non pas leur théorie mais le jeu de l’acquis malgré tout: la langue des signes ainsi constituée a montré que la première génération de sourds qui avait inventé cette langue la maîtrisait moins bien que la génération suivante qui l'avait apprise auprès d'eux, et pour qui cette nouvelle langue constituait une langue natale, acquise auprès des plus âgés.
Cette élucidation progressive du mystère est rassurante. Une indication que peut-être d’ici quelques décennies, assez tôt pour que nous en prenions connaissance, des réponses seront apportées.
Mais si les récits de langue des signes nicaraguayennes ne vous relaxent pas, nous avons aussi une newsletter avec des podcasts vraiment détentes. À découvrir ici.