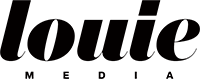Comment faire le meilleur son de podcast?
/Depuis la sortie, en février dernier, du service en ligne Anchor 3.0 qui propose tout une batterie de fonctionnalités pour la création sonore, chacun peut prendre goût au podcast et en réaliser un. Plus besoin du dernier micro Sennheiser ou Neumann ultra-sensible, ni d'un studio high-tech parfaitement insonorisé! Bon, il est vrai que le podcast ne faisait pas pour autant figure de produit très sophistiqué et technique aux yeux de tou.te.s, mais peut-être semblait-il encore hors de portée pour certain.e.s.
Cette accessibilité accrue à la création sonore se vérifie en effet par le nombre de sorties de plus en plus important de podcasts –on a dépassé les 50 milliards d'écoutes et de téléchargements depuis 2005 sur Apple. Les podcasts indépendants font avancer le médium, l'enrichissent de nouvelles idées de formats, de sons, de voix, d'histoires. Mais il est important également d'avoir une attention particulière à la qualité du son. Or, rien de mieux pour cela que de s'en remettre aux mains d'un.e professionnel.le. On est donc allé interviewer l'un de nos ingénieurs du son, Jean-Baptiste Aubonnet, pour qu'il vous parle de l'importance de son métier, et surtout, de qualité de son en podcast.
Qu'est-ce qu'une bonne prise de son pour un podcast?
J.-B. A.: «C'est au moment de la prise de son que la majorité des choix sont faits, ne serait-ce que la distance entre le micro et la personne interviewée. Plus il est proche, plus l'environnement autour sera loin. Pour la prise de son, ce sont toujours les mêmes conseils: être le plus proche possible de la voix, essayer de se mettre dans un environnement dans lequel il n'y a pas trop d'acoustique, ni trop de bruits parasites, que ce soit une fenêtre qui donne sur un boulevard ou un frigo qui fait du bruit, par exemple. Chaque élément sonore que l'on a autour de soi peut être un parasite. L'idée c'est de trouver un endroit où on les réduit au maximum.
Dans l'idéal, quand on fait de la prise de voix en studio, on change de micro parce que certains vont mieux marcher sur certaines voix. Mais, au final, la référence est toujours la même: les oreilles. On se sert de ses oreilles pour écouter ce que l'on enregistre, et ensuite, avec la chaîne des outils de prise de son (le micro, le pré-ampli et l'enregistreur), on essaie d'avoir un grain et un rendu qui corresponde le plus possible à la réalité entendue. Personnellement, dans le cadre des voix, j'essaie d'avoir un rendu le plus naturaliste possible.»
Tu te charges aussi du mixage. Qu'est-ce que c'est?
«Le mixage vient après la prise de son. On travaille plutôt sur le ressenti que va amener la voix. On essaie de trouver le timbre le plus naturel possible, tout en étant le plus agréable. Si une voix est un petit peu agressive, on va calmer les aigus pour l'adoucir. Au contraire, si une voix a beaucoup trop de coffre, de caisse, donc de fréquences basses, on va les calmer un petit peu aussi pour que la voix soit entendue le mieux possible.
Il y a des zones de fréquences que l'on va également augmenter pour améliorer ce que l'on appelle l'intelligibilité. Ce facteur est très important car on ne sait pas sur quoi le produit final va être écouté: sur un casque iPhone, sur des écouteurs vraiment mauvais, ou sur une paire d'enceintes à 20.000 euros. Il s'agit d'essayer de trouver le grain sonore qui va amener le même ressenti, quel que soit le support ou même le lieu d'écoute, dans un salon très calme, ou dans le métro. C'est un jeu d'équilibriste puisqu'il faut aussi garder l'identité sonore de la personne qui parle. Dans le grain d'une voix, déjà énormément de choses se disent et se racontent.
Quand je fais le mixage, je n'ai pas d'influence sur ce qui est dit, j'ai une influence sur la manière dont on l'entend. Imaginons une œuvre visuelle, quelle qu'elle soit, un tableau ou un dessin. Sans mixage ou avec un mauvais ingénieur du son, c'est comme si cette œuvre était exposée dans une cave mal éclairée. Si je fais bien mon métier, cette œuvre est alors parfaitement éclairée, accrochée dans une galerie, bien encadrée et mise en valeur.»
Nos oreilles à nous, auditeurs lambda, sont-elles assez sensibles pour entendre la différence entre une bonne et une mauvaise prise de son, un podcast mixé ou pas?
«Sincèrement je pense que oui. Nos oreilles sont ultra éduquées, surtout à la voix enregistrée et microphonée, et particulièrement en France avec une tradition radiophonique assez forte. De base, l'oreille humaine est un sens assez étrange, dont on n'a pas forcément conscience puisqu'il est constamment allumé, en route. L'ouïe ne s'arrête jamais. Il suffit de fermer les yeux pour prendre conscience du fait que l'on voit. Au contraire, on entend absolument tout le temps. Cela ne rend pas forcément l'ouïe éduquée. Mais du moins, on emmagasine de la mémoire auditive non-stop, même quand on dort, ce qui la rend sensible à de plus en plus de sons.
Ce qui est intéressant, c'est que la voix enregistrée, notamment la voix radiophonique, n'est pas une voix que l'on a l'habitude d'entendre dans la réalité, puisque c'est comme si quelqu'un nous parlait de manière très proche, au creux de l'oreille. On rentre dans une intimité. La bonne qualité de prise de voix, c'est ce réalisme, mais aussi l'effet que cela va avoir sur nous en termes d'intimité. Pour les podcasts, une bonne qualité de son, c'est quand la voix réussit à créer ce rapport-là d'intimité, comme si une personne te racontait une histoire à toi, et uniquement à toi. Et on sent quand ça marche et quand ça ne marche pas.»
N'y a-t-il qu'une seule bonne qualité de son en podcast?
«La bonne qualité sonore dépend fortement de ce que l'on veut raconter. On peut très bien avoir un rapport un peu plus éloigné à la voix, mais qui est ultra réaliste parce que la voix est ancrée dans un environnement sonore qui nous parle (on entend les voitures passer dehors, la machine à café qui coule...). Là, c'est moins un rapport à l'intime qu'un rapport au réel qui est engagé.
La voix telle qu'on l'a travaillée dans les podcasts de Louie Media est légèrement différente du rapport radiophonique. Typiquement un Transfert, ce n'est pas une voix au creux de l'oreille qui vient effleurer le tympan, mais ce n'est pas une voix très éloignée non plus. On a plutôt l'impression que la personne est en face de nous, que l'on est capable de la regarder dans les yeux. C'est en tout cas l'imagerie que je m'en fais. C'est intéressant parce qu'au final, on est presque plus naturel que la radio, qui serait plutôt naturaliste, et pourtant, on est détaché du réel au sens où la voix est isolée du reste de l'environnement sonore. On se retrouve avec une personne qui nous raconte son histoire à nous auditeurs, sans que l'on prenne en compte l'endroit où la personne se trouve. Transfert, c'est une confession. Il faut donc garder cette proximité et cet isolement.»
Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de notre son?
«En terme de qualité de son, on peut toujours faire mieux. Avoir un micro et un enregistrement encore plus cher, qui font passer moins de souffle, qui rendent un grain de voix encore plus plein. Mais ce ne serait pas fondamentalement différent. Donc je pense que sur Entre et Transfert, on pourrait difficilement faire vraiment beaucoup mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que l'on aille ailleurs, sur d'autres formats, sur des rapports différents au produit audio. Il y a plein d'autres voies qui peuvent être explorées. C'est là que l'on va découvrir de nouveaux challenges.»
Propos recueillis par Elie Olivennes