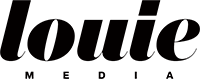Peut-on combiner le meilleur du salariat et de la freelance ?
Dans le monde du travail, on a souvent l’impression qu’on doit absolument choisir entre deux statuts. D’un côté, la freelance, qui recouvre les indépendantes et indépendants et les auto-entrepreneur·e. Et de l’autre, le salariat. Chaque statut semble avoir ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, on associe la flexibilité des horaires mais aussi la prise de risques au statut d’indépendant. Tandis qu’on projette sur le monde du salariat une certaine sécurité de l’emploi mais aussi des rapports hiérarchiques.
En fait, c’est comme s’il fallait choisir son camp, et qu’on ne pouvait pas tout avoir. En gros : est-ce qu’on privilégie la liberté en allant vers la freelance ou est-ce qu’on tient à une certaine sécurité, en optant pour le salariat ? Dans cet épisode, on va découvrir un entre-deux, qui permet de cumuler le meilleur de chaque système professionnel.
Je suis Lola Bertet. Bienvenue dans Travail (en cours).
Samantha Breitembruch a décidé de relever le pari - d’essayer de s’émanciper à la fois de la subordination, mais aussi de la précarité. En 2019, elle quitte son emploi de directrice de la communication internationale dans une grande entreprise d’agro-alimentaire. Ce qui la pousse à partir, c’est la dissonance qu’elle ressent de plus en plus entre ses valeurs et l’activité de sa boîte. Elle opte donc pour l’auto-entreprise pour avoir davantage la main sur ses activités professionnelles.
Et c’est à ce moment-là qu’elle intègre Coopaname, une Coopérative d’Activité et d’Emploi, une “C.A.E”. :
Samantha : Ça faisait très longtemps que je connaissais Coopaname, parce qu'une relation de travail assez ancienne m'en avait parlé au moment où il allait rejoindre la structure. Je trouvais que c'était une façon assez inédite de créer un cadre sécurisé pour entreprendre de façon collective, tout en développant ses propres activités. Ce qui m'a plu dans le principe, c'est le côté un petit peu pirate, c'est à dire qu'on réussit à se créer un filet de sécurité parce qu'on réunit une sorte de mutuelle de travail. Cette dimension collective m'appelait, elle m'intéressait.
Pour mieux comprendre le côté “pirate” des CAE, je contacte Marie-Christine Bureau. Elle est sociologue chargée de recherche au CNAM et au CNRS. Avec sa consoeur Antonella Corsani, elle a publié plusieurs articles sur le fonctionnement des Coopératives d’Activité et d’Emploi. Elle me raconte le contexte de la création de la toute première C.A.E. :
Marie-Christine : La première est créée au milieu des années 90 et donc on est dans un contexte où les politiques incitent déjà à l'époque les chômeurs à créer leur propre emploi. Évidemment, avec beaucoup de pertes, c'est à dire que beaucoup de ces projets d'activité fortement incités n'aboutissent pas. Et donc, des acteurs militants… On trouve deux femmes qui ont joué aussi un rôle très important au début de cette histoire, qui sont Elisabeth Bost et Béatrice Poncin, qui, chacune à leur manière, ont contribué avec d'autres, bien entendu, à imaginer ces premières incarnations de coopérative d'activité d'emploi pour sécuriser.
Après la création de la première C.A.E. en 95’, de nombreuses autres ont vu le jour en France, dont Coopaname en 2004. Aujourd’hui, on dénombre 155 C.A.E., qui regroupent 12 000 entrepreneur.es exerçant dans différents domaines. En 2014, la loi Hamon reconnaît l’existence juridique de ces structures et de ses entrepreneur·es pas comme les autres, que l’on appelle des : entrepreneur·es-salarié·es.
Marie-Christine Bureau : Qu'est ce qu'une ou un entrepreneur salarié ? C'est une personne qui développe un projet d'activité autonome, mais qui devient salarié d'une coopérative d'activité d'emploi et qui, à ce titre, va pouvoir bénéficier du droit social et de toutes les protections attachées aux salariés.
Sur le papier, ça paraît tout simple. Mais comment ça fonctionne exactement ? Je contacte Alexandra Lanque, qui est co-directrice de Coopaname :
Alexandra : Concrètement, comment ça marche à Coopaname ? Je viens développer mon activité et je vais facturer avec la coopérative. Ensuite, c'est ce chiffre d'affaires que j'ai développé qui va se transformer en salaire. Je vais payer mes cotisations salariales et patronales puisque finalement, je suis un peu ma propre patronne et comme ça, je vais pouvoir me créer des droits sociaux.
Les C.A.E. comme Coopaname, proposent en définitive de transformer un statut d’auto-entrepreneur·e en statut de salarié·e par la signature d’un contrat à durée indéterminée avec la coopérative. Et donc, de pouvoir bénéficier, tout comme dans le salariat, de droits au chômage, de congés payés, maladie ou maternité.
Selon Marie-Christine Bureau, les C.A.E. permettent par leur simple existence de perturber la conception actuelle du monde du travail :
Marie-Christine Bureau : Tout au long du 20ème siècle, il y a cette distinction entre travail indépendant et travail salarié. C'est imposé à peu près partout en Europe et basé sur le critère de subordination du travail. Et du coup, avec des conséquences importantes puisque le travail salarié relève du droit du travail alors que le travail indépendant va relever du droit commercial. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes protections qui y sont attachées. Cette notion d'entrepreneur salarié vient d'une certaine manière bousculer cette logique binaire en disant « Pourquoi faudrait il nécessairement choisir entre l'autonomie et la sécurité ? » C'est tout un imaginaire aussi qui est véhiculé derrière, je pense, avec l'idée de l'entrepreneur qui est forcément amateur de risque individualiste et le salarié qui, lui, jouerait plus collectif, mais rechercherait la sécurité en échange de la subordination qu'il accepterait. Cette notion d'entrepreneur salarié vient bousculer cette dichotomie qui est à la fois juridique, inscrite dans les textes et en même temps, je pense, fortement ancrée dans nos imaginaires.
Les C.A.E. tentent en quelque sorte de conjurer ce qui peut poser problème dans le salariat et la freelance. Elles s’organisent donc autour de la recherche de la sécurisation de l’entrepreneur·e, mais pas seulement. Les Coopanamiennes et Coopanamiens semblent avoir pour point commun de vouloir sortir de la logique de subordination qui règne dans le monde du salariat. C’est le cas d’Alexandra Lanque :
Alexandra : Je n'étais pas du tout prédestinée à être à Coopaname parce que j'ai fait une grosse école de commerce et j'ai commencé dans le monde professionnel dans le secteur bancaire. Je me suis vite rendue compte que je ne me sentais pas bien, je me sentais mal à l'aise dans un système qui était très hiérarchique et très subordonné et qui reliait les personnes, pas forcément avec un lien humain, social, mais plus avec un lien statutaire, qui était ma place, en tous les cas, au sein de la banque, par exemple. J'ai arrêté à la banque et je me suis dit que j'allais chercher un endroit où je pouvais expérimenter le travail différemment. J'étais déjà dans ce questionnement de rapport au travail et je suis tombée un peu par hasard sur la présentation de Coopaname et j'ai été surprise parce que je ne pensais pas qu'un monde comme ça pouvait exister vraiment. Je me retrouve à Coopaname en me disant « C'est peut être l'endroit où je vais pouvoir enfin expérimenter un autre rapport, pouvoir re-questionner le travail dans mon travail.” Et ça, je trouvais ça super.
En 2020, Alexandra intègre donc la structure en tant que chargée d’accompagnement. Concrètement, elle aide les entrepreneur·es-salarié·es à développer leurs activités au sein de Coopaname. Convaincu par le projet de la coopérative, Alexandra se présente en 2022 à la co-direction avec deux autres personnes :
Alexandra : Dès mon entrée en tant que Chargée d'accompagnement, j'ai été portée par le projet politique. Ça me paraissait logique de pouvoir le crier sur tous les toits. C'était vraiment ce dont j'avais envie. Et à ce moment-là, l'opportunité a fait qu'on a pu présenter une candidature à trois. C'est ça aussi qui est très caractéristique, c'est-à-dire que je pense que je n'aurais pas pu présenter une candidature de direction générale si j'étais seule. C'est aussi ça que permet Coopaname, c'est de le faire à plusieurs, de se répartir la tâche et de toute façon, être dans un cadre quotidien où on fait tous ensemble. C'est plus un mandat social que vraiment un mandat de direction. C'est un mandat de représentation limité dans le temps, avec certaines tâches spécifiques. C'est ces conditions-là qui m'ont amenée à prendre plutôt sereinement ce mandat.
En juillet 2022, le trio dont fait partie Alexandra est élu pour une durée de 3 ans à la direction de Coopaname. Car la C.A.E est une structure démocratique :
Alexandra : On parle d'un fonctionnement démocratique déjà par la forme de la coopérative. C'est ce qu'on appelle une SCOP. C'est une coopérative qui appartient à la génération d'associés qui est là. Ça change tout dans le rapport qu'entretiennent les membres de la coopérative, puisque c'est quand même un lien social qui nous unit, parce qu'on partage une entreprise. Les entrepreneurs ne partagent pas que des fonctions qu'ils ont mutualisées comme la comptabilité, l'informatique ou autres, mais vraiment la gestion de cette entreprise et donc la prise de décision. Ça va se matérialiser, notamment dans un conseil d'administration où la majorité des personnes qui y siègent sont des entrepreneurs salariés. Donc, en plus de leur activité, et c'est ça qui est assez intéressant si on relie à des notions d'éducation, c'est qu'on peut apprendre ensemble, collectivement, à gérer justement une entreprise et à prendre des décisions ensemble.
Si Coopaname prend cette forme aujourd’hui, la C.A.E n’a pas toujours fonctionné de cette manière. Alexandra m’explique que la structure est en réflexion permanente sur son fonctionnement :
Alexandra : On peut voir ce qui se passe à Coopaname comme une expérimentation, comme une construction de la démocratie. Coopaname, quand ça commence il y a 20 ans, (...) on a toujours une forme d'entreprise qui va avec. Ça commence en SARL. En SARL, on a des co-gérants, mais ils se sont retrouvés à un moment en se disant
« Ce n'est pas normal qu'on prône le collectif et qu'on ait une forme d'entreprise, finalement, qui ne permet pas d'avoir cette gestion collective. » il y a eu une transformation en 2008, en société anonyme, qui a permis d'avoir un conseil d'administration, d'avoir aussi une coprésidence et une codirection. Ça, c'est un des changements, notamment, phares de la coopérative, mais on pourra en trouver plein d'autres parce qu'on n'est jamais, encore une fois, à l'état de fait de démocratie et on le cherche toujours.
Il y a une autre particularité dans le fonctionnement des C.A.E. qui permet aussi cette forme de démocratie : l’obligation de devenir associé·e de la Coopérative au bout de 3 ans. Samantha Brei-TEM-BRUR Breitembruch, elle, a vécu ce passage comme l’opportunité de poursuivre son investissement chez Coopaname :
Samantha : Pour moi, l'Assemblée générale où je suis devenue sociétaire, c'est un moment marquant au cours duquel j'ai déclaré prendre des parts. Et puis, j'ai réaffirmé devant cette assemblée mon souhait de construire un nouveau rapport au travail et de le faire collectivement avec plein de travailleurs et de travailleuses au sein d'une coopérative de travail heureuse.
En écoutant Samantha et Alexandra, je suis frappée par les mots qu’elles emploient pour parler de leur rapport au travail : “construire”, “expérimenter”, “questionner”... Je suis aussi marquée par leur enthousiasme et leur volonté. J’ai l’intuition qu’il ne s’agit pas seulement pour les C.A.E. de déjouer les écueils de deux statuts professionnels mais d’aller jusqu’à imaginer une nouvelle manière d’entreprendre. D’après Marie-Christine Bureau, c’est d’ailleurs le deuxième objectif autour duquel se sont créées les premières C.A.E. :
Marie-Christine Bureau : Elles sont duales dès leur création, d'une certaine manière, puisqu'il y a à la fois cette idée de sécuriser des parcours de créateurs d'entreprises d'activité, et il y a aussi l'idée d'entreprendre autrement. Et l’histoire d'Oxalis, qui s’est transformée après en coopérative d’activité d'emploi mais qui s’était créée au départ en coopérative était plutôt dans cette optique là : entreprendre différemment à plusieurs. Et donc là, c'est aussi toute une réflexion de certaines militantes, en particulier du travail social et de l'insertion par l'activité économique, qui recherchaient des alternatives à des politiques qui ne les satisfaisaient pas du tout. Il y a aussi cette idée là : comment on peut entreprendre à plusieurs de manière alternative ?
Je pose cette même question à Alexandra : comment Coopaname repense collectivement l'entreprenariat, en s’affranchissant peut-être de codes ou de préjugés que l’on peut avoir sur ce positionnement professionnel ? Alexandra me donne des exemples :
Alexandra: Par exemple, une idée reçue au niveau de l'entreprenariat, c'est que chacun, chacune doit avoir son compte bancaire. À Coopaname, il y a 500 entrepreneurs qui partagent un compte bancaire et ça va de l'ébéniste au graphiste à la consultante RH. Ça, ça vient casser un code classique. Oui, on peut fonctionner à 500 depuis 20 ans avec un même compte bancaire et donc mutualiser ses coûts et mutualiser sa gestion. Un autre mythe aussi qui est plutôt lié à l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être capable de tout faire bien tout seul. C'est un peu l'inconvénient souvent qu'on retrouve chez les entrepreneurs, c'est ce sentiment d'isolement et ce questionnement constant de se demander si, au-delà du métier que l'on développe, si d'un point de vue gestion, on gère bien son entreprise. Là aussi, Coopaname dit « Occupez vous de votre métier, faites ce que vous aimez la plupart du temps et on va s'occuper du reste. Ça, ça change tout dans le rapport au travail.
Le fait d’être un ensemble d’entrepreneur·es et non une ou un entrepreneur·e isolé·e permet donc un certain nombre d’avantages, comme de diminuer la charge administrative ou de rompre l’isolement. Mais cela va encore plus loin. Car Coopaname repose sur l’idée d’une mutualisation qui va jusqu’à la question du risque :
Alexandra : Quand on est entrepreneur, on sait qu'on a plein de risques au quotidien. On a un risque que son matériel de travail tombe en panne. On a un risque d'avoir un accident du travail ou alors un arrêt maladie et donc qui va avoir directement un impact sur nos revenus. On va aussi avoir un risque, par exemple, qu'un gros client ne paye pas. Coopaname est en train d'expérimenter une partie, une traduction de ce qu'on peut appeler la mutuelle de travail, c'est à dire toujours se prémunir des risques ensemble en créant des fonds de solidarité, c'est à dire qu'en fin d'année, les activités qui ont eu des bénéfices, un pourcentage de ces bénéfices va rester dans la coopérative et va pouvoir nourrir ces fonds. Ce qui fait que si je reprends un exemple très concret, je sors d'un long arrêt maladie et je ne vais pas développer le même chiffre d'affaires qu'avant mon arrêt maladie, je vais pouvoir demander au fond de secours de la coopérative qu'on m'aide à financer la moitié de mon salaire, par exemple. Il y a une idée aussi fondamentale à Coopaname, c'est l'idée de prendre soin des personnes, au travers de la prise de soin à la fois de leur activité et des personnes elles-mêmes. C'est comme ça aussi qu'on change le rapport au travail, c'est à dire on est ensemble et on prend soin des uns des autres pour être le plus proche possible, en tout cas de cet idéal et de cette utopie de bien être au travail, mais de bien être soi même vraiment dans son activité.
Cette mutuelle de travail passe aussi par d’autres biais, comme me le souligne Marie-Christine Bureau :
Marie-Christine Bureau : Je pense qu' un des points les plus importants peut-être de ce qui est mutualisé dans ces lieux-là, c'est les savoirs et les compétences. Ça, c'est une chose qui m'a frappée quand on a fait des enquêtes, en particulier à Coopaname , c'est qu'au-delà des motivations premières des personnes pour y rentrer, il y avait cette idée d'un enrichissement par les échanges de savoirs. Ça peut être aussi bien des échanges de savoirs au sein d'un même métier, c'est à dire des partages d'expériences du métier, et ça peut être aussi de rencontrer des personnes qui sont sur d'autres métiers et de pouvoir imaginer des coopérations inédites et d'accéder à des domaines qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans les entretiens.
Pour Samantha, cette mutualisation des savoirs s’incarne dans des temps de rencontre entre les membres de Coopaname :
Samantha : On sait qu'on est réunis par une mutuelle de travail, mais certainement aussi par une certaine vision de la société. On est tous acteurs, c'est-à-dire aux manettes de notre activité professionnelle. Et ça, ça a beaucoup de valeur aussi.
Par exemple, je peux te parler de la Big Rencontre qui se tient chaque année à Sète, fin août. C'est un séminaire pour notre coopérative, mais aussi pour d'autres coopératives qui font partie de notre écosystème. Et depuis que j'y vais, chaque année, je propose des ateliers que je conçois pour les besoins de ce séminaire et parfois, de fil en aiguille, ça donne aussi lieu à de nouvelles prestations. Par exemple, depuis deux ans, on organise avec une collègue un atelier d'écriture et de fil en aiguille, on nous a demandé de développer une formation. Ensemble, on va proposer une formation, développer sa créativité par l'écriture, et exprimer des talents qui pour moi font vraiment échos à ce qui m’a toujours guidé, c'est-à-dire la pluridisciplinarité.
Samantha est consultante en communication, mais pas seulement. Elle est aussi traductrice et donc, depuis peu, animatrice de formations. Elle fait partie de ce que l’on appelle les pluri-actifs, c’est-à-dire celles et ceux qui exercent plusieurs métiers en même temps. Et elle est loin d’être la seule dans ce cas chez Coopaname :
Alexandra : Coopaname, c'est ce qu'on appelle une coopérative multi activité. Je peux venir avec ma casquette de consultant RH parce que c'est le métier que j'ai développé pendant des années en tant que salarié, mais je peux développer aussi en même temps des formations pour le vélo, par exemple, pour faire du vélo. Ça, c'est assez intéressant parce que Coopaname va s'adapter au parcours de vie des personnes.
Pour Marie-Christine Bureau, la multi-activité semble même être une des caractéristiques des C.A.E. :
Marie-Christine Bureau : On a (...) beaucoup de coopératives multi actives, mais pas seulement. Il y a aussi des coopératives qui sont plus axées sur tel ou tel métier, mais c'est quand même une des caractéristiques de ces coopératives, la plupart du temps, c'est d'être multi actifs et d'abriter des activités différentes.
Selon elle, les C.A.E. répondraient ainsi directement à un nouveau besoin des travailleuses et travailleurs. Elles et ils seraient de plus en plus attiré·es par la pluriactivité. Mais il y a de nombreux freins dans la législation actuelle, qui est fondée sur la norme de la mono-activité, c’est-à-dire le fait de n’avoir qu’un seul emploi :
Marie-Christine Bureau : ce qui posait problème au pouvoir public par rapport à la priorité d'activité, c'était la question des droits sociaux puisque finalement, l'architecture, l'arsenal des droits sociaux était basé sur cette norme d'emploi mono actif et donc posait problème à tous ceux qui travaillaient pour plusieurs employeurs et tous ceux qui avaient des activités différentes, qui pouvaient relever de régimes et de statuts différents. Ça a certainement freiné le développement même d'une pluri activité qui pouvait être souhaitée et désirée par des personnes. D'ailleurs, on a pu constater que dans les pays où le système de droits sociaux est arrimé à la personne et non pas à l'emploi, la pluriactivité se développait davantage. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, le statut d'entrepreneur salarié permet d'exercer une forme de pluriactivité, des activités diverses, même si elles font sens entre elles d'ailleurs, même s'il y a une cohérence du point de vue de la personne de choisir ce panier là d'activité. Ça permet de l'exercer sans avoir ces discontinuités de droit et ces problèmes de concilier plusieurs régimes de droits sociaux.
Samantha fait partie de ces personnes qui ont toujours voulu ne pas se limiter à un seul champ. Un désir de croiser les disciplines et les savoirs qu’elle a cherché à pousser le plus possible, dès ses études :
Samantha : Mes études, elles ont surtout été guidées par la pluridisciplinarité. J'étais une très bonne élève littéraire, j'ai donc fait des prépas et je crois que j'ai retardé autant que possible le moment où j'allais me poser la question de la professionnalisation. J'ai dû me poser la question peut-être quand, à l'issue de mes deux khâgne, en étant admise sur liste complémentaire à l'École normale sup', on m'a proposé un deuxième DEG. Et là, je me suis dit que la géographie était la matière qui était la plus professionnalisante et qui pouvait me permettre de faire autre chose que de l'enseignement. Mon cursus principal, c'était un cursus en langue, c'était l'espagnol. C'est vraiment le principe de pluridisciplinarité qui a guidé mon orientation postbac.
Après ses études, Samantha essaie de développer au maximum ses savoir-faire à travers ses emplois. Jusqu’à ressentir une frustration et le désir de se créer son activité sur-mesure:
Samantha : Ça, c'est typiquement quelque chose que je n'aurais certainement pas fait seule. Je ne l'aurais pas fait sans la Big Rencontre. Des exemples concrets qui montrent que cette façon d'entreprendre collectivement nous permet d'inventer des choses et de faire pleinement appel à notre créativité et d'exprimer des talents qui, pour moi, font vraiment écho à ce qui m'a toujours guidée, à savoir la pluridisciplinarité.
En parlant avec Marie-Christine Bureau mais aussi Samantha, il y a une chose qui me saute aux yeux : celui d’un intérêt tout particulier des femmes pour les C.A.E :
Marie-Christine Bureau : les femmes sont beaucoup plus présentes dans les CAE que dans l'entrepreneuriat en général (...) donc c'est une forme qui permet davantage aux femmes d'accéder à ces formes d'entrepreneuriat. Et puis, un des résultats qui nous avait beaucoup intéressés dans l'enquête qu'on a menée (...) c'est le fait que l'effet collectif, c'est à dire le fait de travailler en collectif, d'avoir des collectifs de production, bénéficiait massivement aux femmes. L'effet n'était pas très significatif pour les hommes, mais il l'était beaucoup pour les femmes, c'est-à-dire que leurs chances d'accéder à un revenu correct étaient augmentées beaucoup avec le fait de travailler en collectif.
Marie-Christine Bureau et ses collègues se sont interrogé·es sur les raisons de ce résultat inhabituel, sans parvenir à une conclusion complètement satisfaisante. Je décide d’interroger Alexandra à ce sujet :
Alexandra : Dans la coopérative, il y a majoritairement des femmes et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que dans le monde entrepreneurial, souvent, on retrouve beaucoup d'hommes. Pourquoi à Coopaname, il y a plus de femmes ? C'est aussi parce qu'il y a déjà un mécanisme salarial qui est protecteur. Quand on a, par exemple, un congé maternité, on a la protection sociale qui va avec. Ça, c'est déjà un statut qui est rassurant. Et puis, c'est surtout un cadre collectif qui est rassurant, c'est à dire avec beaucoup d'outils d'éducation populaire, on arrive dans des collectifs de travail où il y a une attention particulière sur le temps de parole, sur l'écriture inclusive et sur plein de mécanismes comme ça, on a aussi, par exemple, des exemple, des événements qui sont spécifiquement pour les femmes, le marché des créatrices, où ça va être des personnes qui développent des activités plutôt artisanales et qui va être dédiée aux femmes.
Coopaname permettrait en quelque sorte de donner l’espace aux femmes pour échanger et s’épanouir professionnellement mais leur permettrait aussi, par la sécurité qu’elle apporte, de pouvoir combiner les différentes facettes de leurs vies plus facilement. C’est d’ailleurs le constat que fait Samantha :
Samantha : Je me sens plus à l'aise pour intégrer d'autres pans de ma vie. C'est-à-dire que je suis maman de deux enfants. Les contraintes du temps scolaire sont beaucoup plus facilement intégrées à mes contraintes de travailleuse. Je n'ai pas l'impression qu'on me demande d'effacer d'autres pans de ma vie comme j'ai pu l'expérimenter en étant salariée ailleurs. Du coup, je me sens davantage intègre et complète parce que justement, d'autres pans de ma vie sont acceptés par cette façon de travailler. Et ce n'est pas forcément le cas dans toutes les formes de travail.
Mais alors, si les C.A.E. peuvent avoir tant de vertus pour les travailleuses et les travailleurs, pourquoi est-ce que ces structures sont, près de 20 ans après leur création, si peu connues ? En travaillant sur cet épisode, j’ai fait le test : j’ai demandé autour de moi qui connaissait l’existence des C.A.E. Sur 10 personnes interrogées, 3 seulement savaient en quoi consistaient ces coopératives.
J’ai demandé à Marie-Christine Bureau pourquoi les C.A.E. restent aujourd’hui inconnues du grand public :
Marie-Christine Bureau : C'est en partie un mystère. Pourquoi finalement ça reste assez limité ? Puisque ça concerne à peu près 12 000 personnes, ce qui n'est pas beaucoup. Je pense qu'en fait, on est sur un débat de fond qui est ce dépassement de la logique binaire qui a été largement posé à la fin du 20ème siècle et dont on n'est pas sorti aujourd'hui. On n'a pas trouvé de solution satisfaisante. Je pense que les coopératives d'activité d'emploi sont une réponse probablement parmi d'autres parce qu'on pourrait imaginer de mettre en place, plus que de réfléchir, parce que c'est réfléchi depuis longtemps, à un statut de l'actif, à un statut du travailleur à travers les différentes formes de travail qu'il peut exercer. Parce que quelque chose qu'on peut-être mesure mieux aujourd'hui, c'est à quel point le travail peut prendre des formes différentes. On peut dire que la frontière entre le travail et la formation, l'apprentissage est aussi parfois extrêmement ténue. On pourrait imaginer de repenser ça peut-être plus globalement. Je pense que les coopératives d'activité d'emploi ont été vraiment une réponse citoyenne et une façon de prendre ce problème à bras le corps.
Les Coopératives d’Activité et d’Emploi comme Coopaname apportent des espaces de réflexion sur le travail : que ce soit sur le cadre dans lequel nous exerçons ou encore sur notre activité en elle-même. A entendre ces témoignages, elles apparaissent un peu comme un eldorado.
Mais je me demande si les entrepreneur·es-salarié·es sont vraiment exempté·es de mal-être au travail. Marie-Christine Bureau a repéré deux écueils principaux : le maintien d’une certaine précarité et le sur-investissement dans le professionnel :
Marie-Christine Bureau : Les risques psychosociaux, évidemment, c'est une question qui se pose partout, mais qui se pose aussi là. D'une part, la première, c'est que ce n'est pas le remède miracle à la précarité du tout. Ça, les enquêtes qu'on a pu faire sur les revenus le montrent. Mais malgré tout, en particulier à Coopaname, c'était une attention constante d'essayer de repérer s'il n'y avait pas des personnes en situation de précarité durable et qui n'arrivaient pas à en sortir. Ça, c'est effectivement une première source de risque psychosocial. La deuxième, c'est le surengagement. Ça, on le retrouve en particulier dans des structures où il y a à la fois une activité économique et en même temps un projet politique, on pourrait dire collectif en tout cas, qui peut inciter à un engagement personnel assez fort. On peut avoir des entrepreneurs salariés qui sont partagés entre le fait aussi de développer leur propre activité pour assurer un minimum de revenus et en même temps l'envie de s'investir davantage dans un projet collectif fort et qui leur parle.
Autrement dit, les risques de nuisances liées au travail se rapprochent des risques qui concernent les entrepreneurs qui ne font pas partie d’une coopérative. Les C.A.E. proposent des bulles dans un système qui demeure inchangée et ne peuvent donc être totalement hermétiques à ce qui se pratique dans le monde du travail. Même si dans ces cas précis, on peut compter sur la force du collectif pour se relever en cas de difficultés. Et ça, ça peut tout changer.
Crédits :
Vous venez d’écouter Travail (en cours). Je suis Lola Bertet, j’ai tourné et écrit cet épisode. Il a été monté et réalisé par Louis Jaubart, et mixé par le studio La Fugitive. Louise Hemmerlé était à la production, accompagnée d’Elsa Berthault.
À très vite !