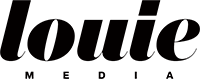Les podcasts sont-ils un art comme un autre?
/Dans la presse anglo-saxonne, des appels à l’aide sont lancés régulièrement: quand lira-t-on une véritable production critique sur les podcasts? Quand dépassera-t-on les articles économiques («le podcast est en plein boom!»), recensant des tendances («les podcasts d’histoire sont très en vogue», «les podcasts de true crime aussi») ou les listes de recommandation?
Johanna Zorn, co-fondatrice du Third Coast Festival, un festival international de podcasts à Chicago, a par exemple décrété qu’elle aimerait voir davantage «de critiques intelligentes et un examen plus approfondi des styles et des tendances». Dans The New Statesman, la journaliste Caroline Crampton exprimait le même désir dans un article intitulé «Pourquoi il est temps d’écrire sur les podcasts en tant que discipline artistique».
Il faudrait donc des critiques de podcasts comme il est des critiques de films ou de livres. Mais est-ce possible?
Un podcast contient-il une promesse?
La critique d'art, comme le rappelait Jean-Michel Frodon sur Slate.fr en 2010, «a été inventée par Diderot à la fin du XVIIIe siècle, elle a été développée et portée à son sommet par Baudelaire, l’un et l’autre utilisant un art, le leur, celui de l’écriture, pour ouvrir un nouvel accès à un autre art, dans leur deux cas la peinture. Tous les critiques n’écrivent pas comme Diderot et Baudelaire, loin s’en faut, mais le travail critique s’appuie sur une exigence d’écriture, une ambition que le travail de la phrase va donner accès, selon un mode particulier, à ces objets eux aussi particuliers que sont les œuvres d’art.
La caractéristique d’une œuvre d’art est d’être un objet ouvert (selon l’expression d’Umberto Eco), un objet dont on peut décrire les composants mais dont le résultat excède, et excèdera toujours ce qu’on peut en analyser et en expliquer. Et le travail du critique n’est pas, surtout pas, d’expliquer ce mystère, de répondre à la question que pose toute œuvre d’art. Celle-ci doit rester ouverte, pour être habitée librement par chacun de ses spectateurs – ou lecteurs, ou auditeurs, selon l’art dont il s’agit. (…) Est-ce à dire que tout film est une œuvre d’art? Bien sûr que non. Mais tout film, quelles que soient ses conditions de production, en contient la promesse, tenue ou non».
Les podcasts contiennent-ils eux aussi, toujours, une promesse d’œuvre d’art?
La zone grise
Au New Yorker, la journaliste Sarah Larson, qui écrivait depuis longtemps des critiques musicales, ou de théâtre, prend désormais la plume, toutes les semaines, pour décortiquer «Atlanta Monster» ou «Heavy Weight» à la manière dont on critiquerait un film ou un roman. Mais elle nous confiait en novembre dernier, lors d’une interview à New York: «ce qui est bizarre c’est qu’avec les podcasts nous sommes à la fois face à du journalisme et face à un art. Nombre d’entre eux prennent des histoires vraies et les présentent de manière scénarisée, avec du storytelling, de la musique, pour produire un format pensé comme une œuvre. Les podcasts appartiennent à une zone grise», précise-t-elle.
Une partie seulement de la production de podcasts contient cette «promesse» d’une œuvre.
«Le “Daily” par exemple est merveilleusement produit, j’adore l’écouter», nous dit-elle à propos du podcast du New York Times, «mais il n’y a pas d’intention artistique».
Pour Sarah Larson, la promesse peut sans doute être repérée grâce à trois éléments: le sound design, l’intention, la réalisation. «“Serial” et “S-Town” tendent en revanche vers l’oeuvre d’art. “Uncivil” de Gimlet, et “More Perfect” aussi sans doute. Je mettrais aussi dans cette catégorie un podcast indépendant nommé “Nocturne”. Le design sonore est très onirique, formidable. Je crois que l’on est tout juste en train de comprendre le pouvoir du podcast, de ce qu’il signifie pour nous.»
Une industrie émergente
Le fait que l’industrie du podcast ne soit pas encore tout à fait consolidée, tandis que les moyens de production peuvent en revanche être accessibles à tous, génèrent une situation paradoxale: n’importe qui peut faire un podcast (sans intention particulière) et la production éditoriale sur les podcasts vise d’abord à faire émerger l’industrie de manière consolidée: expliquer ses enjeux économiques et donner des recommandations.
«La barrière d’entrée pour un nouvel auditeur est assez haute», note Caroline Crampton dans le New Statesman où elle a commencé une chronique hebdomadaire sur les podcasts en octobre 2016, «il faut se rendre compte de l’existence d’une émission, la chercher ensuite dans une application, mettre des écouteurs, puis consacrer une vingtaine de minutes à savoir si oui ou non ça vous plaît assez pour que vous écoutiez régulièrement. Il est difficile de partager de l’audio d’une manière facilement consommable sur Twitter ou Facebook (…) Les classements iTunes restent un élément clé pour que les auditeurs découvrent de nouvelles émissions et ce système favorise les émissions déjà importantes.»
C’est d’ailleurs pour cela que tant d’initiatives visent à permettre une meilleure découvertedes podcasts, des apps se créent, aux États-Unis comme en France. «Sur beaucoup de fronts, les podcasts sont encore en cours de maturation. La manière dont on écrit dessus n’est que l’un de ces fronts».
Et d’autres arts, comme les séries télé, ont pâti de ce manque de production critique avant les podcasts. Il y a peu, rappelait Johanna Zorn dans une tribune sur Medium, les chaînes câblées, HBO, Amazon et Netflix étaient ignorées des programmes culturels. «Ces jours-ci, l’art populaire que les critiques ignorent encore est la narration audio».