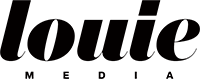Nous avons lancé mardi une campagne de financement participatif! Autant vous dire que pour les 40 prochains jours, vous allez voir passer un sacré nombre de postes sur les réseaux sociaux, à base de «PARTICIPEZZZ ✨⚡️💥🔥🌪🌈☀️❤️💛🤘» (Et effectivement, n'hésitez pas à participer 😏). Alors nous nous sommes dit que la moindre des choses était d'expliquer à quoi cet argent allait nous servir. À financer:
Les journalistes, qui cherchent avec intelligence et attention des histoires fortes et pertinentes, susceptibles de vous attendrir, de vous émouvoir, de vous enthousiasmer.
Les artistes qui composent nos musiques et dessinent nos illustrations.
Le matériel dont nous nous servons et les studios dans lesquels nous enregistrons pour vous faire entendre des voix toujours plus intimistes.
Les ingénieurs du son qui apportent leur extrême méticulosité à nos projets pour qu'ils sonnent le mieux possible.
Et le temps de production qu'il faut pour mener tous ces projets à bien.
Il s'agit aussi bien sûr de vous faire contribuer au développement de Louie! Mais c'est également un enjeu financier. Ce crowdfunding était l'occasion parfaite de se pencher sur le modèle économique du podcast. Nous avons donc interrogé trois acteurs français majeurs de ce milieu: Joël Ronez, cofondateur de Binge Audio; Julien Neuville, cofondateur de Nouvelles Écoutes; Candice Marchal, cofondatrice de BoxSons.
Quel est votre modèle économique aujourd'hui?
Joël Ronez, de Binge Audio:
«Notre modèle est aujourd'hui fondé sur la publicité et le brand content d'une part, et la production déléguée d'autre part. La publicité, c'est du sponsoring qui vient sur nos programmes. Pour le brand content, on travaille avec des clients comme Disney, Universal Pictures dans le domaine du cinéma; avec Médecins sans frontières, l'Université Paris-Saclay, la mairie de Paris dans le secteur public... La production déléguée, c'est la production de programmes que nous faisons pour le compte de diffuseurs ou de médias tiers. C'est ce qui forme la majorité de nos revenus aujourd'hui. On fait aussi de la production exécutive, de la prestation et du conseil, notamment dans le secteur des enceintes connectées. D'ici deux ans, s'ajoutera à notre modèle actuel une partie freemium: les auditeurs pourront souscrire à une partie payante qui donnera accès à un certain nombre de contenus additionnels à valeur ajoutée.»
Julien Neuville, de Nouvelles Écoutes:
«C'est un modèle économique traditionnel dans le milieu du podcast, anglophone ou français. Il est fondé sur la publicité dans les programmes que l'on produit nous-mêmes et sur les contenus que l'on peut réaliser avec et pour des clients privés, qu'il s'agisse d'organisations, d'entreprises, de clubs de foot...»
Candice Marchal, de BoxSons:
«On a un modèle économique payant qui fonctionne par abonnement. Pas de publicité, et pas d'argent industriel. Nous sommes parties avec un capital de base constitué de fonds propres et de fonds amicaux, auquel s'est ajouté l'argent collecté grâce au crowdfunding.»
Binge Audio, modèle freemium d'ici deux ans. Nouvelles Écoutes, gratuit. BoxSons, payant. Pourquoi ce choix?
Joël Ronez:
«Nous ajouterons ce modèle freemium pour disposer d’un lien direct avec nos auditeurs, et notamment pouvoir s’obliger à produire des contenus haut de gamme qui correspondent à leur demande. Cela nous permettra aussi de disposer de données statistiques fiables et utiles au pilotage éditorial.»
Julien Neuville:
«C'est un débat perpétuel dans les médias. En ce qui nous concerne, c'est un choix personnel. On ne veut pas sélectionner notre audience en fonction de ses revenus et de son pouvoir d'achat. J'entends aussi les arguments selon lesquels il faut payer pour avoir de l'information. Je pense que c'est bien d'avoir un peu de tout. Si tout le monde avait des régimes payants, cela ferait des notes de fin de mois colossales pour ceux qui sont abonnés à plusieurs programmes.»
Candice Marchal:
«D'abord parce que l'information a un coût. Nous, on fait du reportage, c'est ce qui nous distingue, même si on a quelques sections qui sont davantage de l'ordre du podcast, comme ce que fait Pascale Clark le dimanche [Un Bien Beau Brouhaha]. Il était hors de question pour nous d'un point de vue déontologique de mettre de la publicité, ou d'avoir des actionnaires qui aujourd'hui ont des participations dans toutes les boîtes.»
Avez-vous constaté un changement sur le plan économique depuis votre lancement?
Joël Ronez:
«On a fondé Binge Audio sur la base d'une analyse du marché et d'une intuition qui s'est révélée payante. Pour l'instant, les hypothèses que l'on avait formulées se sont vérifiées. Ce que l'on a constaté cependant depuis janvier, c'est une accélération brutale de la demande de la part des marques, des médias et des annonceurs. Pour vous donner un ordre d'idées, sur le premier trimestre de 2018, on a fait le chiffre d'affaire de toute l'année 2017.»
Julien Neuville:
«Oui, bien sûr. De plus en plus d'annonceurs comprennent la valeur d'une audience moins large, dans le podcast, mais beaucoup plus engagée et beaucoup plus fidèle. Il y a beaucoup plus d'annonceurs qui sont intéressés par l'audio en général, qu'il s'agisse des podcasts ou du développement des smart speakers.»
Candice Marchal:
«Nous sommes les seuls à faire payer pour du son. Je n'ai pas vu d'autres acteurs sur le marché qui le font. Donc ce changement, je ne le constate pas du tout. En ce qui concerne l'économie liée à la publicité, il faut s'adresser à ceux qui en font parce que je ne saurais dire s'ils ont plus de partenaires commerciaux. Quant à nous, nous n'avons pas changé de stratégie économique depuis notre lancement.»
L'avenir économique du podcast est-il assuré?
Joël Ronez:
«On ne peut pas dire qu'il y ait un avenir économique certain pour le podcast. Un avenir est assuré aux entreprises qui savent tirer leur épingle du jeu dans un environnement. Tout dépend de votre stratégie et des talents que vous faites travailler. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le secteur de l'audio numérique est en plein boum et va continuer à progresser de manière importante. Chez Binge Audio, nous sommes assez confiants sur la suite des événements. Maintenant, ce que l'on appelle “podcast” aujourd'hui deviendra de l'audio parlé non-linéaire qui prendra de multiples formes.»
Julien Neuville:
«On ne peut jamais dire que c'est assuré, on dépend beaucoup des aléas du marché. Dans les médias ou dans le domaine des services, il faut à chaque fois aller chercher un client. Cela demande beaucoup de ressources humaines et financières pour chaque contrat. Le podcast se propage petit à petit auprès des grands décisionnaires et des grandes boîtes, mais également auprès des plus petites start-up. Je pense d'ailleurs qu'il est encore plus intéressant de miser sur ces petites structures. Ce sont des noms un peu moins connus, mais elles font beaucoup de business en ligne. Il s'agit de grandir avec eux, plutôt que d'attendre que les grands groupes se tournent vers nous.»
Candice Marchal:
«Le podcast existe en France depuis très longtemps, sous diverses formes, qu'il s'agisse des fameux replays de Radio France, de radios privées, ou de podcasts amateurs. Il est vrai que depuis un an, il y a une offre de podcasts qui se professionnalise un peu. On en est aux prémisses je pense, mais j'ose imaginer qu'à l'instar des médias papier traditionnels qui se sont mis au net, l'évolution va se faire. C'est une alternative de plus pour les auditeurs. Il s'agit d'essayer de toucher le plus de monde possible, même si les gens ne savent pas encore très bien ni ce qu'est un podcast, ni où en trouver.»
En fonction de ces évolutions, envisagez-vous de changer votre stratégie économique?
Joël Ronez:
«J'ai une maxime qui dit : "Il faut avoir une stratégie très ferme et établie, mais en changer tout le temps”. C'est sûr que l'on adapte toujours sa stratégie aux événements du marché et à la façon dont les dynamiques créatives, techniques et économiques se déploient. On ne peut pas décider que le marché sera comme ceci ou comme cela, donc on changera ce qui doit être changé. Ce qu'on ne changera pas, c'est l'envie d'être un média, donc d'être un producteur, un éditeur et un diffuseur de contenus.»
Julien Neuville:
«Tout se passe comme c'était plus ou moins prévu, au moins en termes organisationnels. On met d'abord l'accent sur les équipes de production et de création. C'est la priorité pour nous. On arrive dans un second temps aujourd'hui où, avec notre chiffre d'affaire qui grandit, on a besoin de structurer nos efforts commerciaux. Mais pour l'instant, il s'agit pour nous de rester une boîte à taille humaine, très petite, agile et flexible. Il s'agit d'être à la fois performant et pertinent pour tenter d'être les meilleurs sur chaque domaine. On est quand même au début de quelque chose. Les marques ne savent pas encore ce qu'elles veulent, il n'y a pas de règles véritablement établies. Donc on essaie de faire du sur-mesure.»
Candice Marchal:
«Non, nous ne ferons pas de publicité et nous agirons sans partenaires industriels. C'est une question de déontologie qui est vraiment très importante pour nous. On a évidemment beaucoup de confrères ou consœurs qui travaillent dans des médias possédés par des grands groupes où il y a pléthore de publicité, et on ne doute pas un instant de leur indépendance. Simplement, il y a toujours un soupçon qui vient des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs. Cette défiance qu'il y a à l'égard des journalistes aujourd'hui, nous voulons la réduire en montrant que nous sommes totalement indépendants.»
Avez-vous fait un crowdfunding? Selon vous, pourquoi est-ce important pour un studio de production de podcasts?
Joël Ronez:
«On a fait un crowdfunding il y a un an et demi. C'est intéressant dans un processus initial d'amorçage pour trois raisons. D'abord, c'est un moyen important pour structurer et rassembler une communauté autour d'un objectif et d'une offre. C'est aussi une façon de se forcer à structurer un discours, une manière de communiquer et puis une offre auprès d'un public. Enfin, c'est un moyen de récupérer de l'argent qui vous permet de financer vos développements, et c'est quand même le principal.»
Julien Neuville:
«On a lancé notre crowdfunding quand on devait avoir quatre ou cinq mois. C'était important au début pour ne pas faire immédiatement rentrer des actionnaires externes qui n'auraient pas la même vision que nous ou que celle de l'audience. Cela importait aussi pour nous parce que l'on est gratuit, on l'a toujours été et on le sera toujours : il faut avoir les fonds nécessaires afin de produire ce que l'on a envie de produire. Cela permettait également de montrer qui on était, quelle était l'image de la boîte, et cela a donné aux internautes et auditeurs la possibilité de faire partie de notre développement. C'était l'occasion de montrer notre projet et d'évaluer ce que l'audience pouvait en penser. Si on n'avait pas réussi, on aurait compris qu'il aurait peut-être fallu changer des choses. Pour nous, cela a été positif, donc comme une première validation et confirmation que l'on allait dans la bonne direction.»
Candice Marchal:
«Nous avons fait un crowdfunding il y a un peu plus d'un an, en novembre 2016. On a récupéré 50.000 euros. C'était important pour fidéliser les gens et évaluer l’appétence que l'audience pouvait avoir pour un média alternatif comme BoxSons.»
Propos recueillis par Elie Olivennes
💡Pour participer au développement de Louie et faire émerger de nouveaux podcasts, vous pouvez contribuer ou partager notre campagne Ulule: Louie va vous faire entendre des voix.